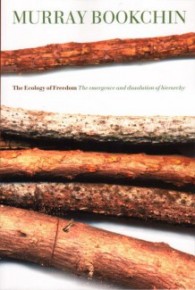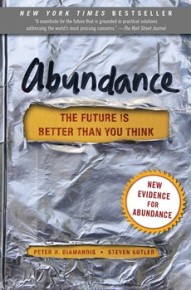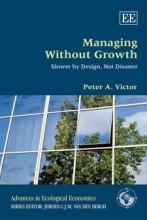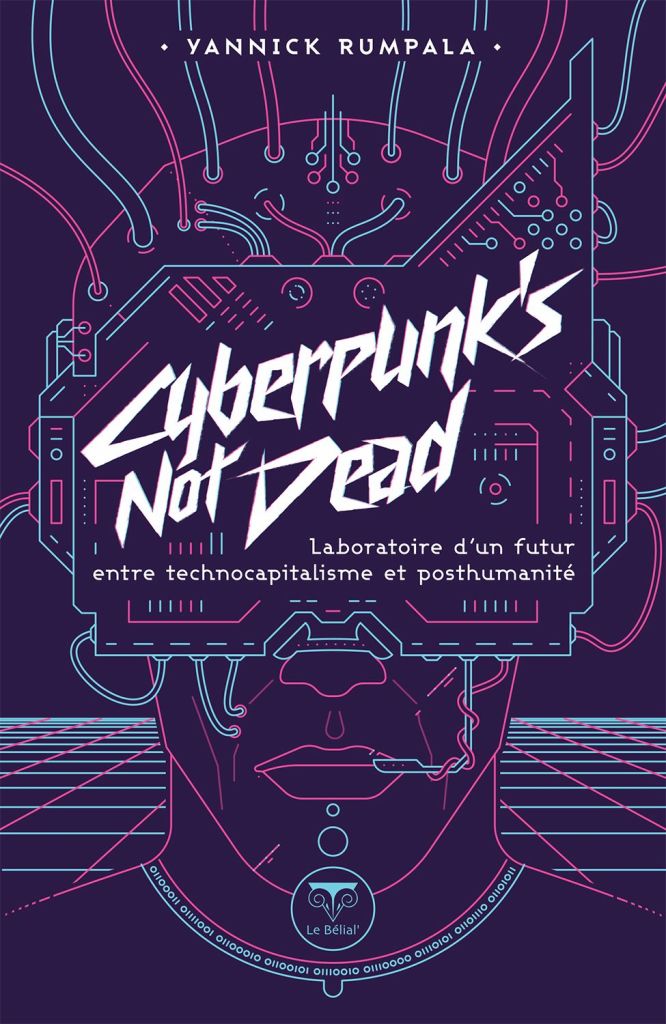Grâce au billet précédent, nous avons maintenant un cadre pour faciliter l’exploration d’alternatives (au sens anglophone du terme) ou de lignes de fuite[1] marquant la recherche de directions nouvelles. Il est possible de parler d’alternatives, parce qu’elles constituent des assemblages cohérents de propositions ayant des prétentions transformatrices à l’égard de l’ordre social, qui se retrouve de fait problématisé. Ces lignes de fuite opèrent un décentrement par rapport aux logiques de croissance. Avec des arguments plus ou moins développés, elles décrivent chacune des possibilités de transformation.
L’écologie sociale comme sortie de la rareté et décentralisation radicale
Le dépassement des situations de rareté est envisagé comme une possibilité (presque à saisir, même) dans l’« écologie sociale » théorisée par le penseur américain Murray Bookchin. Sa vision, qui commence à s’ébaucher dès les années 1950, est à la fois écologique et sociale parce qu’elle affirme que le tarissement des occasions de domination entre humains pourrait et devrait se combiner avec la disparition des prétentions humaines à dominer la nature (cette deuxième domination résultant même selon lui essentiellement de la première). Son projet est associé à une forme de confiance sur la possibilité de s’appuyer sur un potentiel libérateur des avancées technologiques et de parvenir à une société fondamentalement réorganisée[2].
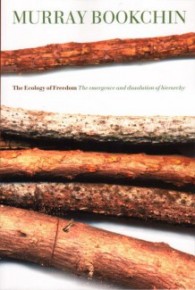 Si l’on voulait résumer l’idéal politique de Murray Bookchin, ce serait une société radicalement décentralisée et démocratisée, précisément sous une forme plus directe et participative. Dans cette vision refusant les fonctionnements hiérarchiques, la définition des choix politiques n’est pas réservée à des politiciens professionnels opérant dans le cadre d’une représentation parlementaire et d’un appareil étatique. Elle doit être davantage le résultat du travail d’assemblées citoyennes capables à la fois de conserver un ancrage local mais aussi de s’organiser sous une forme fédérative. Les relations y seraient plus directes et chacun pourrait apporter sa contribution. Pour Murray Bookchin, la direction à suivre est celle d’une réduction de la taille des collectifs : « The Greeks, we are often reminded, would have been horrified by a city whose size and population precluded face-to-face, familiar relationships among citizens. Today there is plainly a need to reduce the dimensions of the human community—partly to solve our pollution and transportation problems, partly also to create real communities »[3]. Il s’agit ainsi de faire en sorte que des processus collectifs puissent fonctionner en restant proches de l’échelle humaine, celle d’individus pouvant continuer à les comprendre et à s’y insérer.
Si l’on voulait résumer l’idéal politique de Murray Bookchin, ce serait une société radicalement décentralisée et démocratisée, précisément sous une forme plus directe et participative. Dans cette vision refusant les fonctionnements hiérarchiques, la définition des choix politiques n’est pas réservée à des politiciens professionnels opérant dans le cadre d’une représentation parlementaire et d’un appareil étatique. Elle doit être davantage le résultat du travail d’assemblées citoyennes capables à la fois de conserver un ancrage local mais aussi de s’organiser sous une forme fédérative. Les relations y seraient plus directes et chacun pourrait apporter sa contribution. Pour Murray Bookchin, la direction à suivre est celle d’une réduction de la taille des collectifs : « The Greeks, we are often reminded, would have been horrified by a city whose size and population precluded face-to-face, familiar relationships among citizens. Today there is plainly a need to reduce the dimensions of the human community—partly to solve our pollution and transportation problems, partly also to create real communities »[3]. Il s’agit ainsi de faire en sorte que des processus collectifs puissent fonctionner en restant proches de l’échelle humaine, celle d’individus pouvant continuer à les comprendre et à s’y insérer.
Loin d’être incompatible avec les perfectionnements technologiques accumulés dans l’histoire humaine, un tel projet pourrait même, selon lui, en tirer parti et y trouver des éléments pour le faciliter[4]. Devant la dynamique d’industrialisation telle qu’elle avait pu se dérouler, Murray Bookchin avait une position critique, mais il percevait dans les évolutions technologiques, par exemple l’informatisation, un potentiel permettant d’amener vers une société plus décentralisée et où la part de labeur individuel pourrait être largement diminuée[5]. À le suivre, les avancées en matière d’ingénierie et d’informatique, la tendance à la miniaturisation, permettraient de faire évoluer la production industrielle en la faisant passer à une échelle plus réduite, autrement dit sans avoir besoin de recourir à de grosses unités. L’enjeu ne serait plus tellement de libérer l’humanité du besoin, puisque la technologie le permettrait, mais d’utiliser ce potentiel pour aider à améliorer les relations entre humains et avec la nature. Les conditions dans lesquelles se trouve l’humanité pourraient ainsi être changées positivement grâce à des développements technologiques, même comme ceux de l’automatisation.
Ces développements technologiques contiendraient une nouvelle promesse, plus qualitative que quantitative, ouvrant vers une réalisation de la liberté humaine, pouvant elle-même être désormais inscrite dans une « écocommunauté »[6]. Le système qui s’était développé sur un modèle hiérarchique et centralisateur pourrait ainsi être remplacé (au moins dans une très large partie) par un autre, plus coopératif, nourri des liens locaux directs, et au total plus favorable à une réalisation équilibrée des besoins humains : « I do not claim that all of man’s economic activities can be completely decentralized, but the majority can surely be scaled to human and communitarian dimensions. This much is certain: we can shift the center of economic power from national to local scale and from centralized bureaucratic forms to local, popular assemblies. This shift would be a revolutionary change of vast proportions, for it would create powerful economic foundations for the sovereignty and autonomy of the local community »[7].
L’abondance dans la version transhumaniste
Largement construit autour d’un optimisme technophile, le courant transhumaniste a aussi tendance à promettre une forme d’abondance, mais en relation avec une transformation radicale de la manière de concevoir l’humain. Ce mouvement, qui continue à étendre ses ramifications internationales (mais suscite pourtant encore assez peu d’études en science politique), est assis sur la conviction que les avancées scientifiques et techniques peuvent être un moyen et une occasion de transcender les contraintes et limites subies par l’humanité, spécialement celles qui pouvaient jusque-là être considérées comme « naturelles »[8]. Autrement dit, dans cet esprit, c’est la condition humaine qui pourrait, voire devrait, être améliorée grâce à la libération des potentialités de la technologie. Pour les tenants de ce courant, la production de connaissances est en train d’accélérer et cette accélération doit se poursuivre, ce qui permettrait ainsi de tirer parti des retombées des recherches dans les domaines couramment regroupés derrière l’étiquette NBIC (c’est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, les technologies de l’information et celles touchant la cognition), mais aussi en robotique, en médecine, etc.
Les inspirations se sont largement nourries de spéculations sur des technologies émergentes. K. Eric Drexler, ingénieur américain dont la notoriété s’est construite sur la popularisation et la promotion des nanotechnologies (allant jusqu’à imaginer des « assembleurs » capables d’intervenir au niveau moléculaire), a développé ses réflexions en faisant aussi de ces dernières un vecteur d’une abondance à venir[9]. Dans ce futur anticipé, elles auraient un effet transformateur profond en changeant la manière de concevoir les ressources et de produire les biens dont auraient besoin les humains.
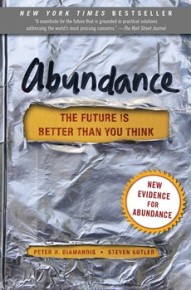 Cette thématique de l’abondance est reprise et défendue par Peter H. Diamandis, cofondateur et dirigeant de la Singularity University dans la Silicon Valley[10]. Dans sa définition : « Abundance is not about providing everyone on this planet with a life of luxury—rather it’s about providing all with a life of possibility. To be able to live such a life requires having the basics covered and then some »[11]. Peter H. Diamandis fonde ses espoirs sur quatre tendances dont les effets s’avéreraient selon lui complémentaires : des technologies qui progresseraient de manière « exponentielle » dans les secteurs informatique, énergétique, etc. ; des innovateurs capables de travailler sur un mode do-it-yourself, sans avoir besoin de passer par des grosses structures, et pour partie grâce à ces technologies ; l’arrivée d’une génération de techno-philanthropes prêts à investir leurs gains dans des grands problèmes de l’humanité ; la possibilité pour des millions de pauvres de se connecter à l’économie globale, par les transports, par Internet, par la micro-finance, etc. Peter H. Diamandis est d’ailleurs aussi le confondateur de Planetary Resources, une société qui prévoit d’aller exploiter des matériaux contenus dans des astéroïdes grâce à des appareils d’exploration robotisés.
Cette thématique de l’abondance est reprise et défendue par Peter H. Diamandis, cofondateur et dirigeant de la Singularity University dans la Silicon Valley[10]. Dans sa définition : « Abundance is not about providing everyone on this planet with a life of luxury—rather it’s about providing all with a life of possibility. To be able to live such a life requires having the basics covered and then some »[11]. Peter H. Diamandis fonde ses espoirs sur quatre tendances dont les effets s’avéreraient selon lui complémentaires : des technologies qui progresseraient de manière « exponentielle » dans les secteurs informatique, énergétique, etc. ; des innovateurs capables de travailler sur un mode do-it-yourself, sans avoir besoin de passer par des grosses structures, et pour partie grâce à ces technologies ; l’arrivée d’une génération de techno-philanthropes prêts à investir leurs gains dans des grands problèmes de l’humanité ; la possibilité pour des millions de pauvres de se connecter à l’économie globale, par les transports, par Internet, par la micro-finance, etc. Peter H. Diamandis est d’ailleurs aussi le confondateur de Planetary Resources, une société qui prévoit d’aller exploiter des matériaux contenus dans des astéroïdes grâce à des appareils d’exploration robotisés.
Dans ces visions et les récits qui les prolongent, l’abondance entrevue résulte d’une confiance dans les possibilités de trajectoires technologiques qui sont prolongées dans un registre futurologique. La question des besoins humains fondamentaux paraît alors résolue puisque ces derniers paraissent satisfaits par une disponibilité presque immédiate des biens souhaités. L’abondance rendrait moins aigus les problèmes d’allocation des ressources (il y aurait moins de concurrence en effet pour y accéder) et la technologie contribuerait à transformer profondément la politique. Par cette dynamique, il ne semble plus alors y avoir de limites dans la capacité à satisfaire les besoins humains.
L’hypothèse est faite (le plus souvent de manière implicite) que ces options technologiques seront largement acceptées par les populations. Peter H. Diamandis semble penser que les solutions et options qu’il soutient feront consensus. Outre des polémiques plus visibles comme sur les nanotechnologies, certains projets ne vont pas cependant sans susciter critiques et controverses, par exemple pour les « fermes verticales » en matière de production alimentaire[12]. Mais l’enthousiasme ne paraît pas réduit pour autant.
Décroissance et reconfigurations localistes
Le courant de la « décroissance » s’est développé autour du projet explicite de sortie d’une « société de croissance »[13]. La croissance est vue à la fois comme un contenu idéologique et l’origine de pressions écologiques de plus en plus difficilement supportables, obligeant donc à une série de transformations sociales radicales et notamment à une « diminution régulière de la consommation matérielle et énergétique, dans les pays et pour les populations qui consomment plus que leur empreinte écologique admissible »[14].
 Ces réflexions amènent aussi à penser le cadre politique nécessaire. Dans cette perspective, s’il s’agit de réduire fortement les niveaux de production et de consommation tout en garantissant une soutenabilité écologique et une justice sociale, l’ensemble du processus doit rester démocratique. Comme le rappelle Valérie Fournier[15], la décroissance tend même à être présentée comme l’occasion d’enclencher discussions et débats sur l’organisation des activités économiques et sociales et de les faire revenir dans un espace de décisions collectives. La décroissance n’est pas censée être imposée comme une nécessité (même si elle est perçue comme telle), mais doit être un choix, à faire dans un cadre démocratique et ouvert publiquement. Le niveau local tend pour cela à être privilégié : il constituerait un espace favorable pour adapter les processus de décision à une plus grande participation et à un contrôle direct, leur donnant ainsi une plus forte légitimité[16].
Ces réflexions amènent aussi à penser le cadre politique nécessaire. Dans cette perspective, s’il s’agit de réduire fortement les niveaux de production et de consommation tout en garantissant une soutenabilité écologique et une justice sociale, l’ensemble du processus doit rester démocratique. Comme le rappelle Valérie Fournier[15], la décroissance tend même à être présentée comme l’occasion d’enclencher discussions et débats sur l’organisation des activités économiques et sociales et de les faire revenir dans un espace de décisions collectives. La décroissance n’est pas censée être imposée comme une nécessité (même si elle est perçue comme telle), mais doit être un choix, à faire dans un cadre démocratique et ouvert publiquement. Le niveau local tend pour cela à être privilégié : il constituerait un espace favorable pour adapter les processus de décision à une plus grande participation et à un contrôle direct, leur donnant ainsi une plus forte légitimité[16].
Serge Latouche, économiste et figure intellectuelle de la décroissance, privilégie le « localisme » et s’oriente vers la voie de la « revitalisation de la démocratie locale »[17]. Parmi les éléments qu’il articule dans son cadre programmatique, il y en a même un qui pousse explicitement à « relocaliser », à la fois au plan économique (celui de la production) et politique : « Relocaliser s’entend aussi au niveau politique : cela signifie alors s’occuper des affaires publiques à l’échelle de son quartier, organisé en « petite république » »[18]. Ce lien territorial pourrait alors contribuer à un sentiment d’appartenance autour de la préservation d’un bien commun. Cependant, même si une forme de protectionnisme est esquissée, il ne s’agit pas de transformer les relations locales en un microcosme fermé[19].
Cet attrait pour la proximité est largement présent dans le mouvement et chez beaucoup d’auteurs de ce courant. Les formes d’organisation sociale fonctionnant sur des échelles réduites sont ainsi préférées parce qu’elles restent plus directement maîtrisables par leurs participants et qu’elles évitent la prétention de certains acteurs à représenter une masse d’autres rendus silencieux ou passifs par des ensembles trop complexes. Ce qui rejoint et prolonge aussi une inclination à privilégier la décentralisation des processus de décision, présente de longue date dans le mouvement écologiste[20].
Comme pour d’autres projets politique ayant une ambition large, Serge Latouche peut se voir reprocher, s’agissant du sien, de ne pas assez développer les conditions pour le rendre viable et les voies pour le rendre réalisable. Il peut sembler en effet escompter trop facilement des effets d’entraînement : « Dans la mesure où des cercles vertueux ont été enclenchés, où une sphère alternative est bien vivante et se développe, la logique systémique du productivisme trouve pour se déployer un espace toujours plus restreint »[21]. Reste toujours la question de l’articulation entre les initiatives locales, avec leur part d’autonomie, et la capacité à assurer et maintenir des transformations plus larges et plus générales. La décroissance étant surtout une manière de qualifier une phase transitionnelle ou un processus, l’hypothèse plus ou moins implicite est souvent que ces actions locales, si elles se multiplient, peuvent avoir des effets cumulés, jusqu’à amener au changement global souhaité. Ceci supposerait que toutes les populations gardent un haut niveau de sobriété et marquent globalement une forme d’altruisme à l’égard d’autres pouvant être moins favorisées[22].
L‘écosocialisme et la planification comme instrument démocratique
Dans la mesure où elle est une critique du productivisme (y compris celui qui a sévi en URSS), la défense d’un « écosocialisme » peut aussi être interprétée comme une prise de distance par rapport aux logiques d’accumulation et de croissance économique. En France, une forme de théorisation en a été fournie par Michael Löwy (dans le prolongement d’une carrière, comme chercheur au CNRS, marquée par une relation forte avec la pensée marxiste et au croisement de la philosophie et de la sociologie). Dans le schéma qu’il envisage[23], la possibilité d’intégration des aspects écologiques doit pouvoir être coordonnée grâce à une « planification démocratique globale ».
Michael Löwy donne en fait à la démocratie une orientation extensive, incluant ainsi la sphère économique. Il l’expliquait dans un article de 2008[24], où il aborde plus spécifiquement la dimension planificatrice de l’écosocialisme tel qu’il le conçoit : « La conception socialiste de la planification n’est rien d’autre que la démocratisation radicale de l’économie : s’il est certain que les décisions politiques ne doivent pas revenir à une petite élite de dirigeants, pourquoi ne pas appliquer le même principe aux décisions d’ordre économique ? »[25]. Il fait même de la « planification démocratique » une des conditions du socialisme écologique, pour « permettre à la société de définir ses objectifs concernant l’investissement et la production »[26].
Le cadre ne serait donc plus celui de la recherche de profit et du libre jeu du « marché » : « Dans ce sens, l’ensemble de la société sera libre de choisir démocratiquement les lignes productives à privilégier et le niveau des ressources qui doivent être investies dans l’éducation, la santé ou la culture. Les prix des biens eux-mêmes ne répondraient plus aux lois de l’offre et de la demande mais seraient déterminés autant que possible selon des critères sociaux, politiques et écologiques »[27]. Loin d’être assimilée à une contrainte, la planification est associée chez Michael Löwy (s’appuyant sur le théoricien marxiste Ernest Mandel) à une autre forme de liberté, rendue possible par la réduction du temps de travail : « Loin d’être « despotique » en soi, la planification démocratique est l’exercice de la liberté de décision de l’ensemble de la société ; un exercice nécessaire pour se libérer des « lois économiques » et des « cages de fer » aliénantes et réifiées au sein des structures capitaliste et bureaucratique. La planification démocratique associée à la réduction du temps de travail serait un progrès considérable de l’humanité vers ce que Marx appelait « le royaume de la liberté » : l’augmentation du temps libre est en fait une condition de la participation des travailleurs à la discussion démocratique et à la gestion de l’économie comme de la société »[28].
 Dans le modèle politique ainsi conçu, il n’est pas censé y avoir d’organisation centralisatrice, mais plutôt une articulation (plus postulée que véritablement explicitée dans son fonctionnement) entre les niveaux de décision : « De même, il est important de souligner que la planification n’est pas en contradiction avec l’autogestion des travailleurs dans leurs unités de production. Alors que la décision de transformer, par exemple, une usine de voitures en unité de production de bus ou de tramways reviendrait à l’ensemble de la société, l’organisation et le fonctionnement internes de l’usine seraient gérés démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes. On a débattu longuement sur le caractère « centralisé » ou « décentralisé » de la planification, mais l’important reste le contrôle démocratique du plan à tous les niveaux, local, régional, national, continental – et, espérons-le, planétaire, puisque les thèmes de l’écologie tels que le réchauffement climatique sont mondiaux et ne peuvent être traités qu’à ce niveau. Cette proposition pourrait être appelée « planification démocratique globale ». Même à un tel niveau, il s’agit d’une planification qui s’oppose à ce qui est souvent décrit comme « planification centrale », car les décisions économiques et sociales ne sont pas prises par un « centre » quelconque mais déterminées démocratiquement par les populations concernées »[29]. Pour Michael Löwy, il ne s’agit pas d’éliminer la démocratie représentative, mais plutôt de la perfectionner en la complétant : « La planification socialiste doit être fondée sur un débat démocratique et pluraliste, à chaque niveau de décision. Organisés sous la forme de partis, de plates-formes ou de tout autre mouvement politique, les délégués des organismes de planification sont élus et les diverses propositions sont présentées à tous ceux qu’elles concernent. Autrement dit, la démocratie représentative doit être enrichie – et améliorée – par la démocratie directe qui permet aux gens de choisir directement – au niveau local, national et, en dernier lieu, international – entre différentes propositions »[30].
Dans le modèle politique ainsi conçu, il n’est pas censé y avoir d’organisation centralisatrice, mais plutôt une articulation (plus postulée que véritablement explicitée dans son fonctionnement) entre les niveaux de décision : « De même, il est important de souligner que la planification n’est pas en contradiction avec l’autogestion des travailleurs dans leurs unités de production. Alors que la décision de transformer, par exemple, une usine de voitures en unité de production de bus ou de tramways reviendrait à l’ensemble de la société, l’organisation et le fonctionnement internes de l’usine seraient gérés démocratiquement par les travailleurs eux-mêmes. On a débattu longuement sur le caractère « centralisé » ou « décentralisé » de la planification, mais l’important reste le contrôle démocratique du plan à tous les niveaux, local, régional, national, continental – et, espérons-le, planétaire, puisque les thèmes de l’écologie tels que le réchauffement climatique sont mondiaux et ne peuvent être traités qu’à ce niveau. Cette proposition pourrait être appelée « planification démocratique globale ». Même à un tel niveau, il s’agit d’une planification qui s’oppose à ce qui est souvent décrit comme « planification centrale », car les décisions économiques et sociales ne sont pas prises par un « centre » quelconque mais déterminées démocratiquement par les populations concernées »[29]. Pour Michael Löwy, il ne s’agit pas d’éliminer la démocratie représentative, mais plutôt de la perfectionner en la complétant : « La planification socialiste doit être fondée sur un débat démocratique et pluraliste, à chaque niveau de décision. Organisés sous la forme de partis, de plates-formes ou de tout autre mouvement politique, les délégués des organismes de planification sont élus et les diverses propositions sont présentées à tous ceux qu’elles concernent. Autrement dit, la démocratie représentative doit être enrichie – et améliorée – par la démocratie directe qui permet aux gens de choisir directement – au niveau local, national et, en dernier lieu, international – entre différentes propositions »[30].
Les pistes proposées peuvent toutefois paraître relativement générales et Michael Löwy ne descend guère jusqu’aux fonctionnements et aux dispositifs concrets de cette planification. Il reste un flou sur les acteurs qui feraient ce travail. Mais ce ne semble plus être des institutions étatiques, comme chez Dominique Méda, où, dans le prolongement d’une critique de la croissance, il est également proposé de « Planifier la transition vers un monde désirable et juste », en conservant une part de confiance dans l’État pour assumer ce type de tâche[31].
On sait que la planification suppose des dispositifs compliqués à mettre en place et, de fait, elle a historiquement rencontré de nombreuses critiques et difficultés pratiques, que son association avec l’ambition d’un « développement durable » a d’ailleurs contribué à réveiller[32]. Il y a ainsi la vieille question de la disponibilité des informations nécessaires pour réaliser cette planification, a fortiori dans des contextes marqués par l’incertitude. Les manières dont peuvent s’organiser les pratiques de communication jouent également un rôle important dans le déroulement de ce genre de processus[33]. Les capacités à faire rentrer les évolutions sociales dans des trajectoires programmées peuvent paraître limitées et ont, de fait, été mises en doute sous des angles variés.
Conclusion à suivre…
___________________________________
[1] En repartant à nouveau de l’expression retravaillée par Gilles Deleuze, qui avait résumé ainsi sa perspective : « D’abord, une société nous semble se définir moins par ses contradictions que par ses lignes de fuite, elle fuit de partout, et c’est très intéressant d’essayer de suivre à tel ou tel moment les lignes de fuite qui se dessinent » (Entretien entre Gilles Deleuze et Antonio Negri, reproduit sous le titre « Contrôle et devenir » dans Pourparlers, Paris, Ed. de Minuit, 1990, p. 232).
[2] Cf. Post-Scarcity Anarchism, Montreal/Buffalo, Black Rose Books, 1986.
[3] « Ecology and Revolutionary Thought », in Post-Scarcity Anarchism, ibid., p. 101.
[4] Cf. Damian F. White, « Post-Industrial Possibilities and Urban Social Ecologies: Bookchin’s Legacy », Capitalism Nature Socialism, vol. 19, n° 1, March 2008, p. 75-76.
[5] Cf. « Towards a liberatory technology », in Post-Scarcity Anarchism, op. cit. ; Remaking Society. Pathways to a Green Future, Boston, South End Press, 1990.
[6] « Towards a liberatory technology », in Post-Scarcity Anarchism, op. cit., p. 116.
[7] « Towards a liberatory technology », in Post-Scarcity Anarchism, op. cit., p. 134.
[8] Pour une présentation, voir par exemple « 4. Transhumanism and the Future », in Michael S. Burdett, Eschatology and the Technological Future, Oxon, Routledge, 2014.
[9] Cf. K. Eric Drexler, Engines of Creation: The Coming Era of Nanotechnology, New York, Doubleday, 1986 ; K. Eric Drexler, Radical Abundance: How a Revolution in Nanotechnology Will Change Civilization, New York, PublicAffairs, 2013.
[10] L’organisation présente ainsi sa mission sur son site Internet : « to educate, inspire and empower leaders to apply exponential technologies to address humanity’s grand challenges » (http://singularityu.org/, consulté le 24 mai 2015).
[11] Peter H. Diamandis, Steven Kotler, Abundance. The Future Is Better Than You Think, New York, Free Press, Reprint edition, 2014, p. 13.
[12] Voir par exemple « Vertical farming: Does it really stack up? », The Economist, December 9, 2010, http://www.economist.com/node/17647627
[13] Pour une présentation rapide, voir François Schneider, Giorgos Kallis, and Joan Martinez-Alier, « Crisis or opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction to this special issue », Journal of Cleaner Production, vol. 18, n° 6, April 2010, pp. 511-518.
[14] Nicolas Ridoux, La Décroissance pour tous, Lyon, Parangon, 2006, p. 91.
[15] Valérie Fournier, « Escaping from the economy: the politics of degrowth », International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 28, n° 11/12, 2008, p. 535-536.
[16] Claudio Cattaneo, Giacomo D’Alisa, Giorgos Kallis, Christos Zografos, « Degrowth futures and democracy », Futures, vol. 44, n° 6, August 2012, p. 521.
[17] Serge Latouche, Le pari de la décroissance, Paris, Fayard, 2006.
[18] Ibid., p. 207.
[19] Serge Latouche, Petit traité de la décroissance sereine, Paris, Ed. Mille et une nuits, 2007.
[20] Cf. Robert Paehlke, « Espace biophysique et sens des proportions : pour une politique environnementale à la bonne échelle », in Edward A. Parson (dir), Gérer l’environnement : défis constants, solutions incertaines, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2001, pp. 79-130.
[21] Le pari de la décroissance, op. cit., p. 109.
[22] Cf. Jin Xue, « Is eco-village/urban village the future of a degrowth society? An urban planner’s perspective », Ecological Economics, Volume 105, September 2014, p. 135. L’auteur recommande en fait d’intégrer et de combiner la participation et la délibération aux échelles locales avec une forme hiérarchique et centralisée de planification (ibid., p. 136).
[23] Cf. Michael Löwy, Écosocialisme. L’alternative radicale à la catastrophe écologique capitaliste, Paris, Fayard/Mille et une nuits, 2011.
[24] Michael Löwy, « Écosocialisme et planification démocratique », Ecologie & politique, 3/2008 (n° 37), pp. 165-180.
[25] Ibid., p. 169-170.
[26] Ibid., p. 165-166.
[27] Ibid., p. 169.
[28] Ibid., p. 169.
[29] Ibid., p. 170-171.
[30] Ibid., p. 171.
[31] Dans son livre La Mystique de la croissance. Comment s’en libérer (Paris, Flammarion / Champs, 2014), c’est ce qui apparaît résumé dans le titre du chapitre 17 : « Planifier la transition vers un monde désirable et juste : où il est mis en évidence qu’un rôle éminent incombe à l’État dans le pilotage de la reconversion écologique ».
[32] En guise de synthèse des arguments, voir par exemple James Meadowcroft, « Planning for sustainable development: Insights from the literatures of political science », European Journal of Political Research, vol. 31, n° 4, June 1997, pp. 427–454 et James Meadowcroft, « Planning for sustainable development: what can be learned from the critics? », in Michael Kenny and James Meadowcroft (eds), Planning Sustainability, London, Routledge, 1999.
[33] Cf. Patsy Healey, « Planning through Debate: The Communicative Turn in Planning Theory », The Town Planning Review, vol. 63, n° 2, Apr. 1992, pp. 143–162.
 Dans ces visions, le citoyen tend au surplus à être considéré comme pouvant être dans une position presque constamment active, avec une implication vigoureuse dans les affaires collectives (ce qui se rapproche de ce que Benjamin R. Barber appellerait une « démocratie forte »[6]). Une condition serait toutefois que ce citoyen dispose de plus de temps libre (pour pouvoir en consacrer aux affaires collectives) et soit moins absorbé par le travail. Jacques Ellul le soulignait déjà il y a quelques décennies : « Tant que celui-ci n’est préoccupé que de sa sécurité, de la stabilité de sa vie, de l’accroissement de son bien-être, nous ne devrons avoir aucune illusion, il ne trouvera nulle part la vertu nécessaire pour faire vivre la démocratie. Dans une société de consommateurs, le citoyen réagira en consommateur »[7].
Dans ces visions, le citoyen tend au surplus à être considéré comme pouvant être dans une position presque constamment active, avec une implication vigoureuse dans les affaires collectives (ce qui se rapproche de ce que Benjamin R. Barber appellerait une « démocratie forte »[6]). Une condition serait toutefois que ce citoyen dispose de plus de temps libre (pour pouvoir en consacrer aux affaires collectives) et soit moins absorbé par le travail. Jacques Ellul le soulignait déjà il y a quelques décennies : « Tant que celui-ci n’est préoccupé que de sa sécurité, de la stabilité de sa vie, de l’accroissement de son bien-être, nous ne devrons avoir aucune illusion, il ne trouvera nulle part la vertu nécessaire pour faire vivre la démocratie. Dans une société de consommateurs, le citoyen réagira en consommateur »[7].