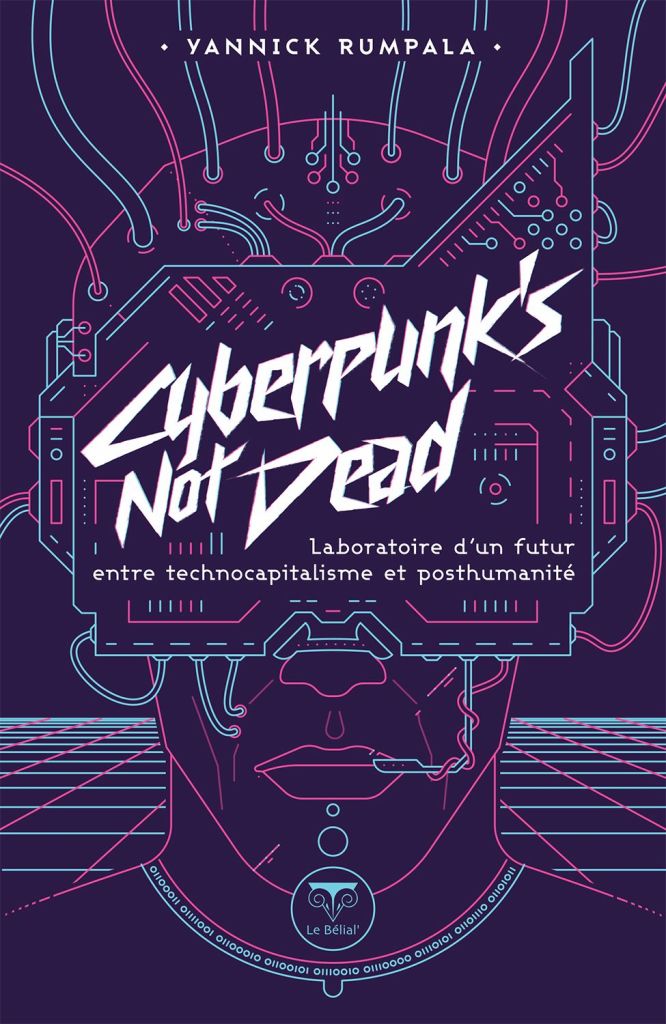Comme spécialiste de ce qu’on appelle en science politique l’analyse des politiques publiques, et notamment des politiques environnementales, je suis lassé, voire profondément agacé, par les débats caricaturaux et analyses hâtives qui agitent en ce moment les plus grands médias sur la dénommée « taxe carbone ». Comme souvent, les arguments y prennent surtout la forme de raccourcis, dont certains paraissent même habilement entretenus pour nourrir les polémiques. Il y en a notamment un qui circule abondamment et qu’on retrouve dans tous les espaces sur Internet où il est possible de laisser des commentaires (c’est aussi arrivé sur ce blog). C’est l’argument, avancé de manière presque définitive, qui consiste à dire en gros : de toute manière, cette proposition, ça n’est qu’une simple volonté de « l’Etat » d’augmenter les impôts. Comme si « l’Etat », espèce d’entité homogène dotée d’une rationalité unique, « décidait » soudainement, par une sorte d’opportunisme, de sortir de ses cartons un nouveau prélèvement pour renflouer ses caisses, en profitant de la vague apparente de préoccupation pour les problèmes d’environnement et de climat. Comme souvent, c’est oublier que les processus décisionnels ont une épaisseur historique, sont faits d’importations d’idées, de luttes et de rapports de force, et correspondent à des jeux où certains acteurs peuvent jouer des rôles éloignés de l’image qui leur est couramment prêtée. C »est surtout s’empêcher de voir les logiques qui deviennent dominantes dans l’intervention des institutions publiques et qui sont plus économiques que simplement fiscales. Pour resituer cette « taxe carbone », un peu de remise en perspective historique et sociologique est donc loin d’être malvenu. Car cette histoire se joue en l’occurrence sur plusieurs décennies.
Avant le début des années 1980, le traitement par l’État des problèmes d’environnement n’accorde que peu de place aux approches économiques pour le choix des instruments d’intervention. C’est surtout à partir de la fin des années 1980 que la stratégie des pouvoirs publics français va avancer de manière plus marquée vers le domaine des incitations économiques et fiscales[1].
Les réflexions correspondantes s’insèrent notamment dans un mouvement de mise en évidence des insuffisances des dispositifs réglementaires et des normes. Un ensemble argumentaire, qui joue comme un soubassement à la promotion de l’instrumentation économique, vient en effet structurer cette remise en cause des démarches fondées sur la réglementation, et bénéficie d’un espace de circulation de plus en plus large dans les réseaux institutionnels intéressés par les questions d’environnement. L’appréhension des limites de ce type d’outils de l’intervention étatique s’effectue le plus souvent dans le registre de l’efficacité, et, singulièrement, de l’efficacité économique. Sous cet angle, la réglementation est vue avec l’inconvénient de ne pouvoir prendre en compte la diversité des situations et d’avoir une composante incitative restreinte, poussant difficilement à dépasser la simple mise en conformité avec les prescriptions établies[2]. « Lourdeur », « rigidité », sont des qualificatifs qui reviennent fréquemment dans les énoncés pour indiquer les limites de l’approche réglementaire[3].
Si le recours aux instruments économiques soulève de moins en moins de résistances dans les cercles politiques et administratifs, c’est notamment parce que ceux-ci font figure de solution face aux carences rencontrées dans les démarches visant à appliquer des règles juridiques aux problèmes environnementaux. Ces difficultés poussent à chercher des mécanismes qui possèderaient une plus grande souplesse que l’approche réglementaire. L’intention générale est de disposer de leviers supposés mieux adaptés pour pouvoir influer sur les comportements jugés préjudiciables pour l’environnement[4].
La solidité que gagne ce type de proposition tient aussi pour une large part à l’élargissement de l’espace de discussion dans lequel cette optique peut être abordée[5]. La question de l’utilité de l’instrumentation économique est perçue comme suffisamment importante dans les milieux politico-administratifs intéressés, et même au delà, pour pouvoir rentrer dans les débats. Le Comité législatif d’information écologique (COLINE) et le CNPF (Conseil national du patronat français) organisent par exemple au Sénat le 23 janvier 1991 un colloque intitulé « Instruments économiques et protection de l’environnement en France et dans l’Europe de 1993 ». À ce colloque sont rassemblés des représentants des administrations, au niveau français mais aussi communautaire, des dirigeants industriels et des responsables associatifs, qui sont conviés à évaluer le coût économique et social des pollutions, ainsi que celui des règles de protection de l’environnement.
Dès qu’ils prennent une dimension programmatique, les discours émanant des sphères politiques ou administratives affirment ainsi de plus en plus fréquemment au début des années 1990 la nécessité d’accorder un rôle plus important à des outils s’appuyant sur des mécanismes économiques. Ces mécanismes sont envisagés de telle sorte qu’ils s’apparentent à des dispositifs d’intéressement. Plus précisément, dans ce schéma, c’est par l’intermédiaire des prix que doivent pouvoir être intéressées les différentes catégories d’agents. D’une part, il s’agit de donner un prix aux biens naturels qui, même utilisés, n’en auraient pas encore un[6]. D’autre part, il s’agit de réduire les biais qui pourraient peser sur la formation des prix, et qui pourraient donc induire des comportements moins favorables à l’environnement[7].
Les instruments économiques tendent ainsi à être associés à des avantages qui coïncident avec les valeurs dominantes dans les communautés de responsables travaillant sur les questions d’environnement. En l’occurrence, cette convergence avec ces valeurs est un critère déterminant qui favorise la survie de ces orientations instrumentales[8]. L’argument d’efficacité, qualité donnée le plus souvent a priori, tient notamment une place prépondérante[9]. Dans le même ordre d’idées, c’est aussi la capacité d’intégration de ces instruments à la dynamique économique qui tend à être mise en avant, les effets de ceux-ci sur ce plan étant considérés comme plutôt positifs[10].
Progressivement, ce répertoire instrumental gagne donc non seulement une crédibilité, mais aussi une légitimité dans les grilles de lecture qui servent de matrices aux décisions. Au Ministère de l’Environnement, l’attention accordée à ce type d’instruments contribue ainsi à impulser des axes de recherche capables de renforcer leur étayage. C’est ce qui vient en effet justifier la priorité donnée à la « micro-économie de l’environnement » au sein du programme élaboré en économie par le Service de la Recherche et des Affaires Economiques[11].
D’ailleurs, l’attrait croissant exercé par les instruments économiques repose sur une problématisation dans laquelle les travaux d’économistes tiennent une place déterminante. Les argumentaires utilisés par les « policy entrepreneurs » souhaitant pousser ce type d’instruments dans l’espace de discussion politico-administratif apparaissent en effet importés plus ou moins directement des analyses avancées dans les « forums scientifiques des économistes »[12]. Les lignes de débat rejoignent ainsi en France des directions qui pouvaient être repérées dans le monde anglo-saxon, en particulier aux Etats-Unis. S’inscrivant dans une perspective similaire, les axes majeurs de raisonnement tendent en effet à mettre l’accent sur les effets pervers que peuvent engendrer les démarches réglementaires, et, par contraste, sur l’avantage qu’il y aurait donc à en diminuer le poids pour privilégier des modes de prise en charge de l’environnement faisant davantage appel au marché.
L’appareillage avancé dans l’espace de discussion politico-administratif repose sur un ensemble de prétentions à la scientificité, tirées notamment des garanties théoriques présentées par la discipline économique. Les argumentations recommandant l’utilisation d’instruments économiques prennent en effet appui, de manière plus ou moins directe et affichée, sur la théorie néo-classique des externalités[13]. En cela, elles tendent d’ailleurs à prolonger les orientations dominantes de la réflexion économique en matière d’environnement, laquelle peut être sommairement décrite comme une extension et une application de la théorie économique néo-classique aux problèmes environnementaux[14].
La logique à l’œuvre dans ce schéma d’appréhension est essentiellement celle de l’optimisation, appliquée à l’utilisation des ressources naturelles disponibles[15]. Elle débouche généralement sur une remise en cause des solutions en vigueur, dans la mesure où celles-ci privilégient ordinairement les voies réglementaires et administratives, critiquées pour leur insuffisance sur le plan incitatif et même soupçonnées d’être une source de dysfonctionnements et d’inefficacités. La méthode économique tend en revanche à être présentée comme un moyen de remédier aux inconvénients de ces approches : par le jeu des dynamiques incitatives, elle doit permettre de réaliser les objectifs environnementaux en minimisant par la même occasion les coûts supportés par la collectivité.
C’est ce potentiel d’incitation qui suscite les principaux espoirs chez les responsables politiques et administratifs intéressés. Le caractère « économique » de cette dernière catégorie d’instruments tient au fait qu’ils opèrent sur un terrain où le médium monétaire occupe une position centrale. Dans ce type de programme d’action, c’est en effet par le médium que constitue l’argent[16] que la régulation doit s’effectuer : une fois le dispositif mis en place, les décisions restent au niveau des agents économiques, cette méthode étant notamment supposée améliorer leur efficacité. Sous cet angle, les dispositifs fiscaux doivent ainsi permettre d’ajuster les comportements, de stimuler l’innovation technologique dans un sens favorable à l’environnement, d’inciter au renouvellement des produits pour répondre à cette nouvelle exigence. Ce qui est recherché, c’est un « signal économique », qui puisse faire jouer les incitations monétaires escomptées par les promoteurs de ce type d’instruments. Toute une série d’hypothèses est en fait présente de manière sous-jacente dans cette démarche : des hypothèses sur les déterminants de l’activité humaine, sur ce qui fonde l’identité des agents économiques, en l’occurrence sur leur penchant à privilégier la maximisation de leur intérêt. L’attention est ici clairement centrée sur des principes économiques, s’éloignant donc d’autres démarches de responsabilisation qui auraient pu faire appel au registre éthique. De manière concomitante, la logique dominante est davantage celle de l’efficacité de fonctionnement du système économique.
Les directions suivies en France sur la question des instruments économiques montrent d’ailleurs aussi l’influence importante des travaux engagés sous l’égide de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) dans le domaine de l’environnement. Le recours à ce type d’instrumentation est en effet une approche pour laquelle cette organisation internationale a consenti un effort important et constant, à la fois sur le plan de la recherche et des recommandations. C’est une orientation qui est en fait adoptée dès le début des années 1970. La conception d’instruments utilisant le principe pollueur-payeur est ainsi promue dans une recommandation de l’OCDE de 1972[17].
Dans les années 1970 et 1980, l’OCDE va continuer à mettre en avant les vertus du principe pollueur-payeur, et va, de manière plus générale, pousser au développement d’instruments économiques permettant d’intégrer les coûts provenant des nuisances et pollutions dans le fonctionnement du marché[18]. Le recours à ce type d’instruments est encouragé lors de la Conférence de 1984 de l’OCDE sur « L’environnement et l’économie ». Ces instruments économiques sont à nouveau présentés comme une démarche indispensable par le Comité de l’Environnement de l’OCDE, lors de la réunion des 30 et 31 janvier 1991 à Paris, pour que les politiques d’environnement puissent être véritablement efficaces, en l’occurrence en s’appuyant sur les mécanismes du marché. Les directions permettant de mettre en œuvre ces instruments sont notamment précisées dans une « Recommandation relative l’utilisation des instruments économiques dans les politiques de l’environnement », adoptée alors par les ministres de l’environnement des pays membres[19].
L’influence des travaux et orientations de l’OCDE se retrouve notamment dans les nombreuses références faites dans les documents administratifs et politiques français touchant aux problématiques environnementales[20]. Ceci est particulièrement visible dans les ouvrages de l’administration de l’Environnement axés sur les aspects économiques (comme les Données économiques de l’environnement). Les réflexions émanant de l’OCDE permettent aussi à des acteurs travaillant dans la sphère politique d’étayer leur argumentation. Décrivant les mérites du principe pollueur payeur, Michel Barnier, dans son Rapport d’information sur la politique de l’environnement présenté en avril 1990, fait ainsi référence à l’ouvrage de l’OCDE Instruments économiques pour la protection de l’environnement[21]. Le sénateur Bernard Hugo, dans son Rapport d’information sur les aspects économiques des politiques d’environnement, renvoie aux « nombreuses recommandations d’emploi des instruments économiques émanant, en particulier, de l’OCDE »[22], et notamment à l’ouvrage intitulé Politique de l’environnement. Comment appliquer les instruments économiques[23].
Les réseaux institutionnels intéressés en France par cette approche économique pour aborder les questions d’environnement tendent à s’inscrire dans un mouvement qui dépasse largement l’échelon national. Les discussions engagées dans les cercles internationaux témoignent d’intentions de plus en plus répandues de recourir à des instruments économiques pour réaliser des objectifs environnementaux[24]. L’Agenda 21, adopté en juin 1992 lors de la conférence des Nations unies sur l’environnement et le développement à Rio de Janeiro, préconise ainsi de développer l’utilisation de ces instruments pour permettre l’organisation de politiques intégrées (chapitre 8, section C : « Utilisation efficace d’instruments économiques et d’incitations, notamment les incitations de marché »).
Il faut d’ailleurs noter que si cette progression des instruments économiques dans les répertoires d’action étatiques n’est pas propre à la France, elle n’est pas non plus une spécificité des politiques d’environnement. Le recours aux dispositifs économiques incitatifs et à l’initiative privée se développe dans d’autres domaines que l’environnement, suivant en cela une évolution qui s’étend bien au delà du cadre national et qui rejoint dans une certaine mesure des courants d’idées favorables aux déréglementations.
Cette volonté diffuse d’accorder une place croissante aux instruments économiques dans les dispositifs publics traitant de l’environnement peut être considérée comme un autre versant du discours prétendant réconcilier l’économie et l’écologie. Le glissement des problématiques environnementales vers un cadre d’appréhension dominé par les considérations économiques a ainsi pour effet concomitant de remodeler les répertoires de propositions sur lesquels les entrepreneurs politiques concernés pensent pouvoir trouver des solutions.
 Pour des éléments d’analyse plus développés, je renvoie à nouveau à mon livre (Régulation publique et environnement. Questions écologiques, réponses économiques, L’Harmattan, 2003), en signalant l’importance du sous-titre. Et, pour ceux qui seraient intéressés par une lecture plus rapide et plus ciblée, mettant notamment en avant le rôle des idées économiques dans la manière de construire les problèmes et leurs solutions, je remets en référence un article paru dans L’Année de la régulation en 2004 et qui peut être téléchargé ici.
Pour des éléments d’analyse plus développés, je renvoie à nouveau à mon livre (Régulation publique et environnement. Questions écologiques, réponses économiques, L’Harmattan, 2003), en signalant l’importance du sous-titre. Et, pour ceux qui seraient intéressés par une lecture plus rapide et plus ciblée, mettant notamment en avant le rôle des idées économiques dans la manière de construire les problèmes et leurs solutions, je remets en référence un article paru dans L’Année de la régulation en 2004 et qui peut être téléchargé ici.
[1] Les instruments économiques sont couramment classés en quatre types :
– les taxes et redevances ;
– les droits d’émission (ou permis) négociables ;
– les instruments financiers (aides et subventions) ;
– les systèmes de dépôt-consignation.
[2] C’est l’argument qu’avait repris par exemple le député Michel Barnier pour montrer que l’application d’une réglementation protectrice de l’environnement est « souvent génératrice de lourdeurs et d’inefficacité » : « La réglementation est par nature générale, elle ne tient pas compte de l’inégalité du coût des investissements de dépollution ou de protection de la nature pour les différents acteurs. Elle alourdit, peut-être, à l’excès le coût de certaines activités ou de certains procédés de production, mais dès lors que d’autres activités ou d’autres procédés sont conformes aux normes qu’elle édicte, toute incitation à aller plus loin encore dans la protection de l’environnement disparaît. Et ce, même si, pour aller au delà des obligations réglementaires, la dépense à consentir est très faible » (« Economie et écologie », Revue des deux mondes, juillet-août 1990, p. 54).
[3] Cette orientation langagière et l’argumentation dans laquelle elle s’insère peuvent ainsi être retrouvées dans le n° 603 des Notes Bleues (« Croissance et environnement », semaine du 27 juillet au 2 août 1992) du Ministère de l’Economie et des Finances : « La réglementation présente en outre des inconvénients qui dépassent le seul fait qu’elle puisse être mal calibrée par rapport aux effets environnementaux visés. Elle introduit des rigidités qui limitent l’efficacité du secteur productif » (p. 12 ; la typographie reprend celle du texte cité). Ce numéro, préparé par la Direction de la Prévision, « examine sous l’angle de l’efficacité les différents instruments de protection de l’environnement » (ibid., p. 1). Un décalque de cet argumentaire figure également dans un article de Xavier Delache et Sylviane Gastaldo (« Les instruments des politiques d’environnement », Economie et Statistique, n° 258-259, oct.-nov. 1992), avec des formulations à peine modifiées. Ceux-ci veulent souligner que : « Les réglementations, même les mieux définies, ne sont pas efficaces économiquement » (ibid., p. 29). Xavier Delache, qui était à la Direction de la Prévision au moment de la rédaction de l’article, sera chargé de mission au sein du cabinet de Ségolène Royal, s’occupant notamment des questions d’emploi, d’économie de l’environnement et de prospective.
[4] Face aux limites de la méthode réglementaire, Michel Barnier préfère ainsi recourir « autant qu’il est possible à l’autre méthode, celle qui consiste à influencer les comportements par des moyens économiques » (« Economie et écologie», in Revue des deux mondes, juillet-août 1990, p. 54). Dans le même sens, voir « L’instrument réglementaire doit être complétée par le recours à des outils économiques et fiscaux », in Rapport d’information (n° 2074), déposé en application de l’article 145 du Règlement par la commission des affaires étrangères sur l’Europe de l’environnement, et présenté par Mme Marie-Noëlle Lienemann et M. Roland Nungesser, enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 mai 1991, p. 8.
[5] John W. Kingdon remarque de manière similaire que plus une proposition est discutée, plus elle est prise en compte sérieusement (Cf. « The Emerging Consensus: Of Bandwagons and Tipping », in Agendas, Alternatives and Public Policies, New York, HarperCollins College Publishers, 2nd Edition, 1995, p. 139-141).
[6] C’est une direction prônée dans la plaquette qui tire le bilan de l’action du Ministère de l’Environnement sous l’impulsion de Ségolène Royal : « Si la réglementation est indispensable au contrôle des risques d’atteinte à la santé humaine ou aux milieux naturels fragiles, le recours aux incitations économiques et fiscales doit être étendu. Il permet en effet d’intégrer durablement la protection de l’environnement au comportement des entreprises et des consommateurs en donnant un prix à l’usage de ce patrimoine » (« développer les incitations et la fiscalité écologique », in Ministère de l’Environnement, Ségolène Royal, une année d’actions pour la planète, p. 10).
[7] Cette orientation peut être retrouvée au niveau européen, dans le « Programme communautaire de politique et d’action pour l’environnement et le développement durable et respectueux de l’environnement » : « Les instruments économiques et fiscaux devront prendre une place de plus en plus grande parmi les moyens utilisés pour obtenir des prix qui reflètent la réalité de tous les coûts, pour faire jouer les incitations basées sur les mécanismes du marché ou pour susciter un comportement économique qui soit également écologique » (« Approche économique : vers de vrais prix », in Vers un développement soutenable, Luxembourg, Office des publications officielles des Communautés européennes, 1993, p. 105).
[8] Cf. John W. Kingdon, « Value Acceptability », in Agendas, Alternatives and Public Policies, op. cit., p. 132 et s.
[9] De manière symptomatique, c’est un registre de justification particulièrement présent dans le compte-rendu des travaux de l’atelier « Environnement, économie, croissance », majoritairement composé d’économistes, de la Commission « Environnement, qualité de vie, croissance » du XIe Plan : « Néanmoins, en l’état actuel des instruments utilisés, il paraît souhaitable d’accroître le recours aux instruments économiques ; en particulier le recours aux redevances, péages et taxes à finalité incitative devrait être plus fréquemment envisagé, tant en raison de leurs propriétés d’efficacité économique que de leur capacité à constituer un contexte plus favorable à l’action des autres types d’instruments » (« Quelles actions prioritaires ? », in Commissariat Général du Plan, L’économie face à l’écologie, Paris, La Découverte / La Documentation française, 1993, p. 105).
[10] Ce raisonnement est adopté par Michel Barnier : « Alors que la croissance ralentit, l’environnement doit être davantage encore intégré à l’économie. […] Aussi faut-il développer l’application du principe pollueur-payeur et l’usage des instruments économiques et fiscaux, qu’ils soient incitatifs, répressifs ou générateurs de ressources. Il n’y a donc pas autonomie entre relance économique et dépenses liées à l’environnement via l’Europe, mais bel et bien complémentarité » (« Les atouts de l’environnement », entretien in Revue des deux mondes, octobre 1993, p. 14).
[11] Ceci est explicité dans le bulletin d’information du SRAE : « Si priorité est accordée à ce sous-programme, c’est qu’il convient de banaliser les analyses économiques dans les prises de décision au niveau local (études d’impact en particulier) et c’est qu’il convient d’acclimater dans un pays à forte tradition juridique une culture économique qui rééquilibre en faveur d’instruments économiques (taxes, prestations de service, fiscalité, marchés de droit d’émission, etc.) la panoplie des instruments de la politique de l’environnement où les instruments réglementaires sont actuellement dominants » (« Économie », in Bulletin de Recherche et d’Information Scientifique de l’Environnement, n° 1, 1995, Ministère de l’Environnement / SRAE, p. 21).
[12] L’expression est empruntée à Bruno Jobert (Cf. « Introduction : Le retour du politique », in Le tournant néo-libéral en Europe, sous la direction de Bruno Jobert, Paris, L’Harmattan, 1994, p. 12). Cette tendance semble loin d’être spécifique aux politiques d’environnement. Des liens de plus en plus marqués peuvent être repérés entre les politiques publiques et ce qui se dit dans les « forums professionnels d’experts », notamment d’experts économistes dans un certain nombre de politiques publiques (Cf. Bruno Jobert, « Ambiguïté, bricolages et modélisation. La construction intellectuelle des politiques publiques », in CRESAL, Les raisons de l’action publique, Paris, L’Harmattan, 1993).
[13] Selon le raisonnement, la présence d’externalités perturbe les mécanismes d’allocation des biens et ne permet pas au marché de déboucher sur un « optimum de Pareto ». En matière d’environnement, le cadre théorique dans lequel est traité le problème de l’internalisation des externalités comporte en fait une démarcation entre une tradition héritée de Pigou, favorable à l’intervention de l’État pour corriger les lignes incitatives du marché (Cf. Arthur Cecil Pigou, The Economics of Welfare, London, Macmillan, 1920), et une approche fondée sur le théorème de Coase, privilégiant la négociation directe entre les agents concernés (Cf. Ronald Coase, « The Problem of Social Cost », The Journal of Law and Economics, 3, 1960. Traduction française : « Le problème du coût social », in Économie de l’environnement, sous la direction de Robert et Nancy S. Dorfman, Paris, Calmann-Lévy, 1975). Pour une présentation rapide de ces deux traditions, on peut se reporter à Franck-Dominique Vivien, Économie et écologie, Paris, La Découverte, coll. Repères, 1994, p. 56-66.
[14] Cf. Frank J. Dietz and Jan van der Straaten, « Rethinking Environmental Economics: Missing Links between Economic Theory and Environmental Policy », Journal of Economic Issues, vol. XXVI, n° 1, March 1992, p. 29.
[15] Toutefois, les analyses économiques développées pour les questions d’environnement aboutissent à énoncer que l’optimum social qui peut être mis en évidence ne correspond pas à un niveau de pollution nul.
[16] Cette conception de l’argent comme médium régulateur s’inscrit dans le prolongement de la réflexion de Jürgen Habermas. Sur la logique systémique dans laquelle se développe l’usage de la monnaie, Cf. Théorie de l’agir communicationnel, Tome 2, Paris, Fayard, 1987, p. 186-187
[17] Recommandation du Conseil sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan international, OCDE, 26 mai 1972. L’objectif est notamment d’éviter les subventions qui pourraient amener des distorsions dans le commerce et les investissements internationaux.
[18] Un inventaire des instruments économiques utilisés dans les pays de l’OCDE a d’ailleurs été réalisé. Cf. OCDE, Instruments économiques pour la protection de l’environnement, Paris, Éditions de l’OCDE, 1989
[19] Il y est entre autres préconisé que les pays membres « fassent un usage plus fréquent et plus cohérent des instruments économiques pour compléter ou remplacer d’autres instruments tels que les réglementations, compte tenu des conditions économiques nationales », et qu’ils « travaillent à améliorer l’allocation et l’utilisation efficientes des ressources naturelles et environnementales par l’utilisation d’instruments économiques qui permettent de mieux refléter le coût social de l’utilisation de ces ressources ».
[20] C’est aussi ce qui en fait la force, si l’on suit les analyses de Bruno Latour : « La force de l’énoncé original ne réside pas dans son contenu même, mais de sa présence dans les articles ultérieurs » (« Être cité par les articles qui suivent », in La science en action, Paris, Gallimard, collection Folio/Essais, 1995, p. 105).
[21] op. cit.
[22] Rapport fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification, p. 31.
[23] Paris, OCDE, 1991.
[24] ce qui amène aussi les services du Ministère de l’Environnement à positionner leur discours : « Le recours croissant, au niveau international, à l’instrumentation économique est à l’origine de ce nouveau chapitre » (Cf. « Instruments économiques : extension de l’application du principe pollueur-payeur », in Données économiques de l’environnement, édition 1992-1993, Ministère de l’Environnement, 1994, p. 93).
 La quête de la croissance, souvent traduite par la focalisation sur les chiffres du PIB (Produit Intérieur Brut), est devenue et reste une antienne dans le discours des responsables politiques ayant des prétentions gouvernementales[2]. Il est ainsi fréquemment répété que le manque de croissance aurait des effets négatifs sur l’emploi et permettrait difficilement de réduire le chômage. La croissance est aussi couramment présentée comme une condition nécessaire à la réduction de la pauvreté. Elle paraît donner accès à des « richesses » supplémentaires tout en offrant une manière d’éviter ou de contourner les enjeux de répartition, susceptibles de générer des tensions entre catégories sociales. L’image de la période des « trente glorieuses » est encore largement présente, notamment pour ce qu’elle a paru apporter en termes d’accès accru à des biens de consommation et au confort matériel pour une part étendue des populations.
La quête de la croissance, souvent traduite par la focalisation sur les chiffres du PIB (Produit Intérieur Brut), est devenue et reste une antienne dans le discours des responsables politiques ayant des prétentions gouvernementales[2]. Il est ainsi fréquemment répété que le manque de croissance aurait des effets négatifs sur l’emploi et permettrait difficilement de réduire le chômage. La croissance est aussi couramment présentée comme une condition nécessaire à la réduction de la pauvreté. Elle paraît donner accès à des « richesses » supplémentaires tout en offrant une manière d’éviter ou de contourner les enjeux de répartition, susceptibles de générer des tensions entre catégories sociales. L’image de la période des « trente glorieuses » est encore largement présente, notamment pour ce qu’elle a paru apporter en termes d’accès accru à des biens de consommation et au confort matériel pour une part étendue des populations.