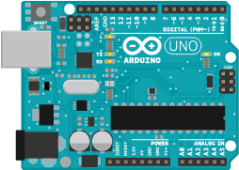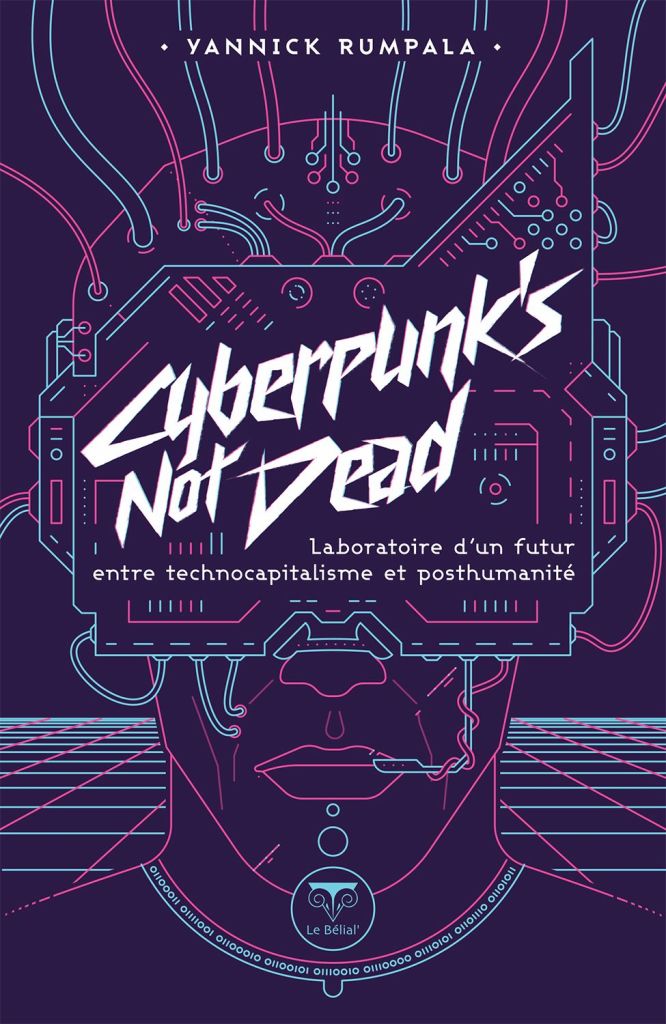Dernier billet de la série et conclusion. L’article complet est disponible dans le dernier numéro (n° 334, octobre 2014) de la Revue internationale de l’économie sociale (RECMA).
* * *
Si le modèle des fab labs et des makerspaces se répand, c’est qu’il séduit (en attirant aussi l’attention des médias, d’ailleurs). Mais, dans la phase actuelle, ce sont encore des espaces interstitiels, dans lesquels un nombre encore réduit d’acteurs est engagé dans des interactions plus ou moins régulières et plus ou moins organisées.
S’il apparaît porteur de potentialités socio-politiques, et pas seulement techniques, le développement des fab labs et makerspaces est toutefois aussi chargé en ambivalences. De tels lieux peuvent être effectivement des intermédiaires facilitant l’accès à la fabrication. Mais quand les grands acteurs industriels et publics manifestent un intérêt à leur égard, c’est souvent avec des schémas intellectuels qui les réinscrivent dans les mêmes logiques de développement économique que celles qui ont marqué la fin du XXe siècle (typiquement à la manière de l’appel à projets engagé sous l’égide du Ministère du Redressement productif). Les expérimentations sont donc aussi exposées à des formes de normalisation.
 Autre question importante : savoir qui finance et comment, car certaines modalités de financement (subventions, partenariats industriels / privés, facturation de services, etc.) peuvent notablement influencer les orientations adoptées et introduire des contraintes, contribuant ainsi à détourner des valeurs originelles. Un tel déplacement peut paraître d’autant plus aisé que, dans ces initiatives, le travail tend à être organisé sur le mode du « projet ». Des motivations qui pouvaient paraître émancipatrices peuvent en définitive se trouver elles aussi canalisées ou absorbées dans la « cité par projet » dont Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) avait repéré le rôle dans l’installation d’un « nouvel esprit du capitalisme », ce qui peut augurer d’une facilité à s’insérer dans un système capitaliste en évolution et en recherche perpétuelle de voies d’adaptation. De fait, le modèle des fab labs permet aussi davantage de flexibilité dans la production et peut être récupéré et instrumentalisé par de grandes organisations industrielles, qui peuvent les exploiter comme des réservoirs (externalisés) non seulement de flexibilité, mais aussi de créativité et d’idées.
Autre question importante : savoir qui finance et comment, car certaines modalités de financement (subventions, partenariats industriels / privés, facturation de services, etc.) peuvent notablement influencer les orientations adoptées et introduire des contraintes, contribuant ainsi à détourner des valeurs originelles. Un tel déplacement peut paraître d’autant plus aisé que, dans ces initiatives, le travail tend à être organisé sur le mode du « projet ». Des motivations qui pouvaient paraître émancipatrices peuvent en définitive se trouver elles aussi canalisées ou absorbées dans la « cité par projet » dont Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) avait repéré le rôle dans l’installation d’un « nouvel esprit du capitalisme », ce qui peut augurer d’une facilité à s’insérer dans un système capitaliste en évolution et en recherche perpétuelle de voies d’adaptation. De fait, le modèle des fab labs permet aussi davantage de flexibilité dans la production et peut être récupéré et instrumentalisé par de grandes organisations industrielles, qui peuvent les exploiter comme des réservoirs (externalisés) non seulement de flexibilité, mais aussi de créativité et d’idées.
Qu’est-ce qui compte alors ? Peut-être pas tellement leur nombre (encore relativement faible), mais l’imaginaire qui est réouvert. Ces espaces portent potentiellement une évolution du rapport aux objets, aux machines, aux savoirs professionnels. Ils contribuent à installer une autre vision des cycles productifs. La production d’artefact ne paraît plus réservée aux usines ou à l’univers industriel, et les participants deviennent coproducteurs ou « prosommateurs » (à la fois producteurs et consommateurs)[1].
Cet accès à une fabrication plus locale est en outre porteur d’un changement du rapport au temps et à l’espace. Sur les deux derniers siècles, la logique industrielle a en effet aussi contribué à organiser non seulement les rythmes de vie et de travail, mais aussi les territoires. Cette logique était devenue une « dimension de la mondialisation », comme le rappelait le sociologue Anthony Giddens : « L’industrie moderne est intrinsèquement basée sur des divisions du travail, non seulement au niveau des tâches, mais aussi de la spécialisation régionale en fonction du type d’industrie, de savoir-faire, et de la production des matières premières » (Giddens, 1994, p. 82).
Avec l’émergence d’un nouveau type de système productif, la domination de l’ordre industriel paraît alors plus incertaine. Et s’il est possible de parler de « système technicien » (Cf. Ellul, 2004), ce dernier apparaît perméable à d’autres logiques que des logiques industrielles, voire laisse entrevoir une nouvelle trajectoire possible (à moins que ce ne soit un nouveau « front pionnier » d’un capitalisme toujours adaptatif, facilitant le développement d’un « agile manufacturing »[2]).
Ce qui s’avère également intéressant, ce n’est pas seulement ce qui est fait dans ces lieux (les productions), mais aussi comment cela est fait (les processus). Les participants mettent en œuvre une éthique (qui n’est pas sans rappeler l’éthique hacker, comme on l’a vu) articulant une série de valeurs, favorisant de fait l’échange et le partage. Dans l’esprit des makerspaces, l’enjeu n’est plus de posséder des moyens de production, mais d’y accéder.
Mais pour y faire quoi ? De nouveaux gadgets ? Le résultat dépendra de la dose de réflexivité qui sera appliquée à des pratiques multiples encore émergentes. D’autant qu’en effet, les technologies numériques ont aussi leur lot de contraintes et qu’en arrière-plan continuera à peser la problématique écologique (Cf. Flipo, Deltour, Dobré, Michot, 2012), avec également son incontournable lot de dépendances, spécialement par rapport aux approvisionnements en ressources matérielles.
________________________________________
[1] Cf. Beaudouin, 2011 ; Ritzer, Dean, Jurgenson, 2012.
[2] Pour un point de vue rapide sur cette notion et une remise en perspective historique, voir par exemple Mourtzis, Doukas, 2014.