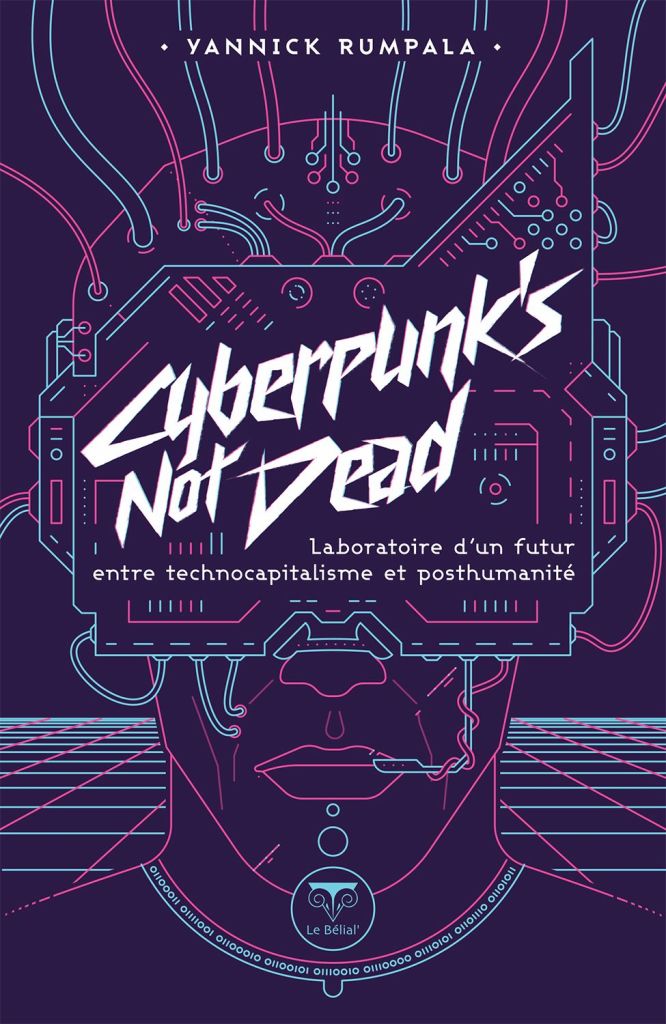Suite des réflexions annoncées dans le billet précédent sur les imprimantes 3D. Je me permets ici de détourner et d’adapter le titre du deuxième chapitre du livre d’Elizabeth L. Eisenstein (The Printing Press As an Agent of Change, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, dont on peut également trouver une version en français).
* * *
Quelles capacités les imprimantes 3D donnent-elles ? Des capacités de fabrication certes, mais dont la répartition sociale semble pouvoir se faire différemment par rapport aux anciens modes industriels. Une technologie peut-elle être alors un vecteur d’émancipation ? La question peut être posée à nouveaux frais. Ces machines peuvent en effet se répandre dans des espaces où elles peuvent permettre des activités renouvelées. Elles trouvent un milieu de soutien qui peut aider à développer leurs potentialités et, en contribuant à éroder les logiques d’une consommation passive, elles pourraient réactiver des formes d’autonomie dans les pratiques individuelles.
Des développements technologiques qui peuvent renouveler les capacités de fabrication
Ces machines attirent[1] parce qu’elles semblent dotées d’un ensemble de propriétés physiques relativement inédites, parce qu’elles proposent des modes relativement nouveaux de fabrication et qu’elles semblent donc capables de faire certaines choses qu’il semblait plus difficile de faire auparavant[2]. Cette technologie fonctionne sur le principe de l’addition, et non du moulage ou de la soustraction. Il ne s’agit pas de retirer du matériau (en meulant ou en fraisant par exemple), mais d’en déposer des couches successives jusqu’à obtenir la forme qui étaient initialement souhaitée. Le modèle est fourni sous forme de fichier numérique, puisque les avancées informatiques permettent que les objets soient désormais « digitalisés ».
 L’intérêt pour les imprimantes 3D s’est accru au fur et à mesure de l’amélioration apparente de la qualité de leurs réalisations et de la baisse de leur coût, qui devient accessible pour un budget individuel ou familial. La gamme de matériaux utilisables semble aussi s’étendre en incluant maintenant différents types de plastiques et de métaux. L’utilisation de cette technologie est même envisagée pour construire des bâtiments et « imprimer » des organes. Certaines imprimantes 3D, comme la RepRap (REPlicating RAPid prototyper)[3], sont conçues pour permettre de refabriquer des modèles identiques à elles-mêmes, grâce à une conception en open source et sur le principe du coût le plus bas possible. Même si elle ne semble pas encore parvenue à maturité, cette technologie peut donc paraître riche en possibilités pour les acteurs qui s’en saisissent.
L’intérêt pour les imprimantes 3D s’est accru au fur et à mesure de l’amélioration apparente de la qualité de leurs réalisations et de la baisse de leur coût, qui devient accessible pour un budget individuel ou familial. La gamme de matériaux utilisables semble aussi s’étendre en incluant maintenant différents types de plastiques et de métaux. L’utilisation de cette technologie est même envisagée pour construire des bâtiments et « imprimer » des organes. Certaines imprimantes 3D, comme la RepRap (REPlicating RAPid prototyper)[3], sont conçues pour permettre de refabriquer des modèles identiques à elles-mêmes, grâce à une conception en open source et sur le principe du coût le plus bas possible. Même si elle ne semble pas encore parvenue à maturité, cette technologie peut donc paraître riche en possibilités pour les acteurs qui s’en saisissent.
Avec le développement de ce type d’outils, l’utilisation et la maîtrise de technologies productives pourrait ne plus être réservée à certains milieux. Cette maîtrise se déplacerait. Ce type de machine ramène des possibilités de fabrication dans la sphère domestique et pour des non-professionnels. Fab@Home, le projet du Cornell Creative Machines Lab (Cornell University), est explicitement conçu dans ce type de perspective, où les ressources techniques offertes doivent pouvoir rencontrer de nouvelles capacités et de nouveaux désirs : « A consumer-oriented fabber, coupled with the networked educational and technical resources already available today, empowers individuals with much of the innovative facility that would otherwise require an entire R&D laboratory. This could potentially lead to economic innovations such as neo-cottage industry manufacturing, an “eBay of designs” where individuals can market unique product designs as digital instructions and material recipes for others to execute on their own fabbers, and millions of people inventing technology rather than merely consuming it »[4]. Le développement des imprimantes 3D n’amènerait donc pas seulement une évolution dans les modes de fabrication, mais pourrait aussi toucher les façons de consommer les objets courants.
Si ces machines se banalisaient, les capacités productives ne seraient plus concentrées, mais distribuées. Pour certains produits, des personnes au départ éloignées des activités de production peuvent espérer rivaliser avec des mondes plus professionnels, au point même de pouvoir réduire leur besoin d’y recourir. Dans certains groupes, il y a une conscience sociale de ces capacités.
Émergence et développement d’un milieu de soutien : Fab labs et communautés d’utilisateurs
Les potentialités de ce type de technologie sont aussi à relier aux bases sociales sur lesquelles elle se développe. Elle doit en effet une large part de son développement à des collaborations en réseaux, qui permettent d’échanger et de partager les idées, de comparer les expériences réalisées. Grâce aux avancées dans le monde du numérique et aux différents canaux disponibles par Internet, cette technologie a ainsi une forte potentialité rhizomatique, dans la manière dont elle peut se diffuser, mais aussi dans la manière dont elle peut se développer en court-circuitant les hiérarchies et subordinations installées, spécialement celles du monde des entreprises.
Dans cette espèce d’espace collaboratif, la capacité à montrer des réalisations joue un rôle important, notamment par le recours à des présentations visuelles avec des photographies et surtout des vidéos présentées sur des sites plus ou moins dédiés. Les objets réalisés à partir d’imprimantes 3D permettent de montrer plus concrètement des possibilités et de donner une crédibilité aux pratiques s’appuyant sur cette technologie. Internet peut alors offrir une audience élargie et aider à la constitution d’un milieu de soutien, fait de relations physiques ou non, et capable de produire un réservoir d’informations et de connaissances. Dans ce moment encore largement expérimental, Internet permet non seulement aux savoir-faire technologiques de circuler, mais aussi d’être discutés et éventuellement complétés. Les personnes intéressées peuvent rapidement trouver des communautés, à l’image de celles formées autour de sites ou de forums, comme Thingiverse, un site qui permet de partager en ligne les fichiers contenant les caractéristiques d’objets plus ou moins utilitaires, ou le forum de Shapeways, une start-up qui propose un service d’impression à la demande. La RepRap a également agrégé autour d’elle une communauté qui permet de trouver des formes d’aide pour l’assemblage de la machine. Il suffit ainsi d’une requête sur n’importe quel moteur de recherche pour accéder rapidement à un « wiki » (http://www.reprap.org/wiki/RepRap) mettant à disposition des informations techniques, voire permettant, pour les plus motivés, de suivre l’évolution du projet et les multiples tentatives d’amélioration.
Dans l’esprit, ces initiatives rejoignent aussi l’espèce de projet également rhizomatique qui a pris forme sous l’étiquette de « fab labs ». Les fabs labs (fabrication laboratories) sont des ateliers orientés vers les nouvelles technologies, mais conçus pour être accessibles à des non-professionnels : ils mettent à disposition des outils avancés, généralement plus facilement disponibles dans le monde industriel, afin que leurs utilisateurs puissent fabriquer leurs propres objets. Inspirée du travail du Professeur Neil Gershenfeld au Massachusetts Institute of Technology (MIT) à la fin des années 1990, l’idée a été reprise dans de nombreux pays[5], avec un intérêt souvent présent et fort pour l’impression 3D.
D’une certaine manière, les fab labs offrent une incarnation à l’idée d’« ateliers vernaculaires », travaillée par des penseurs comme Ingmar Granstedt[6] ou André Gorz. Dans cette rencontre plutôt imprévue, les imprimantes 3D paraissent amener l’outillage qui manquait pour donner un peu plus de corps à l’utopie de « l’autoproduction communale coopérative », à laquelle pensait par exemple André Gorz dans son projet de société[7].
Brouillage des rôles individuels : tous prosommateurs grâce aux imprimantes 3D ?
Si elle pénètre l’univers domestique, une technologie comme l’impression 3D rend possible une autoproduction pour des objets qui seront alors directement appropriables. Ce faisant, elle tendrait à dissoudre davantage les frontières entre activités de production et activités de consommation, comme ont déjà commencé à le faire les innovations informatiques et autres applications numériques[8].
Le terme de « prosommateur » a été proposé et de plus en plus souvent utilisé pour signaler ce genre de phénomène de brouillage au niveau individuel[9]. Les imprimantes 3D pourraient favoriser une nouvelle expression de cette tendance, avec des implications différentes. Avec de telles machines à sa disposition, c’est le consommateur qui peut décider de ce qui va être produit (en fonction de sa capacité à explorer le catalogue des possibilités). Il n’est plus forcément extérieur au cycle productif ; il peut y participer pour les biens qui l’intéressent et, s’il possède des compétences en conception assistée par ordinateur, il peut même apporter sa créativité avec ses propres modifications du produit. Si les caractéristiques de ce produit le permettent, il peut choisir les matériaux utilisés. La gamme de machines disponibles semble même en train de s’élargir, et cette diversification pourrait permettre aux utilisateurs de privilégier des matériels d’impression 3D ayant certaines spécifications, potentiellement plus adaptées à leurs attentes.
 Le fait de fabriquer un objet peut aussi amener un plus grand intérêt pour la manière dont il est conçu[10]. Grâce aux logiciels qui peuvent être associés à l’impression 3D, les utilisateurs peuvent réintervenir sur des éléments de conception et retravailler certaines caractéristiques en fonction de ce qu’ils estiment être leurs besoins ou leurs goûts. L’objet redevient autre chose qu’une « boîte noire », comme le sont aujourd’hui beaucoup de produits ou d’appareils vendus sans qu’il soit possible de les ouvrir ou de les modifier. Derrière son aspect technologique, cet outillage restaure aussi un contact avec la matière (presque) brute et la possibilité de la transformer. De plus, le travail à faire peut paraître plus facile, moins pénible, moins salissant : il est en effet plus facile de manipuler des poudres en vrac ou des résines en cartouches que de débiter du bois ou d’usiner du métal.
Le fait de fabriquer un objet peut aussi amener un plus grand intérêt pour la manière dont il est conçu[10]. Grâce aux logiciels qui peuvent être associés à l’impression 3D, les utilisateurs peuvent réintervenir sur des éléments de conception et retravailler certaines caractéristiques en fonction de ce qu’ils estiment être leurs besoins ou leurs goûts. L’objet redevient autre chose qu’une « boîte noire », comme le sont aujourd’hui beaucoup de produits ou d’appareils vendus sans qu’il soit possible de les ouvrir ou de les modifier. Derrière son aspect technologique, cet outillage restaure aussi un contact avec la matière (presque) brute et la possibilité de la transformer. De plus, le travail à faire peut paraître plus facile, moins pénible, moins salissant : il est en effet plus facile de manipuler des poudres en vrac ou des résines en cartouches que de débiter du bois ou d’usiner du métal.
Les implications pourraient se faire sentir en amont de la chaîne productive. Si accéder à de telles machines devenait aussi facile que d’accéder à un ordinateur personnel, la propriété privée des moyens de production (telle que pouvait la critiquer Karl Marx) pourrait se déplacer, voire pourrait être dissoute. Adrian Bowyer, enseignant à l’Université de Bath et fondateur du projet RepRap, laisse lui-même entrevoir ce type d’horizon. Il parle de « marxisme darwinien » à propos du processus que pourrait enclencher la pleine réalisation de son projet : « So the RepRap project will allow the revolutionary ownership, by the proletariat, of the means of production. But it will do so without all that messy and dangerous revolution stuff, and even without all that messy and dangerous industrial stuff »[11]. C’est en effet une forme d’évolutionnisme qui sélectionnerait les machines les plus appropriées et qui permettrait leur généralisation. Et donc, si on suit un tel raisonnement, avec des conséquences qui affecteraient profondément l’infrastructure économique.
Des machines à autonomiser ? Réappropriation des moyens de production et réouverture de possibilités d’autonomie
Ce type de nouvelle technologie semble offrir des capacités renouvelées (contrôle et maîtrise des techniques utilisées, ouverture aux désirs de créativité, etc.), et surtout permettre de mettre ces capacités dans des espaces sociaux qui paraissaient en avoir été dépossédés. Peut-on alors y voir une forme inédite d’empowerment par la technique ?
L’avantage de ce type de machine, c’est qu’elle peut permettre à chaque individu de retrouver des prises sur sa vie quotidienne, en l’occurrence par les objets. Sa possession ou sa disponibilité dans un environnement proche peut réduire l’angoisse de ne pas pouvoir accéder à certains biens. Grâce à ces techniques, des capacités semblent aussi pouvoir être redonnées à des communautés, à l’image de celles qui se sont qualifiées elles-mêmes de « makers ».
Si on les regarde en reprenant les inspirations d’Ivan Illich[12], ces technologies paraissent offrir des possibilités d’autonomisation, ou au moins elles peuvent redonner des marges d’autonomie. Engagé dans une réflexion critique à l’égard de la société industrielle, Ivan Illich s’inquiétait de ce que la production soit de moins en moins au service des individus et que le rapport se soit même inversé au détriment de ces derniers. La vie humaine aurait ainsi été progressivement assujettie à une forme de production « hétéronome », sur laquelle les consommateurs perdraient tout contrôle alors qu’ils bénéficient apparemment d’une masse croissante de biens et de services. Ce confort apparent se paierait par une dépendance insidieuse, tandis qu’avec une production restée « autonome », chaque personne pourrait garder une maîtrise sur les outils élémentaires aidant à réaliser ses besoins. C’est cette forme « autonome » de production qu’Ivan Illich souhaitait remettre en avant et encourager, comme élément fondamental pour remettre la société sur le chemin de la « convivialité ». Il s’agissait pour lui de restaurer les moyens permettant à tout citoyen de reconquérir la connaissance et l’orientation de ce qui fait sa vie. D’où l’importance des outils, qu’il envisage d’ailleurs dans un sens large, allant des objets matériels jusqu’aux institutions comme l’école, et pour lesquels il a cherché les critères contribuant à assurer cette convivialité. Dans sa conception, les outils conviviaux devraient être privilégiés parce qu’ils ouvrent à la production autonome de valeurs d’usage, plutôt que marchandes. Comme il l’explique : « Tools foster conviviality to the extent to which they can be easily used, by anybody, as often or as seldom as desired, for the accomplishment of a purpose chosen by the user. The use of such tools by one person does not restrain another from using them equally. They do not require previous certification of the user. Their existence does not impose any obligation to use them. They allow the user to express his meaning in action »[13]. Dans la perspective d’Ivan Illich, les outils conviviaux ne renvoient pas forcément à un niveau faible de développement technologique. Ce qu’il vise n’est pas une régression technologique, mais plutôt la sortie des systèmes qui enferment les individus et les rendent dépendants. Pour lui, la société « conviviale » est celle où tous les citoyens, et non les seuls spécialistes, ont un contrôle sur leurs outils, qui restent donc à leur service, et non l’inverse.
De ce point de vue, les imprimantes 3D ont des qualités qui peuvent être mises en avant. Elles peuvent être un moyen pour les individus intéressés de retrouver une forme de maîtrise sur leur existence, en offrant un autre rôle que celui de simples acheteurs de produits. Grâce à ce mode de fabrication personnalisée, la passivité à laquelle sont souvent contraints les consommateurs peut être contournée par la réouverture ou l’élargissement d’espaces de créativité.
Le théoricien anarchiste Murray Bookchin, dans le cadre de son projet d’« écologie sociale », avait aussi cherché à montrer que certaines technologies pouvaient avoir un potentiel « libérateur ». Il aurait peut-être vu dans les imprimantes 3D un exemple de ces machines auxquelles il aspirait, permettant d’arracher la production hors d’appareils industriels de plus en plus imposants et, par la même occasion, de libérer la vie des individus pour d’autres tâches qu’un labeur abrutissant et obligatoire[14]. Si l’on voulait résumer l’idéal politique de Murray Bookchin, ce serait en effet une société radicalement décentralisée et démocratisée. Loin d’être incompatible avec les perfectionnements technologiques accumulés dans l’histoire humaine, un tel projet pourrait même selon lui en tirer parti et trouver des ressources pour le faciliter[15]. Dans son raisonnement, l’enjeu ne serait plus tellement de libérer l’humanité du besoin, puisque le niveau technologique atteint le permettrait, mais d’utiliser ce potentiel pour aider à améliorer les relations entre humains et avec la nature. Il s’agirait alors plutôt de favoriser les innovations technologiques ayant des potentialités libératrices, celles précisément qui sembleraient pouvoir se développer en dehors des logiques du capitalisme industriel.
 L’idée d’une production décentralisée et à petite échelle est aussi notoirement défendue par Ernst Friedrich Schumacher, dont l’argument « small is beautiful » concerne effectivement pour une part importante la dimension technologique[16]. Dans cette perspective, la préférence va aux « technologies appropriées », autrement dit permettant de tenir compte du contexte de leur utilisation et suffisamment simples pour les rendre encore maîtrisables par les populations ou les groupes amenés à les manier.
L’idée d’une production décentralisée et à petite échelle est aussi notoirement défendue par Ernst Friedrich Schumacher, dont l’argument « small is beautiful » concerne effectivement pour une part importante la dimension technologique[16]. Dans cette perspective, la préférence va aux « technologies appropriées », autrement dit permettant de tenir compte du contexte de leur utilisation et suffisamment simples pour les rendre encore maîtrisables par les populations ou les groupes amenés à les manier.
Quelques décennies après leur disparition, la technologie de l’impression en trois dimensions paraît donc offrir une possible voie d’incarnation aux idées d’une série d’auteurs, qui auraient probablement été séduits par ce type d’avancée. Ces machines rendent concevable la possibilité pour la population de se réapproprier des moyens de production. Autrement dit, elles pourraient donner à un très large ensemble d’individus des moyens de produire par eux-mêmes ce qu’ils désirent ou ce dont ils estiment avoir besoin, et au moment où ils le souhaitent en allouant le temps qu’ils souhaitent. Ce serait donc une configuration où les rapports de dépendance seraient notablement transformés, notamment parce que la capacité à produire soi-même ses biens peut réduire la pression à aller chercher un revenu.
[1] Y compris en suscitant un intérêt marqué dans des journaux représentant la pensée économique dominante, comme The Economist. Cf. « The printed world: Three-dimensional printing from digital designs will transform manufacturing and allow more people to start making things », The Economist, Feb. 10th 2011, http://www.economist.com/node/18114221 ; « Solid print: Making things with a 3D printer changes the rules of manufacturing », The Economist, Apr. 21st 2012, http://www.economist.com/node/21552892 . Le New York Times a même parlé de « révolution » (Cf. Ashlee Vance, « 3-D Printing Spurs a Manufacturing Revolution », The New York Times, Published: September 13, 2010, http://www.nytimes.com/2010/09/14/technology/14print.html?ref=ashleevance).
[2] D’où aussi les possibilités de développement de toute une rhétorique pouvant contribuer à construire les mérites et les avantages de cette technologie. Cf. David Michael Sheridan, « Fabricating Consent: Three-Dimensional Objects as Rhetorical Compositions », Computers and Composition, vol. 27, n° 4, December 2010, pp. 249–265.
[3] Pour une présentation des origines et de la conception de cette machine, voir Rhys Jones, Patrick Haufe, Edward Sells, Pejman Iravani, Vik Olliver, Chris Palmer and Adrian Bowyer, « RepRap – the replicating rapid prototyper », Robotica, vol. 29, Special Issue 01, January 2011, pp. 177-191.
[5] Pour une présentation et une remise en perspective du projet, voir Neil Gershenfeld, Fab: The Coming Revolution on Your Desktop–from Personal Computers to Personal Fabrication, New York, Basic Books, 2007.
[6] Cf. Du chômage à l’autonomie conviviale, Lyon, À plus d’un titre, 2007.
[7] Cf. « Crise mondiale, décroissance et sortie du capitalisme », in Ecologica, Paris, Galilée, 2008, p. 121
[8] Cf. Valérie Beaudouin, « Prosumer », Communications, 1/2011 (n° 88), pp. 131-139 ; George Ritzer, Paul Dean, Nathan Jurgenson, « The Coming of Age of the Prosumer », American Behavioral Scientist, vol. 56, n° 4, April 2012, pp. 379-398.
[9] Voir par exemple Ashlee Humphreys, Kent Grayson, « The Intersecting Roles of Consumer and Producer: A Critical Perspective on Co-production, Co-creation and Prosumption », Sociology Compass, vol. 2, n° 3, May 2008, pp. 963–980.
[10] Si l’on fait le lien avec le point de vue de David Gauntlett (Cf. Making is Connecting. The social meaning of creativity, from DIY and knitting to YouTube and Web 2.0, London, Polity, 2011), l’impression 3D ne ferait alors que rejoindre un mouvement plus large.
[12] Cf. Ivan Illich, Tools for Conviviality, London, Calder and Boyars, 1973.
[13] Tools for Conviviality, ibid., p. 22.
[14] Cf. « Towards a liberatory technology », in Post-Scarcity Anarchism, Montreal/Buffalo, Black Rose Books, 1986.
[15] Cf. Damian F. White, « Post-Industrial Possibilities and Urban Social Ecologies: Bookchin’s Legacy », Capitalism Nature Socialism, vol. 19, n° 1, March 2008, p. 75-76.
[16] Cf. Small is Beautiful. A Study of Economics as if People Mattered, London, Blond and Briggs, 1973.
 Autre question importante : savoir qui finance et comment, car certaines modalités de financement (subventions, partenariats industriels / privés, facturation de services, etc.) peuvent notablement influencer les orientations adoptées et introduire des contraintes, contribuant ainsi à détourner des valeurs originelles. Un tel déplacement peut paraître d’autant plus aisé que, dans ces initiatives, le travail tend à être organisé sur le mode du « projet ». Des motivations qui pouvaient paraître émancipatrices peuvent en définitive se trouver elles aussi canalisées ou absorbées dans la « cité par projet » dont Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) avait repéré le rôle dans l’installation d’un « nouvel esprit du capitalisme », ce qui peut augurer d’une facilité à s’insérer dans un système capitaliste en évolution et en recherche perpétuelle de voies d’adaptation. De fait, le modèle des fab labs permet aussi davantage de flexibilité dans la production et peut être récupéré et instrumentalisé par de grandes organisations industrielles, qui peuvent les exploiter comme des réservoirs (externalisés) non seulement de flexibilité, mais aussi de créativité et d’idées.
Autre question importante : savoir qui finance et comment, car certaines modalités de financement (subventions, partenariats industriels / privés, facturation de services, etc.) peuvent notablement influencer les orientations adoptées et introduire des contraintes, contribuant ainsi à détourner des valeurs originelles. Un tel déplacement peut paraître d’autant plus aisé que, dans ces initiatives, le travail tend à être organisé sur le mode du « projet ». Des motivations qui pouvaient paraître émancipatrices peuvent en définitive se trouver elles aussi canalisées ou absorbées dans la « cité par projet » dont Luc Boltanski et Ève Chiapello (1999) avait repéré le rôle dans l’installation d’un « nouvel esprit du capitalisme », ce qui peut augurer d’une facilité à s’insérer dans un système capitaliste en évolution et en recherche perpétuelle de voies d’adaptation. De fait, le modèle des fab labs permet aussi davantage de flexibilité dans la production et peut être récupéré et instrumentalisé par de grandes organisations industrielles, qui peuvent les exploiter comme des réservoirs (externalisés) non seulement de flexibilité, mais aussi de créativité et d’idées.