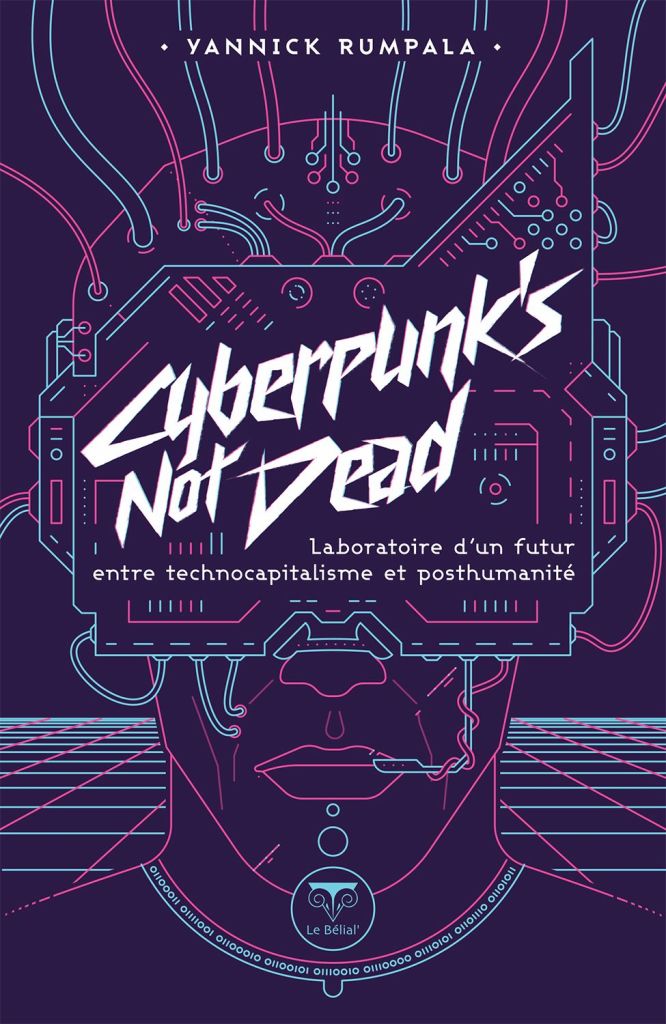Une version de ce billet est aussi parue sur le site theconversation.com dans la rubrique « Spécial COP21 ».
* * *
 Les résultats de la COP 21 susciteront forcément une multitude de commentaires. La grille d’analyse qui risque de s’avérer la plus pertinente pour cette nouvelle conférence (dans le prolongement de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto) est probablement celle qu’Ingolfur Blühdorn avait déjà posée à propos de la COP 15, autre grand rassemblement qui avait eu lieu à Copenhague en décembre 2009. Cet enseignant-chercheur de l’Université de Bath, en Angleterre, avait montré le paradoxe déjà présent dans la quinzième session de la Conférence des Parties. D’un côté, il semble en effet y avoir une large reconnaissance de la nécessité, pour les sociétés de consommation des pays les plus riches, de changer radicalement leurs valeurs et leurs modes de vie si elles prétendent vraiment vouloir enrayer le changement climatique (ou plutôt pour en atténuer les effets, compte tenu de la tendance apparemment largement engagée). D’un autre côté, les réticences sont massives, multiples et telles que finit par dominer l’incapacité à mettre en œuvre un tel changement. Ingolfur Blühdorn a cherché à expliquer cette impasse en s’appuyant sur les conceptualisations de Jean Baudrillard (sur le simulacre qui se fait passer ou qui est pris pour une vérité), et il montre ainsi que ce qui s’est construit est davantage une politique de « non-soutenabilité », où il s’agit, par des jeux d’affichage, de « soutenir l’insoutenable » ou « faire durer le non-durable » (« to sustain the unsustainable »). Autrement dit, de simuler, de faire paraître réel ce qui ne l’est pas : des engagements qui s’avèrent en contradiction avec les pratiques restant dominantes et avec des politiques gouvernementales qui reviendront rapidement aux classiques objectifs de croissance économique. Et en plus, en contribuant à dépolitiser les enjeux environnementaux par leur technicisation, au profit donc d’une expertise qui peut les rendre moins accessibles à une large appréhension par les populations (c’est également pour cela qu’Ingolfur Blühdorn préfère parler de « post-écologisme »). S’il actualise son travail, il pourra ajouter que l’organisation française de la COP 21 aura adjoint la novation sécuritaire en bloquant les manifestations moins institutionnelles qui cherchaient à répercuter les voix de la « société civile ».
Les résultats de la COP 21 susciteront forcément une multitude de commentaires. La grille d’analyse qui risque de s’avérer la plus pertinente pour cette nouvelle conférence (dans le prolongement de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et du protocole de Kyoto) est probablement celle qu’Ingolfur Blühdorn avait déjà posée à propos de la COP 15, autre grand rassemblement qui avait eu lieu à Copenhague en décembre 2009. Cet enseignant-chercheur de l’Université de Bath, en Angleterre, avait montré le paradoxe déjà présent dans la quinzième session de la Conférence des Parties. D’un côté, il semble en effet y avoir une large reconnaissance de la nécessité, pour les sociétés de consommation des pays les plus riches, de changer radicalement leurs valeurs et leurs modes de vie si elles prétendent vraiment vouloir enrayer le changement climatique (ou plutôt pour en atténuer les effets, compte tenu de la tendance apparemment largement engagée). D’un autre côté, les réticences sont massives, multiples et telles que finit par dominer l’incapacité à mettre en œuvre un tel changement. Ingolfur Blühdorn a cherché à expliquer cette impasse en s’appuyant sur les conceptualisations de Jean Baudrillard (sur le simulacre qui se fait passer ou qui est pris pour une vérité), et il montre ainsi que ce qui s’est construit est davantage une politique de « non-soutenabilité », où il s’agit, par des jeux d’affichage, de « soutenir l’insoutenable » ou « faire durer le non-durable » (« to sustain the unsustainable »). Autrement dit, de simuler, de faire paraître réel ce qui ne l’est pas : des engagements qui s’avèrent en contradiction avec les pratiques restant dominantes et avec des politiques gouvernementales qui reviendront rapidement aux classiques objectifs de croissance économique. Et en plus, en contribuant à dépolitiser les enjeux environnementaux par leur technicisation, au profit donc d’une expertise qui peut les rendre moins accessibles à une large appréhension par les populations (c’est également pour cela qu’Ingolfur Blühdorn préfère parler de « post-écologisme »). S’il actualise son travail, il pourra ajouter que l’organisation française de la COP 21 aura adjoint la novation sécuritaire en bloquant les manifestations moins institutionnelles qui cherchaient à répercuter les voix de la « société civile ».
Pour celles et ceux qui souhaiteraient être moins pessimistes, on peut aussi considérer qu’au-delà de la recherche d’un accord, ce type de méga-conférences environnementales peut avoir une pluralité de fonctions, qui peuvent inciter à faire une autre analyse qu’en termes de succès ou d’échec. Au-delà des événements eux-mêmes, qui ont un avant et un après, ces conférences s’inscrivent en effet dans des processus, qui peuvent eux-mêmes être à la jonction de plusieurs temporalités et logiques d’acteurs ; elles contribuent à construire des agendas globaux (orientant alors l’attention vers une même gamme d’enjeux), à diffuser des principes (par exemple le principe de « responsabilités communes mais différenciées », censé introduire une forme d’équité dans le cas des négociations sur le climat), à agencer des instruments d’action (généralement d’une forte technicité et en pratique majoritairement ajustés aux logiques de marché), à légitimer des manières particulières de gouverner les activités humaines au nom des risques écologiques ou climatiques. Je renvoie à un court texte que j’avais écrit à propos de Rio+20, mais qui garde sa pertinence pour la conférence de cette semaine.
La question qui reste est de savoir s’il est encore possible de faire comme si la transformation des systèmes complexes organisant les sociétés humaines pouvait essentiellement passer par des arrangements institutionnels « par le haut », négociés dans des arènes opaques et supposés ensuite pouvoir descendre dans tous les secteurs socio-économiques. D’autant que, dans le travail intergouvernemental pour la COP21, les enjeux énergétiques, pourtant capitaux, ont quasiment été mis en marge des discussions. Le jeu des intérêts est tel que les choix structurants, ceux qui empêchent de changer de trajectoire et spécialement sur les types d’énergie privilégiés, échappent au débat sur la scène officielle. Les reconnexions auraient de fait montré que les questions climatiques, au-delà de l’attention qu’elles ont fini par capter, ne sont que des pièces de problèmes plus larges et qu’on pourrait même qualifier de systémiques. Des engagements évasifs prétendant traiter ces questions climatiques isolément, en faisant à nouveau confiance à un mélange d’innovation technologique (implicitement supposée plus « propre »), de cadrage économique (avec maintenant les tentatives de définition d’un « prix du carbone ») et de gestion politico-bureaucratique (pour au moins assurer le suivi des contributions nationales), ne peuvent que maintenir les ambiguïtés.
Références :
– Ingolfur Blühdorn, « The Politics of Unsustainability: COP15, Post-Ecologism, and the Ecological Paradox », Organization & Environment, vol. 24, n° 1, March 2011, pp. 34-53. URL : http://oae.sagepub.com/content/24/1/34
– Yannick Rumpala, « À quoi peut servir Rio+20 ? », contribution parue sur le site nonfiction.fr, 13 juin 2012. URL : http://www.nonfiction.fr/article-5889-a_quoi_peut_servir_rio20_.htm