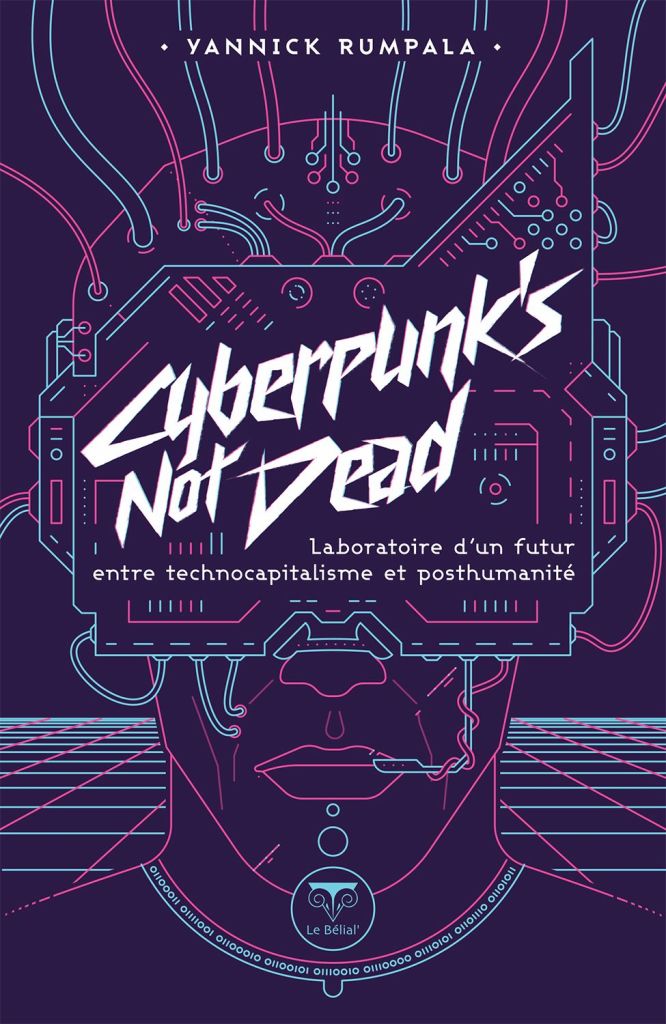Quelques mots et commentaires suite au décès du sociologue allemand Ulrich Beck le 1er janvier dernier. Difficile de ne pas croiser les réflexions du penseur de la « société du risque » quand on s’intéresse aux enjeux écologiques, à leur construction et à leur prise en charge. Ce fut le cas pour mes premières recherches (par exemple sur la qualification de problèmes comme « risques environnementaux » et la tendance institutionnelle à les convertir en problèmes économiques), qui m’avaient amené à discuter ses travaux.
 De fait, la réflexion d’Ulrich Beck a pris une place importante dans le champ des théories abordant la confrontation entre les sociétés contemporaines et les problèmes environnementaux qui leur sont imputables. En 1986, il publiait un ouvrage qui allait devenir majeur sur ce qu’il a appelé la « société du risque » (Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne[1]). Ce livre a ouvert tout un ensemble de discussions sur un large éventail (avec des réflexions qui ne se limitent pas aux questions environnementales, mais qui touchent aussi au travail, aux relations entre sexes, aux trajectoires de vie…), au point de faire désormais figure de classique. Ses autres écrits développant ce thème continuent à susciter de riches débats académiques autour des enjeux environnementaux et de leur prise en charge collective[2].
De fait, la réflexion d’Ulrich Beck a pris une place importante dans le champ des théories abordant la confrontation entre les sociétés contemporaines et les problèmes environnementaux qui leur sont imputables. En 1986, il publiait un ouvrage qui allait devenir majeur sur ce qu’il a appelé la « société du risque » (Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne[1]). Ce livre a ouvert tout un ensemble de discussions sur un large éventail (avec des réflexions qui ne se limitent pas aux questions environnementales, mais qui touchent aussi au travail, aux relations entre sexes, aux trajectoires de vie…), au point de faire désormais figure de classique. Ses autres écrits développant ce thème continuent à susciter de riches débats académiques autour des enjeux environnementaux et de leur prise en charge collective[2].
Les analyses développées par Ulrich Beck ont effectivement un effet stimulant lorsqu’il s’agit d’essayer d’appréhender les changements sociaux qui ont marqué ces dernières décennies, notamment ceux rattachables aux préoccupations de plus en plus diffuses engendrées par les pressions des activités humaines sur les milieux naturels et sur l’humanité elle-même[3]. Ce sont d’ailleurs des changements profonds qu’Ulrich Beck donne à voir, des changements qui mettent en question les soubassements même de la modernité sur laquelle s’est construite la société industrielle. L’argumentation avancée part des contradictions qui opèrent à l’intérieur même du système, assis sur un « progrès » technico-économique qui finit par le faire ployer, au point de le mettre au bord de l’écroulement et de rendre de plus en plus dérisoire l’idée d’une quelconque maîtrise. Pour cela, la perspective d’Ulrich Beck a donné lieu à des commentaires qui l’ont couramment placée en position antagonique par rapport au courant théorique de la « modernisation écologique » : cette perspective sur la « société du risque » est souvent vue comme une description fortement teintée par le pessimisme, notamment parce qu’elle s’avère très sceptique sur le rôle que peuvent prendre la science et la technologie pour surmonter la crise écologique[4]. Les questions soulevées par Ulrich Beck croisaient en tout cas des points importants de mon questionnement et méritaient par conséquent une prise en compte attentive.
Un des traits marquants de la réflexion d’Ulrich Beck se trouve dans sa manière de prendre en considération les enjeux environnementaux. Les menaces pesant sur l’environnement ne sont pas abordées comme un élément périphérique, une donnée secondaire dans une entreprise théorique traitant des évolutions de la société moderne, mais bien comme un facteur central à intégrer pour accéder à la compréhension de ces évolutions[5]. Ulrich Beck met en effet en relief l’installation d’un nouveau contexte, résultant d’une pression croissante sur l’environnement, à la fois quantitativement et qualitativement. De ce point de vue, les détériorations sont d’autant plus inquiétantes qu’elles ont changé de nature : elles sont devenues globales, elles tiennent à l’utilisation de plus en plus large de substances toxiques, et il apparaît probable que certaines de ces détériorations sont irréversibles. À ces risques, dont l’ampleur tient notamment à leur caractère cumulatif, s’ajoutent en outre toutes les catastrophes que peuvent laisser craindre les installations nucléaires, chimiques, les manipulations génétiques. Bref, les risques touchant l’environnement tendent à prendre une dimension qu’ils n’avaient jamais connue auparavant dans l’histoire de l’humanité.
En fait, l’optique d’Ulrich Beck pousse bien plus loin que la description de l’aspect général des menaces engendrées par les processus d’industrialisation, puisqu’il s’agit surtout pour lui de montrer les répercussions que ces menaces peuvent avoir au sein même des orientations de la société industrielle. C’est justement à cause de ces menaces de dimension nouvelle que la société industrielle entre dans une dynamique de changement profond, autrement dit que se dessine ce qu’Ulrich Beck appelle la « société du risque »[6]. Dans ce type de société, la satisfaction des besoins matériels des populations tend à susciter des problèmes et des tiraillements de moindre importance que ceux liés à la production, à la définition et à la distribution des risques. La logique « négative » de distribution des risques semble ainsi effacer la logique « positive » de distribution des richesses[7].
Le raisonnement d’Ulrich Beck combine plusieurs lignes d’argumentation. Il insiste sur le caractère de plus en plus ambivalent des technologies les plus avancées : derrière les progrès que ces technologies sont censées apporter à l’humanité en matière nucléaire, chimique, de génie génétique, se trouve aussi un potentiel de destruction, ressenti de manière diffuse par le public sans que celui-ci en ait pour autant une perception très précise. Le poids de plus en plus important de l’expertise scientifique est abordé de manière corrélative. L’imbrication des questions écologiques et technologiques débouche en effet sur une dépendance croissante envers les experts, avec d’ailleurs tout un discours qui se veut rassurant et qui est censé rendre compte d’une capacité à maîtriser les risques hérités du développement de la société industrielle.
 Pour Ulrich Beck, l’intervention des États souffre en fait d’un grave défaut d’adaptation, dans la mesure où la sécurité qu’ils promettent pouvait peut-être convenir à la société industrielle, mais retarde désormais d’un siècle, face à des risques dotés d’une dimension et d’un caractère fort différents. Confrontée à ces risques, la société devient en quelque sorte un laboratoire, mais un laboratoire dans lequel il paraît difficile de dire qui est responsable des effets de l’expérimentation en cours[8]. C’est pour cela qu’Ulrich Beck parle d’« irresponsabilité organisée »[9]. Cette notion vise à rendre compte de l’attitude ambiguë des institutions sur lesquelles s’appuie la société moderne, celles-ci reconnaissant et niant en même temps la menace. Ulrich Beck essaye ainsi de mettre en lumière les divers dispositifs sociaux, politiques, économiques, qui finissent, plus ou moins volontairement, par ne plus rendre visibles les sources et les effets des menaces environnementales[10].
Pour Ulrich Beck, l’intervention des États souffre en fait d’un grave défaut d’adaptation, dans la mesure où la sécurité qu’ils promettent pouvait peut-être convenir à la société industrielle, mais retarde désormais d’un siècle, face à des risques dotés d’une dimension et d’un caractère fort différents. Confrontée à ces risques, la société devient en quelque sorte un laboratoire, mais un laboratoire dans lequel il paraît difficile de dire qui est responsable des effets de l’expérimentation en cours[8]. C’est pour cela qu’Ulrich Beck parle d’« irresponsabilité organisée »[9]. Cette notion vise à rendre compte de l’attitude ambiguë des institutions sur lesquelles s’appuie la société moderne, celles-ci reconnaissant et niant en même temps la menace. Ulrich Beck essaye ainsi de mettre en lumière les divers dispositifs sociaux, politiques, économiques, qui finissent, plus ou moins volontairement, par ne plus rendre visibles les sources et les effets des menaces environnementales[10].
La science et la technologie prennent dans cette perspective un rôle particulier. Ulrich Beck leur donne d’ailleurs une position centrale dans l’analyse des agencements institutionnels qui participent aux processus de changement repérés. C’est en effet pour une large part à partir de l’appareillage scientifique que peut s’effectuer la perception des risques environnementaux. Pour que des risques puissent être décrits et leur nature évaluée, c’est tout un ensemble de connaissances qui doit être mobilisé. En fait, avec l’entrée dans la « société du risque », science et technologie se trouvent placées dans un contexte nouveau, qui donne un caractère obsolète au corps d’idées et de principes jusque-là utilisé. En cela, la science et la technologie apparaissent aussi à l’origine des problèmes rencontrés, notamment parce qu’elles continuent à opérer sans disposer de l’outillage conceptuel adéquat pour appréhender des questions apparemment nouvelles. Face à cette situation, la science est toutefois poussée vers une forme plus réflexive, qui tend à modifier ses conditions d’insertion dans la société. En suivant ce mouvement, la science peut ainsi contribuer également à la réorganisation de la perception sociale des risques, et fournir des soubassements à une phase de « modernité réflexive »[11].
En fait, la transition qui engage la société industrielle dans une modernisation réflexive touche à la fois les domaines de la science et de la politique. Ulrich Beck présente ce mouvement comme le double résultat d’un processus d’individualisation et de la logique de distribution des risques. Le premier axe correspond à une « détraditionnalisation » des modes d’organisation sociale de la société industrielle (travail, famille, couple). Le second axe s’inscrit quant à lui dans le prolongement de la révélation des risques amenés par la modernisation, l’argument étant que, dans la société du risque, distribution des richesses et distribution des risques renvoient non seulement à des logiques incompatibles mais aussi concurrentes.
Dans l’esprit d’Ulrich Beck, la modernisation réflexive n’exprime pas un effacement, mais une radicalisation de la modernité. Et c’est la société industrielle elle-même qui vient saper la stabilité de ses fondements. Science et politique, qui faisaient partie des éléments constitutifs, perdent les contours précis que pouvaient avoir leurs fonctions dans l’organisation sociale. Ce faisant, elles prennent aussi une nouvelle place. La modernité réflexive témoigne en somme d’un désenchantement de la science et d’une institutionnalisation du doute.
Le questionnement qui guidait ma recherche amenait à accorder une attention particulière à la situation de l’intervention étatique dans le schéma décrit par Ulrich Beck[12]. L’intervention des États peut être considérée comme une expression de leur engagement à assurer à leurs citoyens la sécurité en matière économique et environnementale. Pour cela, ce sont les outils conceptuels et les institutions de la société industrielle qui ont été employés. Or, ces outils et institutions hérités d’un autre contexte se révèlent inadaptés pour traiter des risques environnementaux qui ont pris une dimension nouvelle. La conséquence est une délégitimation radicale de l’État dans sa vocation protectrice[13].
 Avec les craintes liées aux dégradations à grande échelle de l’environnement, aux menaces de catastrophe, le pire entre dans le registre du possible. La légitimité de l’autorité étatique tend par là à être durement affaiblie, en même temps que les bureaucraties administratives voient démenties les prétentions à la rationalité qui auréolaient leur activité. Par réaction, dans une forme d’état d’urgence généralisé, la prévention des risques repérables peut entraîner une emprise croissante du pouvoir scientifique et bureaucratique sur une part de plus en plus large de la vie quotidienne, au point d’inhiber des principes fondamentaux de la démocratie. Cependant, le terrain politique paraît également ouvert à de nouvelles formes de protestation qui sortent du cadre institutionnel consacré. Ulrich Beck entrevoit ainsi un espace composite qui se trouve entre le politique et le non-politique, et qu’il qualifie de « sub-politique ». C’est notamment dans cet espace que se diffusent les thématiques portées par les mouvements écologistes (du moins lorsque ceux-ci ne sont pas absorbés par le jeu institutionnel du système politique central).
Avec les craintes liées aux dégradations à grande échelle de l’environnement, aux menaces de catastrophe, le pire entre dans le registre du possible. La légitimité de l’autorité étatique tend par là à être durement affaiblie, en même temps que les bureaucraties administratives voient démenties les prétentions à la rationalité qui auréolaient leur activité. Par réaction, dans une forme d’état d’urgence généralisé, la prévention des risques repérables peut entraîner une emprise croissante du pouvoir scientifique et bureaucratique sur une part de plus en plus large de la vie quotidienne, au point d’inhiber des principes fondamentaux de la démocratie. Cependant, le terrain politique paraît également ouvert à de nouvelles formes de protestation qui sortent du cadre institutionnel consacré. Ulrich Beck entrevoit ainsi un espace composite qui se trouve entre le politique et le non-politique, et qu’il qualifie de « sub-politique ». C’est notamment dans cet espace que se diffusent les thématiques portées par les mouvements écologistes (du moins lorsque ceux-ci ne sont pas absorbés par le jeu institutionnel du système politique central).
Bien qu’elle paraisse très stimulante, la réflexion d’Ulrich Beck conserve un certain nombre de points embarrassants et d’autres qui peuvent sembler manquer d’approfondissement. Le concept de risque y est employé sous une forme assez large, les problèmes environnementaux figurant en bonne place mais sans que soient véritablement différenciés les traits particuliers de chaque type de problème. En outre, Ulrich Beck montre bien les conflits qui existent dans la définition des risques, mais il ne s’engage pas pour essayer de voir plus précisément ce qui constitue la nature de ces risques, les propriétés qu’ils peuvent avoir. En ce sens, l’usage qui est fait de la notion de risque n’est pas discriminant, ce qui permet de repérer des traits communs, mais cela présente l’inconvénient de mettre sur un même plan des phénomènes qui jouent sur la durée, par l’accumulation de dégradations, et des catastrophes qui renvoient à des événements ponctuels, même si leurs effets peuvent être tout aussi irréversibles.
Par ailleurs, comme le fait remarquer David Goldblatt, la vision qu’Ulrich Beck adopte à propos de la législation et des conflits concernant l’environnement est principalement axée sur les problèmes de pollution, en particulier ceux qui ont un impact sur la santé humaine[14]. Mais de nombreux autres sujets nourrissent aussi les préoccupations et les contestations : les transformations des paysages, les disparitions d’espèces, etc. Au surplus, l’attention d’Ulrich Beck porte davantage sur la composante législative des stratégies de régulation, et elle tend à laisser de côté d’autres éléments de l’outillage étatique qui ont d’ailleurs connu un développement notable, comme les pratiques de concertation ou les instruments économiques. Même si elle est déjà large, la réflexion d’Ulrich Beck semblait aussi conserver une certaine faiblesse quant à la dimension économique des changements repérés, notamment (et ceci m’intéressait particulièrement pour ma thèse), dans les orientations des interventions étatiques. Dans le schéma avancé, ce qui renvoie à la rationalité économique reçoit peu d’attention et, de fait, cette analyse de la « société du risque » insiste beaucoup sur le rôle de la rationalité techno-scientifique. Si ce point peut effectivement être justifié, on peut toutefois ajouter que la rationalité économique joue aussi un rôle majeur, autant à l’origine des menaces que dans la volonté de les maîtriser. Enfin, une difficulté importante réside dans l’étayage empirique de la réflexion d’Ulrich Beck : celui-ci avance un grand nombre d’idées qui peuvent avoir un effet fulgurant en première lecture, mais pour lesquelles on se demande également souvent si une analyse plus approfondie et nourrie empiriquement donnerait effectivement des éléments de confirmation. Mais c’est aussi probablement cela qui a permis à sa pensée de nourrir de riches débats.
________________________________
- [1] Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag. En français : La société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001.
- [2] Voir par exemple parmi des écrits qui n’ont pas été traduits en français : Ecological Enlightenment. Essays on the Politics of the Risk Society (Atlantic Highlands, Humanities Press, 1995), Ecological Politics in an Age of Risk (Cambridge, Polity Press, 1995), et « Risk Society and the Provident State », in Risk, Environment and Modernity. Towards a New Ecology, edited by Scott Lash, Bronislaw Szerszynski and Brian Wynne, London, Sage Publications, 1996.
- [3] Pour une présentation critique de la réflexion d’Ulrich Beck en liaison avec les problématiques environnementales, voir « The Sociology of Risk: Ulrich Beck », in David Goldblatt, Social Theory and the Environment, Cambridge, Polity Press, 1996, et Arthur P.J. Mol, Gert Spaargaren, « Environment, Modernity and the Risk-Society: the Apocalyptic Horizon of Environmental Reform », International Sociology, vol. 8, n° 4, December 1993.
- [4] Arthur P.J. Mol, Gert Spaargaren, « Environment, Modernity and the Risk-Society », op. cit., p. 433 et 439 ; et Andrew Blowers, « Environmental Policy: Ecological Modernisation or the Risk Society? », Urban Studies, vol. 34, n° 5/6, May 1997.
- [5] Ce point est souligné par David Goldblatt (Cf. « The Sociology of Risk: Ulrich Beck », op. cit., p. 155).
- [6] Ulrich Beck en donne une définition dans Ecological Politics in an Age of Risk (op. cit., p. 67) : « I use the term ‘risk society’ for those societies that are confronted by the challenges of the self-created possibility, hidden at first, then increasingly apparent, of the self-destruction of all life on this earth ».
- [7] Ulrich Beck, « On the Logic of Wealth Distribution and Risk Distribution », in Risk Society, op. cit., p. 19-50.
- [8] Ulrich Beck, « A Phony Trick: Acceptable Levels », in Risk Society, op. cit., p. 69, et « The World as Laboratory », in Ecological Enlightenment, op. cit.
- [9] Notion qui figurait dans le titre original de l’édition allemande de Ecological Politics in an Age of Risk : Gegengifte. Die organisierte Unverantwortlichkeit (Frankfurt, Suhrkamp, 1988). C’est effectivement un des thèmes centraux du livre, développé notamment dans le troisième chapitre (« Industrial Fatalism: Organized Irresponsibility »).
- [10] Ulrich Beck remarque qu’en cas de problème, la responsabilité tend à être reportée sur les institutions politiques : « The fact is that no direct decisions are made about technology in the political system (with exception of nuclear power plants). But on the other hand, if anything goes wrong, the political institutions are made responsible for decisions they didn’t take and for consequences and threats they know nothing about » (« Politics of Risk Society », in The Politics of Risk Society, edited by Jane Franklin, Cambridge, Polity Press, 1998, p. 14-15). Il faudrait toutefois préciser que les pouvoirs publics, par leurs décisions, soutiennent aussi un ordre socio-économique, dont les risques repérés sont un des produits.
- [11] « Science beyond Truth and Enlightenment? », in Risk Society, op. cit., p. 155-182.
- [12] Ce point est synthétisé par David Goldblatt (Cf. « The Sociology of Risk: Ulrich Beck », op. cit., p. 179-187).
- [13] David Goldblatt fait remarquer que la vision du rôle protecteur de l’État qui est avancée correspond en fait essentiellement à des procédures et des institutions mises en place en Europe occidentale et continentale, c’est-à-dire à trois caractéristiques particulières : l’utilisation de l’assurance comme principal moyen de compensation sociale, la place centrale de la loi comme instrument de protection et de contrôle dans le domaine de l’environnement, la position essentiellement régulatrice des institutions étatiques face à la pollution (Cf. « The Sociology of Risk: Ulrich Beck », op. cit., p. 181).
- [14] « The Sociology of Risk: Ulrich Beck », op. cit., p. 183.