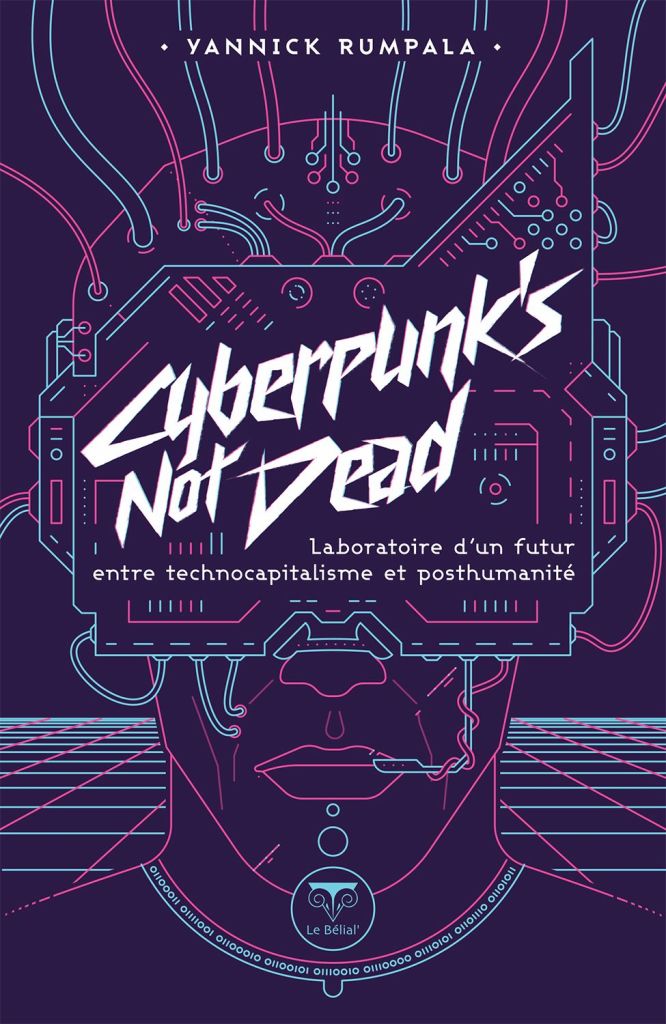Ci-dessous est repris le texte d’un entretien réalisé pour le site de la revue Architectures À Vivre. L’entretien (disponible également ici) complète lui-même une analyse plutôt riche et attentive, dans le numéro de mars-avril 2019 (n° 106) de la revue, pour présenter le livre paru en août dernier et toujours disponible chez Champ Vallon (Hors des décombres du monde. Écologie, science-fiction et éthique du futur). L’occasion de donner un autre éclairage à certaines thématiques abordées dans le livre.
Architectures à vivre : Votre démarche défend la force des explorations imaginaires. À de multiples reprises, vous soulignez le « sérieux » des récits que vous analysez. Pourquoi ces projections ou les utopies dites « abstraites » sont-elles si déconsidérées ?
Y.R. : Les œuvres de science-fiction sont une excellente médiation pour pénétrer la complexité du monde et les incertitudes de son devenir. Et même de vraies amorces pour embrayer sur des réflexions plus élaborées. Ce serait réducteur de considérer les œuvres et productions des auteurs comme de vagues opinions et non des idées construites. Une bonne part des auteurs d’aujourd’hui reconnaît la nécessité de se documenter sérieusement avant de s’engager dans l’écriture. Et il faut croire que certaines de ces projections peuvent être prises au sérieux, puisque même des organisations ayant pignon sur rue, comme l’armée américaine ou l’Agence spatiale européenne, ont par le passé fait appel à des auteurs reconnus.
Pour ce qui concerne la dévalorisation de ces projections, ce serait long de faire une histoire des idées et de revenir sur les nombreux épisodes qui ont abouti à cette mise à l’écart des différentes formes d’« utopies abstraites », typiquement comme le moment où la pensée marxiste a prétendu imposer un « socialisme scientifique » contre un « socialisme utopique ». Mais ces suspicions ou formes de condescendance face aux constructions utopiques ont été diffuses, probablement renforcées par la rhétorique du pragmatisme et de l’efficacité économique, et ne me paraissent pas spécifiquement françaises. Certains spécialistes de l’histoire des utopies mettent cette mise à l’écart en relation avec certaines caractéristiques de notre moment historique : le déploiement du néolibéralisme et une supposée « fin de l’histoire », l’absorption consumériste et techniciste de l’idée de « progrès », l’enlisement dans un « présentisme »…
L’utopie peut aussi avoir quelque chose de paralysant dans l’espèce d’absolue perfection vers laquelle elle est censée orienter. Pourtant, souvent, les idées politiques nouvelles ou décalées émergent de ces « utopies abstraites ». Le transhumanisme par exemple, qui fait de plus en plus parler de lui et qui, à certains égards, peut faire penser à une forme d’utopie, est traversé de références ou d’influences provenant plus ou moins directement de la science-fiction. Et avec même maintenant, dans une espèce de boucle, des auteurs : Ramez Naam par exemple, avec sa série de romans Nexus, Crux, et Apex qui essayent de lui donner une consistance ou une incarnation dans des récits romanesques.
A.À.V. : Vous tirez six « lignes de fuite » des récits d’anticipation, présentées non comme des solutions clés en mains, mais comme des guides ou des « poches d’espérance ». Pour comprendre votre concept, pouvez-vous nous exposer l’espérance à attendre du « conservationnisme autoritaire » qui semble a priori peu engageant ?
Y.R. : Dans les versions romanesques que j’étudie dans le livre, le « conservationnisme autoritaire » fonctionne comme s’il s’agissait d’imposer des normes de comportements à des groupes ou populations pour des motifs écologiques et sans possibilité de discussion. Évidemment, c’est une manière de donner des limites aux actions qui paraît peu compatible avec le souhait de maintenir des principes démocratiques. Dans Carnival d’Elizabeth Bear, ce sont par exemple des intelligences artificielles qui définissent et imposent les prescriptions à respecter. Et les choix peuvent être brutaux, notamment lorsqu’il s’agit de réguler ce qui est considéré comme des excès de population. De manière intéressante, ce qui est problématisé en creux à travers ce type de ligne de fuite, c’est la question de la capacité des systèmes démocratiques à encaisser la crise écologique et à emmener consciemment une collectivité vers un ajustement (conscient) des comportements. Bénéfique pour les milieux, on peut aisément convenir qu’une telle orientation autoritaire paraît peu désirable pour la plupart des humains ou autres êtres pensants qui subissent cette option. Mais c’est aussi ce sentiment de trouble, cette déstabilisation, que recherchent les auteur(e)s.
A.À.V. : Dans ces visions problématiques, les cadres bâtis dans lesquels se déroulent les histoires ne sont pas accessoires, mais parties prenantes des expériences vécues par les protagonistes, soulignez-vous. Y a-t-il dans la SF des typologies de rôles assignés aux objets construits, en tant que problèmes ou résolutions ?
Y.R. : Tout rapport au monde est fait d’expériences esthétiques et symboliques, d’un mélange d’émotions et de sens. L’imagination peut être une des manières de médiatiser ce rapport, comme si intervenaient d’autres prismes. Si l’on est attentif aux décors proposés, les représentations et descriptions de la science-fiction peuvent être parcourues en les considérant comme des manières d’éprouver l’habitabilité d’une planète. Éprouver dans un double sens : d’un côté, ressentir des conditions d’existence dans un environnement, a fortiori lorsqu’il devient moins accueillant ; et d’un autre côté, mettre à l’épreuve des milieux et leurs capacités d’adaptation face à des perturbations. La science-fiction, y compris dans les films apparemment légers où l’on se balade de planète en planète, permet de faire sentir que les environnements n’ont pas tous le même niveau de confort pour les espèces pensantes (humains ou non) qui y sont présentes. Faut-il alors s’adapter à ces environnements ou les adapter ? Sur une série de romans devenus des classiques, Frank Herbert décrit les deux options dans le fameux Dune (1965) et ses suites.
Autre exemple : les questions soulevées par la géo-ingénierie sont d’une certaine manière depuis longtemps présentes dans la science-fiction, qui a servi à décrire les multiples façons de transformer volontairement l’habitat d’une planète et gérer ses paramètres écologiques. C’est ce qu’on retrouve avec l’idée de terraformation notamment, lorsque des humains essayent d’implanter des colonies durables ailleurs que sur Terre. Pour ceux qui resteront sur cette dernière, les représentations de science-fiction montrent que les grands aménagements et infrastructures sont difficilement réversibles : ils vont traverser le temps. Plus ou moins bien certes, mais on les retrouve, même sous la forme de l’imaginaire de la ruine, évidemment particulièrement présent dans les schémas apocalyptiques et post-apocalyptiques.
Je n’en ai pas parlé dans le livre, mais, dans cette production imaginaire, j’ai été intéressé de voir régulièrement revenir le modèle des arcologies (*), ces bâtiments et architectures qui tenteraient ou auraient tenté de faire fonctionner en leur sein des formes d’écologie. Dans le courant cyberpunk, c’est plutôt sur le mode de l’échec, où elles tendent à apparaître comme des restes de tentatives avortées. Plus récemment, chez Paolo Bacigalupi, notamment dans son roman Water Knife (2015), les arcologies apparaissent comme des espèces d’enclaves que des catégories privilégiées auraient réussi à se réserver, notamment pour s’éviter les affres d’une sécheresse généralisée.
A.À.V. : Si on regarde ces récits sous l’angle du maintien de l’habitabilité de la planète, quel sens donner aux figurations de cabanes dans des forêts (comme dans Oblivion) ou aux modèles symbiotiques avec les éléments naturels (comme dans Avatar) ? Sont-ils riches ou caducs pour la réflexion écologique ?
Y.R. : L’imaginaire collectif semble peiner à concevoir un développement humain en dehors d’une extension continue de la technosphère. On conçoit facilement que les questions qui seraient alors soulevées pourraient être désagréables ou perturbantes. Que signifie devoir vivre, chaque jour, dans des environnements où ce qu’on appelait « nature » a été mis à distance ou transformé au point que l’idée est à peine un vague souvenir ? Même si c’est d’une manière qui peut paraître détournée, la science-fiction remet sur le devant de la scène la question du choix du mode de vie et de sa dépendance par rapport aux appareillages et systèmes techniques.
Oblivion est un film intéressant pour ses ambiguïtés : il réactive l’image du refuge à l’écart des fracas du monde environnant, mais il est symboliquement davantage inscrit dans un passé nostalgique, comme s’il y avait une inévitabilité à la destruction du monde qui l’entoure. Quant à Avatar, le film remet en scène des valeurs et des formes de spiritualité tellement arasées par la modernité triomphante que leur retour risquerait d’apparaître comme une espèce de reconstruction fantasmée.
A.À.V. : Dans les histoires thématisées sur le climat, les issues se révèlent globalement peu heureuses. Comment comprendre que l’on imagine se relever (non sans mal) d’une apocalypse nucléaire ou d’une prédation capitaliste généralisée, mais pas du réchauffement climatique ?
Y.R. : La perception des durées joue probablement un rôle. À un niveau global, la restauration ou la transformation de situations écologiques ne peut généralement se faire que sur des temporalités longues, que les modèles sociaux devenus dominants n’ont guère contribué à favoriser. C’est aussi pour ces raisons que les imaginaires sont un bon indicateur de la capacité à continuer à forger des alternatives. Et l’impression est en effet qu’il faut souvent remonter dans le temps et dans des productions déjà relativement anciennes pour en faire ré-émerger. Avant le solarpunk, mais non sans résonances, ce que j’ai appelé la « frugalité autogérée » est l’espèce de modèle expérimental qu’on trouve dans le roman Les Dépossédés de l’Américaine Ursula Le Guin (en 1974). Avec des détails presque proches de l’anthropologie, elle y teste en quelque sorte un type de collectivité qui parviendrait à gérer une situation de rareté des ressources, sans propriété, ni gouvernement (mais avec quand même l’aide d’un système informatique). L’intérêt des « lignes de fuite », c’est aussi de montrer que toutes ont leurs difficultés et que, face à l’adversité, il peut y avoir certains choix à défendre. Mais ces visions signalent aussi des contraintes, et qui a envie de contraintes ?
A.À.V. : Les récits de science-fiction vous semblent différents des scénarios « experts » de la prospective. Entretiennent-ils, selon vous, des liens avec les scénarisations propres aux métiers de la conception ?
Y.R. : Un des forts enjeux actuels n’est pas seulement de remettre du futur dans le présent, mais aussi d’y remettre des perspectives de long terme. La prospective peut avoir un intérêt, mais elle reste sur des horizons temporels qui paraissent bien courts face à la portée des transformations écologiques en cours. La science-fiction n’a pas ces hésitations. La difficulté est en effet de penser le futur à l’écart des imprégnations du présent, comme lorsqu’on cherche à avoir une longueur ou un coup d’avance pour éviter de se faire déborder.
Si la science-fiction a un avantage comme mode d’exploration et de connaissance, c’est parce qu’elle paraît un cadre plus propice aux visions larges sur les métamorphoses du monde. Elle est une mise en scène des formes possibles du changement social. Ce serait donc réducteur de la considérer comme une forme d’évasion en dehors de la « réalité ». Au contraire, elle peut fonctionner comme une invitation à y plonger plus profondément, typiquement en décapant un vernis de confort ou de certitudes.
Ce décalage fictionnel permet alors effectivement d’arriver avec un autre regard devant la variété de constructions que l’humanité va probablement continuer à ajouter à la surface de la Terre. Par exemple, avec les projets de fermes verticales, c’est l’architecture qui devient cyborg, à la manière de ces entités hybrides qui ont largement peuplé la science-fiction en combinant l’organique, le vivant, avec l’artificiel, le technique.
Plus largement, la science-fiction est une façon de donner à voir les conséquences de choix urbanistiques (ou de non-choix même) qui auraient été faits dans une période antérieure. D’ailleurs, dans certaines portions du monde des urbanistes anglophones, il y a eu des tentatives pour montrer l’intérêt de l’imaginaire de la science-fiction pour les réflexions liées à la planification urbaine. De fait, une ressource puissante de la science-fiction est de décrire ou de visualiser, avec souvent moult détails significatifs, comment seraient peuplées, habitées, vécues, pratiquées, des projections urbanistiques, qui sont alors testées grâce à la médiation d’une autre forme d’expérience. À quoi ressembleraient les vies humaines dans des villes qui se seraient essentiellement développées en hauteur et qui ne seraient plus faites que de tours ? Y aurait-il un stress différent du fait de cette verticalité potentiellement écrasante ? On peut en avoir quelques projections et idées grâce à la littérature (Monades urbaines de Robert Silverberg et I.G.H. de J. G. Ballard, par exemple, pour citer quelques classiques) et au cinéma.
Dans une orbite proche de la SF, en cherchant pour partie à y puiser des inspirations, il existe effectivement des initiatives de « design fiction » qui se développent, mais elles relèvent plutôt de l’entreprise commerciale, où il s’agit de s’adresser à des clients qui ont généralement des demandes, voire des produits à vendre. La science-fiction n’a a priori pas vocation à faire du prototypage, en tout cas pas de cette sorte.
A.À.V. : Vous accordez quatre fonctions à la science-fiction : l’habituation, la catharsis, l’alerte et l’émancipation. Le pessimisme ambiant tendrait à faire penser que la première se réalise sans peine. Quelles formes la fonction la plus active, l’émancipation, pourrait-elle prendre ? Autrement dit, par quels « praticiens du futur » souhaiteriez-vous peut-être être lu ?
Y.R. : La thématique montante de l’anthropocène et, a fortiori, celle de l’effondrement peuvent laisser l’impression qu’il n’y a plus guère d’espoir hormis gérer les conséquences de la dégradation écologique généralisée que l’humanité a enclenchée. L’angoisse et la peur sont rarement les réactions les plus propices à l’émancipation. Comme dirait Maître Yoda (pour rester, grâce à Star Wars, à proximité de la science-fiction) : « La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine mène à la souffrance ».
Je dirais que le livre ne s’adresse pas forcément à des « praticiens du futur », mais à toute personne qui s’intéresse au futur et au devenir de notre monde. L’ouverture imaginaire est toujours un recours pour empêcher d’enfermer la pensée dans un « There is no alternative ». Le livre met une part de cet imaginaire à disposition pour celles et ceux qui voudraient confirmer ou se convaincre que le futur est toujours une affaire de choix, et que les récits dans lesquels s’inscrit la trajectoire de l’humanité doivent rester ouverts. Il ne suffit pas effectivement de refuser la fatalité. Pour l’individu comme pour un collectif, l’émancipation passe par la réflexion sur sa propre condition, et la science-fiction peut justement être un vecteur de réflexivité, une forme de stimulation à la réflexion. Elle problématise le rapport à ce qui nous entoure, l’importance des coexistences, et c’est en ce sens qu’elle se révèle aussi précieuse. En version positive, c’est ce que j’ai essayé de proposer avec l’idée de « souciance ». C’est redonner du sens à la destinée des sociétés humaines en les reconnectant avec ce qui les entoure et qui assure leur subsistance. La question est majeure : comment se construit un collectif lorsque ses contours sont en pleine redéfinition, à la fois du fait de la place croissante occupée par de nouvelles entités, machiniques notamment (robots, etc.), et de la disparition ou de la quasi-disparition d’espèces vivantes et d’écosystèmes ? Quelles nouvelles régulations ce collectif doit-il se donner ?
L’émancipation suppose en tout cas de ne pas penser que l’horizon futur est bouché et une pré-condition est toujours d’avoir à disposition des visions alternatives. Même les dystopies ou des scénarios post-apocalyptiques ont un intérêt de ce point de vue. Cet intérêt est aussi d’amener à se poser la question : comment pourrions-nous ou risquerions-nous d’en arriver là, à cette catastrophe ou régression sociale ? Ou, inversement : quel effort (collectif) y aurait-il à faire pour ne pas déboucher sur ces situations ? Les fictions aident non seulement à rappeler que le relatif confort présent pour certaines populations n’est pas éternellement acquis, mais aussi à mettre en relief les espaces où se maintiennent des capacités d’action (même) lorsque les situations se sont aggravées ou se détériorent. Selon les conditions, l’espoir est mince, mais sa petite lueur brille encore dans certaines portions de ces imaginaires orientés vers le futur.
—————————
(*) L’« arcologie », contraction d’architecture et d’écologie, est un concept théorisé par l’architecte italo-américain Paolo Soleri dans les années 1960-70 et mis en œuvre dans la ville expérimentale d’Arcosanti, en plein désert dans l’Arizona. Dans les œuvres de SF où il apparaît, le terme est repris sans nécessairement de référence directe à ce précédent, même si l’idée en est similaire.






 Dans un autre registre, le film d’animation sud-coréen Wonderful Days peut être vu comme un questionnement sur les moyens de faire prévaloir une justice environnementale. En l’occurrence, c’est par la lutte de ceux qui subissent les situations dégradées marquant la majeure partie de la Terre de 2142. Ils ont face à eux une ville réservée pour l’élite, Ecoban, espèce de bulle à l’abri de la pollution et qui a même pour particularité d’utiliser cette dernière comme ressource énergétique. Mais Ecoban, presque comme une métaphore de notre système économique, va manifester un besoin croissant en énergie, et ses représentants vont être prêts pour cela à générer encore plus de pollution, ce qui va engendrer la révolte des exclus maintenus de force à l’extérieur.
Dans un autre registre, le film d’animation sud-coréen Wonderful Days peut être vu comme un questionnement sur les moyens de faire prévaloir une justice environnementale. En l’occurrence, c’est par la lutte de ceux qui subissent les situations dégradées marquant la majeure partie de la Terre de 2142. Ils ont face à eux une ville réservée pour l’élite, Ecoban, espèce de bulle à l’abri de la pollution et qui a même pour particularité d’utiliser cette dernière comme ressource énergétique. Mais Ecoban, presque comme une métaphore de notre système économique, va manifester un besoin croissant en énergie, et ses représentants vont être prêts pour cela à générer encore plus de pollution, ce qui va engendrer la révolte des exclus maintenus de force à l’extérieur. Trantor, planète qu’Isaac Asimov avait placée comme capitale de l’Empire galactique dans ses romans de la série Fondation, symbolise un processus poussé à son extrême, celui d’une urbanisation totale : la ville, n’ayant plus de limites, se confond alors avec le monde et il n’est plus guère possible d’y trouver des espaces ressemblant à de la « nature » : « La surface entière de Trantor était recouverte de métal. Ses déserts comme ses zones fertiles avaient été engloutis pour être convertis en taupinières humaines […] »
Trantor, planète qu’Isaac Asimov avait placée comme capitale de l’Empire galactique dans ses romans de la série Fondation, symbolise un processus poussé à son extrême, celui d’une urbanisation totale : la ville, n’ayant plus de limites, se confond alors avec le monde et il n’est plus guère possible d’y trouver des espaces ressemblant à de la « nature » : « La surface entière de Trantor était recouverte de métal. Ses déserts comme ses zones fertiles avaient été engloutis pour être convertis en taupinières humaines […] »