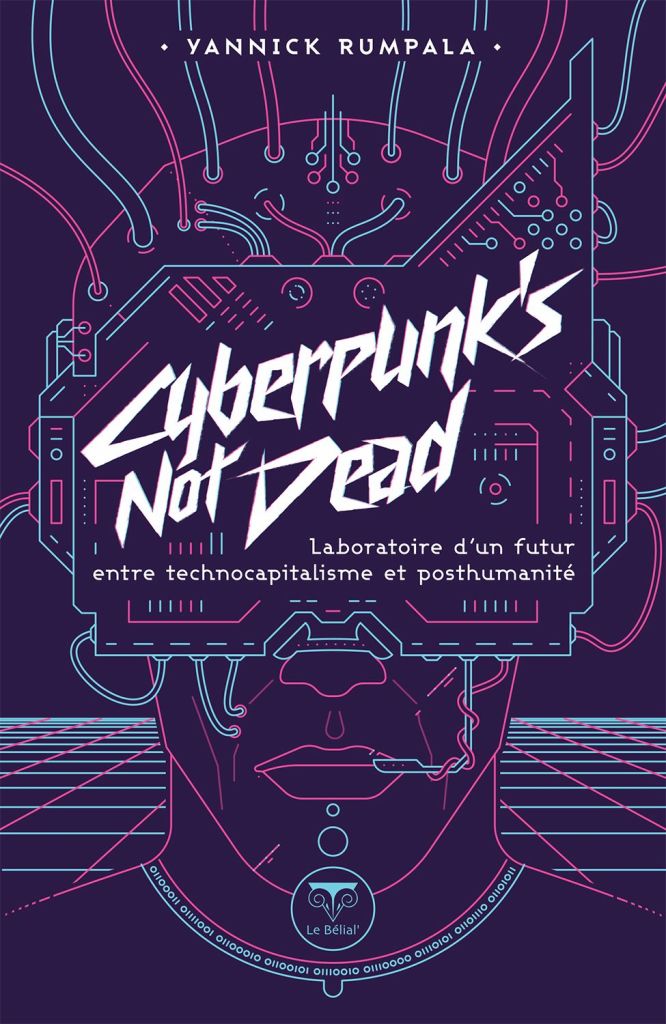Dans deux précédents billets en forme de petits exercices intellectuels, j’avais continué à réfléchir sur les conditions à remplir pour qu’un projet comme celui de la « décroissance » puisse gagner en crédibilité (en l’occurrence en accordant une attention plus précise aux valeurs individuelles et collectives et aux pratiques). La troisième dimension importante est celle qui relève de ce qu’on peut appeler le cadre institutionnel.
 La réalisation d’un objectif comme celui de la « décroissance » supposerait non seulement de multiplier les espaces d’expériences, mais aussi de les faire converger et de pouvoir les articuler dans un agencement commun. Ces convergences et articulations seraient en effet d’autant plus nécessaires que l’enjeu est systémique : s’il s’agit de renverser l’« engrenage de la production »[1], il faut aussi trouver comment les énergies rassemblées peuvent atteindre la masse critique face à ce vaste complexe politico-économique. C’est pour cela que s’est aussi posée la question des modalités d’intervention sur le terrain politique. En France, une partie des personnalités engagées dans le mouvement de la « décroissance » a ainsi jugé utile d’intervenir sur le terrain électoral et un parti politique (le Parti pour la décroissance) a été fondé en avril 2006. Après quelques candidatures aux élections législatives de juin 2007 et municipales de mars 2008, le parti s’est présenté aux élections européennes de juin 2009 par l’intermédiaire d’une liste Europe Décroissance qui a pu être présente dans toutes les circonscriptions françaises[2].
La réalisation d’un objectif comme celui de la « décroissance » supposerait non seulement de multiplier les espaces d’expériences, mais aussi de les faire converger et de pouvoir les articuler dans un agencement commun. Ces convergences et articulations seraient en effet d’autant plus nécessaires que l’enjeu est systémique : s’il s’agit de renverser l’« engrenage de la production »[1], il faut aussi trouver comment les énergies rassemblées peuvent atteindre la masse critique face à ce vaste complexe politico-économique. C’est pour cela que s’est aussi posée la question des modalités d’intervention sur le terrain politique. En France, une partie des personnalités engagées dans le mouvement de la « décroissance » a ainsi jugé utile d’intervenir sur le terrain électoral et un parti politique (le Parti pour la décroissance) a été fondé en avril 2006. Après quelques candidatures aux élections législatives de juin 2007 et municipales de mars 2008, le parti s’est présenté aux élections européennes de juin 2009 par l’intermédiaire d’une liste Europe Décroissance qui a pu être présente dans toutes les circonscriptions françaises[2].
Une intervention politique dans un cadre uniquement national peut toutefois paraître limitative. Pour reprendre un type de débat qui avait agité les théoriciens socialistes à propos de la position de l’Union soviétique face à un monde resté globalement capitaliste, est-il possible d’engager la décroissance « dans un seul pays » ? De fait, les dynamiques de production et d’échange sont désormais prises dans des modalités d’organisation largement transnationales[3]. Takis Fotopoulos, économiste et philosophe promoteur de la « démocratie inclusive », peut ainsi facilement insister sur le fait qu’une logique de « décroissance » n’est pas conciliable avec une économie de marché internationalisée et qu’elle n’est réalisable qu’avec un autre système socio-économique (celui qu’il prône, forcément), pour lequel importent donc les caractéristiques structurelles, et pas seulement les valeurs sous-jacentes[4]. Le modèle marchand occidental paraît de surcroît continuer à s’étendre. Les grands groupes mondiaux des secteurs de la grande consommation et de la grande distribution sont en quête de nouveaux marchés et n’hésitent guère à s’implanter dans des pays émergents si ces derniers leur semblent prometteurs en termes de profits futurs.
Si les démarches de relocalisation et les initiatives communautaires peuvent être utiles à un projet de « décroissance »[5], elles doivent donc aussi trouver d’autres relais qui puissent faire contrepoids face à des dynamiques marchandes qui poursuivent leur expansion. L’éthique de convivialité prônée dans un esprit proche d’Ivan Illich fonctionne plus facilement pour des réseaux de taille restreinte. Mais la réalisation d’une « décroissance » sur une échelle plus générale suppose aussi des réseaux plus larges, notamment en termes d’étendue géographique. D’autres problèmes de portée globale (respect des droits humains au travail, etc.) ont déjà été saisis par des réseaux d’action globaux, qui montrent ainsi que des formes d’action collective provenant de la société civile peuvent trouver des capacités organisationnelles lorsque certains changements sont jugés souhaitables pour la collectivité[6].
[1] Pour reprendre la dénomination de la théorie développée autour des réflexions d’Allan Schnaiberg. Cf. Kenneth A. Gould, David N. Pellow, and Allan Schnaiberg, The Treadmill of Production. Injustice and Unsustainability in the Global Economy, Boulder, Paradigm Publishers, 2008. Pour une présentation plus synthétique, voir Kenneth A. Gould, David N. Pellow, Allan Schnaiberg, « Interrogating the Treadmill of Production. Everything You Wanted to Know about the Treadmill but Were Afraid to Ask », Organization & Environment, vol. 17, n° 3, 2004, pp. 296-316.
[2] Elle n’a réalisé qu’un résultat très faible et peu significatif (0,035 % à l’échelle nationale), notamment du fait que l’impression des bulletins était laissée aux soins de l’électeur.
[3] Cf. James Rice, « The Transnational Organization of Production and Uneven Environmental Degradation and Change in the World Economy », International Journal of Comparative Sociology, vol. 50 (3-4), 2009, pp. 215-236.
[4] Takis Fotopoulos, « The De-growth Utopia: The Incompatibility of De-growth within an Internationalised Market Economy », in Qingzhi Huan (ed.), Eco-socialism as Politics. Rebuilding the Basis of Our Modern Civilisation, Dordrecht, Springer, 2010.
[5] Comme le montrent par exemple les travaux de Caroline Bekin, Isabelle Szmigin, and Marylyn Carrigan, « Communally Living the Positive Alternative », in Franco Gandolfi and Hélène Cherrier (eds), Downshifting. A Theoretical and Practical Approach to Living a Simple Life, Hyderabad, ICFAI University Press, 2008, pp. 135-161.
[6] Cf. Pieter Glasbergen, « Global action networks: Agents for collective action », Global Environmental Change, vol. 20, n° 1, February 2010, pp. 130-141. Pour une théorisation plus large de l’action collective par les réseaux, voir aussi Yannick Rumpala, « La connaissance et la praxis des réseaux comme projet politique », Raison publique, n° 7, octobre 2007.