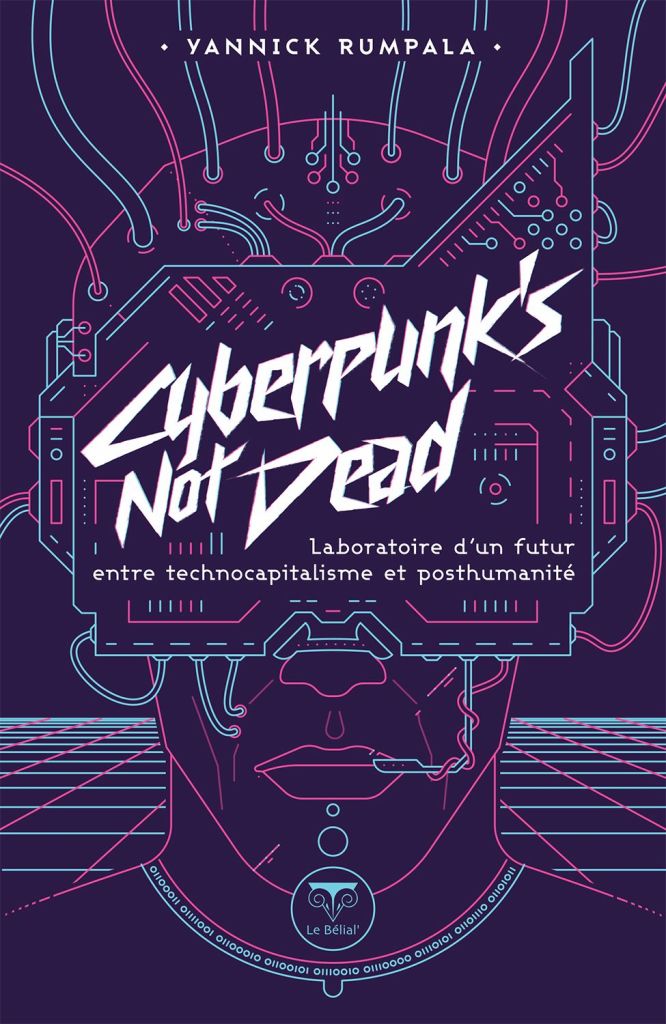Quels leviers reste-t-il encore aujourd’hui pour les projets de transformation sociale, notamment ceux qui affirment qu’« un autre monde est possible » ? Question difficile, car l’époque semble être davantage aux doutes et aux désorientations. Construire une alternative politique suppose en effet de retrouver des prises sur notre monde et son évolution. Malheureusement, un certain fatalisme peut conduire à penser que les forces et dynamiques en jeu sont quasiment devenues insaisissables, notamment celles qui sous-tendraient la lame de fond de la « globalisation ».
 De ce point de vue, les attentes de renouvellement théorique et pratique sont donc fortes. Dans un article paru en octobre 2007 dans la revue Raison publique (« La connaissance et la praxis des réseaux comme projet politique », téléchargeable en fichier pdf), j’avais essayé de voir dans quelle mesure une pensée et une praxis des réseaux pouvaient fournir une forme de secours. La proposition, avec les outils de la philosophie politique et des sciences sociales, visait plus précisément à tester s’il pouvait y avoir là, dans cette pensée des réseaux, un moyen de reconstruire un projet politique adapté aux configurations contemporaines.
De ce point de vue, les attentes de renouvellement théorique et pratique sont donc fortes. Dans un article paru en octobre 2007 dans la revue Raison publique (« La connaissance et la praxis des réseaux comme projet politique », téléchargeable en fichier pdf), j’avais essayé de voir dans quelle mesure une pensée et une praxis des réseaux pouvaient fournir une forme de secours. La proposition, avec les outils de la philosophie politique et des sciences sociales, visait plus précisément à tester s’il pouvait y avoir là, dans cette pensée des réseaux, un moyen de reconstruire un projet politique adapté aux configurations contemporaines.
Si notre monde devient un monde de réseaux (comme nombre d’analyses tendent à le confirmer), il faut en effet le saisir avec des outils du même ordre. Et c’est seulement après ce travail qu’il devient possible de réfléchir plus sérieusement à un « autre monde possible ». Pour prendre un exemple emblématique, Toni Negri, un des théoriciens actuellement influents dans la pensée radicale, évoque le rôle des réseaux et les formes de pouvoir qui en découlent, mais il ne pousse pas la réflexion autant qu’il le pourrait. Selon son analyse, le vaste appareil de gouvernement qui s’est installé et qu’il appelle « l’Empire » (notamment dans le livre du même nom) serait d’autant plus difficile à contrecarrer qu’il s’avérerait expansif, enveloppant, décentralisé et déterritorialisé. Et, si on continue à suivre ce type de perspective, ce serait dans et par les « multitudes » que de nouvelles formes de résistance devraient être amenées à se développer. Sauf qu’on peut aussi considérer que la construction d’une alternative politique n’a guère avancé si ces nouveaux réseaux de pouvoir restent dans une appréhension abstraite, lointaine et nébuleuse. Ces réseaux, comme je le proposais, il faudrait faire l’effort d’essayer de les tracer véritablement, pour au moins commencer à donner les voies permettant d’en sortir ou éventuellement de les reconfigurer, et c’est ensuite qu’il serait possible de fournir des bases aidant à reconstruire un véritable projet politique.
Certes, la tendance de l’époque paraît déjà être à vouloir tout tracer. Mais ce n’est pas tellement ce penchant à la surveillance et au contrôle disciplinaire qu’il s’agit d’encourager. À rebours de cette tendance, l’enjeu serait plutôt de faire en sorte que ce traçage généralisé des réseaux garde un potentiel émancipateur, donc surtout ne conduise pas à une dérive sous forme d’instrumentalisation policière ou autoritaire.
L’article, qui esquisse en trois étapes les grandes lignes d’un tel projet, est désormais accessible directement en ligne sur le site de la très dynamique et souvent très stimulante revue Raison publique.