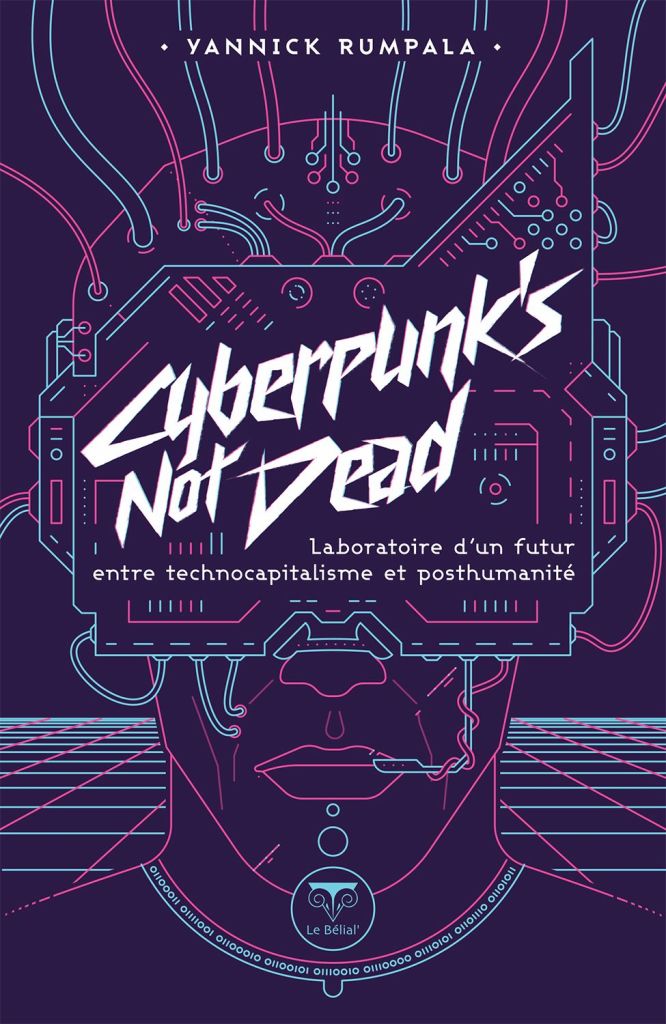Ci-dessous, la version complète d’un entretien paru dans le journal La Provence, en plein dans la chaleur d’un été qui n’était pas loin de ressembler à ceux imaginés pour Blade Runner 2049…

• Première question, est-ce que la limite est parfaitement claire dans ce genre de SF entre critique et fascination pour la technologie, une sorte de fascination du monstre ?
Le cyberpunk joue entre ces deux registres. Bruce Sterling, auteur américain qui en a largement été le propagandiste, avait habilement signalé que le mythe attaché à la créature du Dr Frankenstein méritait d’être actualisé et il laissait entendre que le cyberpunk y participait en recadrant l’appréhension du futur : comme si la condition humaine ne pouvait plus être imaginée sans prendre conscience que les médiations technologiques seraient dorénavant partout, dans les existences (y compris intimes) comme dans leurs environnements… Le cyberpunk, d’ailleurs, propose une vision qui n’est pas celle d’un déterminisme technologique, où la technique aurait en elle-même une espèce de force qui contraindrait tout. Il est plus subtil et laisse une place non négligeable à l’indétermination, celle liée notamment aux usages qui vont être faits d’une technologie. La technique y devient à la fois contrainte et ressource. C’est la fameuse phrase que William Gibson, souvent considéré comme le père fondateur, a placée plusieurs fois dans ses premiers textes : « La rue essaie de trouver sa propre utilisation des choses ». Et souvent par de multiples détournements…
• Comment le cyberpunk pose-t-il la question de la disparition des humains dans leur propre technologie ?
De multiples manières. Par la figure du cyborg, puisque les artefacts et éléments machiniques (prothèses, implants, etc.) ne sont plus à l’extérieur du corps, mais aussi à l’intérieur, non seulement pour suppléer des éléments organiques, mais aussi pour ajouter des capacités n’ayant plus rien de « naturel ». Par l’absorption des individus dans le cyberespace également, qui permet de s’immerger, voire de se perdre, dans un nouveau monde distinct de la réalité conventionnelle, mais potentiellement plus séduisant et très addictif. Toutes ces possibilités esquissent un rapport différent au corps, qui devient potentiellement superflu lorsque la conscience peut être fixée sur d’autres supports, laissant même espérer une forme d’immortalité, débarrassée de la contrainte organique. L’impression laissée dans ces oeuvres est même parfois que le corps devient quelque chose de pesant, d’encombrant…
• Le cyberpunk est-il le lien manquant dans l’anticipation entre la critique économique et technologique ?
C’est en effet une capacité majeure de ce sous-genre : mettre dans des mêmes contextes des transformations profondes ayant eu lieu simultanément sur les plans économique et technologique. À travers les écrits de William Gibson, on sent par exemple que le rôle croissant des intelligences artificielles est lié à un certain stade du capitalisme, où informations et données sont devenues des ressources capitales, où États et régulations publiques finissent par être multiplement débordés par ces créations et les puissantes entreprises qui en sont à l’origine. Le cyberpunk annonçait que les serveurs informatiques, avec toutes les données qu’ils permettent de stocker, allaient être la nouvelle infrastructure du monde, et donc un des nouveaux espaces du pouvoir, les bastions de nouvelles forces économiques.
• Ces méga-corporations, hors contrôle étatique, préfigurent la victoire d’une économie qui a pour objectif d’avaler les pays, les nations au profit d’un monde unique où tout est marchand. Cette prévision est-elle en train de se réaliser ?
Le cyberpunk a traduit des formes de questionnements, voire d’anxiétés, sur des transformations politico-économiques qui étaient en cours à l’époque. Les années 1980 ont ouvert un cycle de dérégulation, dont le cyberpunk pousse la logique jusqu’à l’évanescence des instances publiques. Et ce ne sont pas seulement les méga-corporations, mais aussi différentes formes de criminalité qui en profitent et, pour certaines, deviennent des puissances à part entière. Le tout dans un système complètement globalisé, où tout circule sans répit à une échelle planétaire, et marqué par des inégalités accrues. Dans les mondes du cyberpunk, il n’y a plus guère de questions pour savoir ce qui peut être vendu ou non, puisque beaucoup de barrières morales ont sauté : s’il y a de l’argent à gagner sur quelque chose, il y aura forcément un business pour essayer d’en tirer parti…
• Peut-on faire le lien entre le cyberpunk et un roman comme Les Furtifs d’Alain Damasio ?
Le propre d’un genre comme la science-fiction est le constant tissage de relations plus ou moins conscientes entre les textes, avec tout ce que cela comporte comme circulations d’idées, d’images, de références, etc. Difficile de ne pas voir en effet des thèmes communs, comme la domination des multinationales et l’enserrement des existences humaines dans des environnements technologiques où celles-ci sont constamment surveillées, mesurées, orientées, etc. Le cyberpunk n’avait connu que quelques tentatives d’adaptation en France, avec des tonalités différentes de son grand frère américain, les auteurs français semblant tendanciellement plus du côté de l’humain. Les personnages du cyberpunk originel, souvent désabusés et cyniques, subissaient le monde qui les entoure, sans guère d’espoirs de pouvoir le changer. Chez Alain Damasio, l’esprit est davantage à une forme de résistance et les récits continuent à porter une recherche de voies de sortie.