Le texte qui suit reprend un entretien paru dans le numéro 59 du magazine New Noise, en prolongement du dernier livre (Cyberpunk’s not dead. Laboratoire d’un futur entre technocapitalisme et post-humanité, Le Bélial, 2021). Rubrique « Bibliothèque de combat », rien que ça…
* * *
C’est drôle, alors qu’on ne pensait plus jamais voir apparaître le préfixe « cyber » dans les médias ou les conversations, il n’a jamais été aussi présent aujourd’hui ! On entend parler tous les jours de cyber harcèlement, de cyber attaque, de cyber sécurité… Qu’en penses-tu ?
Je pense que le préfixe fait partie de ces locutions qui finissent par s’imposer du fait d’une certaine puissance d’évocation et à défaut de trouver mieux. Je ne suis pas sûr que le sens originel grec soit perçu et que tout le monde y mette les mêmes représentations. C’est d’ailleurs là que prendre en compte le rôle de l’imaginaire est intéressant. Ce genre de préfixe en est gorgé. Il signale l’inscription croissante de pans entiers des vies humaines dans un type particulier de milieu technique, avec l’espèce de double frisson de fascination et d’angoisse vis-à-vis de quelque chose qui paraît nébuleux, mystérieux : comme un monde à part. Perçu comme plein de menaces aussi…
Tu as choisi de nommer ton livre Cyberpunk’s Not Dead en t’inspirant d’un fameux slogan. C’est ironique ? Ou c’est un cri du coeur ?
C’est plus un clin d’œil auquel il était difficile de résister et, pour relier plus directement au contenu du livre, une autre manière de dire : Cyberpunk is now. Une part de cet imaginaire a comme débordé dans la « réalité ». Pas sûr que ce soit le monde dans lequel nous aurions eu envie de vivre. Mais une partie de ce qui avait été imaginé sous forme hypothétique ou spéculative paraît désormais présente. Bien sûr, il ne faut pas s’arrêter à l’esthétique de surface. Les panneaux d’affichage publicitaire à LED commencent à être plus présents que les néons dans les paysages urbains et les cœurs de ville aseptisés ne ressemblent pas aux rues de Blade Runner ou de la Conurb. En revanche, il y a des proximités troublantes entre ce qui relevait de l’anticipation fictionnelle et un certain contexte socioéconomique, technologique, etc., avec lequel nous sommes familiers. C’est là que le cyberpunk peut être poussé un cran plus loin, en activant une forme de réflexion, critique à certains égards, sur des phénomènes ou tendances qui paraissent brouiller la frontière entre fiction d’hier et monde d’aujourd’hui.
Par rapport à l’actualité du cyberpunk dont on parle beaucoup actuellement, tu écris en ouverture de ton ouvrage : « Très actuel ? Trop actuel ? Trop ressemblant avec le présent ? Ou trop daté ? ». Comment expliquer ces paradoxes mis en avant dés l’introduction ?
Tout courant littéraire ou culturel s’inscrit dans une époque et le cyberpunk n’y échappe pas. Nombre d’éléments de son esthétique ont été transformés en clichés. C’est ce qui peut le faire paraître daté. Mais il apparaît aussi terriblement actuel, tant, à la relecture, nombre de phénomènes et tendances y semblent décrits de manière presque presciente. La globalisation y est une évidence. La connexion numérique y est de l’ordre du mode de vie. La précarité des existences y est devenue le lot commun pour la majorité. Comme il est devenu difficile de trouver à quoi se raccrocher, les vies paraissent « liquides », pour parler comme le sociologue Zygmunt Bauman. Qu’est-ce qui aide à tenir pour que les existences paraissent encore vivables ? Derrière les intrigues, il y a la vie de personnages et c’est cette dureté quotidienne que l’on sent aussi dans le cyberpunk.
Ton activité professionnelle étant du domaine universitaire et ton champ de recherches la science politique, comment en es-tu venu à te pencher sur ce genre spécifique de l’imaginaire au point d’arriver à écrire un livre sur ce sujet qui relève surtout de la culture pop ?
C’est un long parcours d’un amateur de SF qui, par le hasard des rencontres et des émulations, avait commencé à se demander comment en mettre dans la science politique. D’où toute une série d’écrits, qui avaient abouti à mon précédent livre faisant la passerelle avec mon champ de recherches initial (le traitement politique des questions écologiques). Avec mon camarade et collègue universitaire Ugo Bellagamba, auteur éminent et passionné, nous échangeons depuis de nombreuses années et avions fait quelques conférences autour du cyberpunk. Nous nous étions demandé comment valoriser ces réflexions de manière plus pérenne. Le projet est donc en fait au départ un projet à deux, mais Ugo a été rattrapé par les multiples chantiers sur lesquels il était engagé et j’en ai repris l’intégralité. Ce qui m’allait bien, car le livre permettait de pousser des réflexions qui me travaillaient depuis un moment. C’est aussi une manière de continuer à montrer qu’on peut faire des sciences sociales et de la théorie politique avec et à partir de la science-fiction.
La dimension politique du cyberpunk est bien sûr considérable et incontournable. Sous ses dehors de « série B » techno, le genre – particulièrement littérature – pointe du doigt avec des années d’avance les dérives d’un système pour lequel nous-mêmes, et notre biotope, paie une lourde facture. Alors, quels sont, à ton avis, ces symptômes politiques et sociétaux qui font de notre époque « une ère cyberpunk » ?
Il y a évidemment les tropes les plus classiques : les connexions cybernétiques des corps, la domination outrancière exercée par les mégafirmes, la violence à chaque coin de rue. L’habileté du travail de créations de monde en science-fiction, et dans le cyberpunk singulièrement, c’est de laisser imaginer comment tout cela s’emboîte, fait système. Typiquement, les innovations techniques ne sortent jamais de nulle part. Le cyberpunk rappelle par exemple que le contexte économique et politique dans lequel se développe une technologie comme l’intelligence artificielle est éminemment important. C’est aussi ce contexte qui oriente les trajectoires technologiques et les types d’utilisation qui vont s’imposer : symptomatiquement, comme pour la surenchère dans l’efficacité gestionnaire et l’extension de la surveillance (qui a peut-être d’ailleurs atteint des possibilités et un degré qui n’étaient encore guère imaginables à la grande époque du cyberpunk, dans les années 1980).
S’agissant des conditions sociales, ce sont celles d’une précarisation et d’une mise en concurrence généralisée, qui allaient devenir le lot commun de ce qu’on n’appelait pas vraiment encore « néolibéralisme » à l’époque. Dans ce qui est mis en scène comme un quotidien déprimant, tout le monde paraît accro à quelque chose : drogues plus ou moins synthétiques, réalité virtuelle, etc.
Et puis, il y a tous ces éléments du décor qui pouvaient passer pour anodins, mais qui font tellement sens aujourd’hui : la disparition de la monnaie sous sa forme matérielle (qui n’est pas qu’un effet des nouvelles technologies, mais qui peut aussi servir certains intérêts), l’omniprésence d’une multiplicité de formes de surveillance, l’urbanisation galopante, la disparition et l’artificialisation des environnements naturels, le développement du mercenariat qui devient un secteur d’activité économique à part entière. La liste pourrait être longue…
Le cyberpunk symbolise une forme de contestation incarnée dans les imaginaires de la science-fiction, mais c’est également une forme pionnière de ce que l’on appelle aujourd’hui le monde des makers, ces activistes de la société civile qui prône la réappropriation technologique… Partages-tu cette affirmation ?
Je relativiserais l’image de contestation associée au cyberpunk. Quand on parcourt les récits plus attentivement, on trouve peu de mouvements ou de formes d’opposition organisée à un système. Ce sont plus des sous-cultures qui paraissent faire leur vie à part, comme les Lo Teks ou les Panthers modernes chez William Gibson. Ou ce sont des vies individuelles qui essayent de résister comme elles peuvent aux pressions du monde qui est le leur. La brutalité du système et la dureté des conditions de vie font que l’engagement est coûteux. Alors, oui, il y a des tentatives pour jouer sur les interstices, mais qui ne peuvent guère s’agréger en mobilisations collectives. Il se trouve que, dans d’autres parties de mes travaux de recherche, je me suis aussi intéressé au makers, aux possibilités de l’impression 3D, à ce qu’on appelle la « production entre pairs sur la base de communs ». Dans le cyberpunk, par contraste, c’est souvent le règne de la débrouille parce que c’est aussi une question de survie. Dans notre monde « réel », le souhait de réappropriation des technologies reste une inclination très marginale, parce que l’effort à faire est souvent important par rapport au confort qu paraît facilement à disposition. D’autant que, du côté de la production industrielle, toutes les stratégies sont bonnes pour dissuader ce type d’effort.
Ces idées cyberpunk, somme toute positives, de réappropriation et d’autonomie de Mr. Tout le Monde contre le monopole des grandes entreprises, donnent aussi lieu à des dérives, non ? Le post-humanisme – ou une certaine idée du transhumanisme – en est une. Tu en parles dans le chapitre sur « La condition post-humaine »…
Une part de l’esprit du cyberpunk pourrait être résumée par la phrase que William Gibson a utilisée plusieurs fois dans ses premiers écrits : « La rue essaie de trouver sa propre utilisation des choses ». Ce que j’ai appelé un art du détournement. Mais, à nouveau, c’est souvent plus par nécessité : parce que, pour s’en sortir à peu près, il n’y a pas d’autres moyens que de s’adapter et d’adapter. Par conséquent, les protagonistes ne se posent pas forcément de questions sur les technologies qu’ils utilisent et qui peuvent aller jusqu’à les transformer en cyborgs par l’ajout de multiples prothèses. Pas d’autres solutions que d’être le plus efficace dans un environnement quotidien qui est éminemment dangereux. C’est ce qui produit un type particulier de glissement vers une condition « posthumaine » en effet. Mais ce n’est pas la logique transhumaniste où l’amélioration personnelle tend plutôt à être présentée comme un choix ou une opportunité permettant un dépassement ou une libération de certaines conditions d’existence. D’autant que toute la population n’a pas les mêmes moyens ou ressources à disposition. Le cyberpunk se présente aussi pour cela comme le règne du « bricolage », autrement dit de la puissance d’agir technologique réappropriée, réarrangée et réassemblée quand c’est possible.
Le cyberpunk défend des idées très contemporaines : mettre fin au règne de la boîte noire, se soucier de la protection de nos données, de notre droit à la vie privée en ligne, l’indépendance du cyberespace et la liberté pour ce que nous faisons sur les réseaux sont défendables, mais cela pose aussi questions sur la responsabilité individuelle. Ne penses-tu pas que le cyberpunk a aussi encouragé certaines tendances libertariennes qui ne sont pas des avancées sociales, mais au contraire un recul vers plus d’égoïsme digital ?
Cette lecture contemporaine relève plus de l’influence culturelle diffuse qui viendra après la vogue littéraire. Le label a en effet aussi servi à nourrir cette espèce de résistance contre-culturelle qui refusait l’enfermement dans certaines orientations technologiques. L’éthique hacker, celle des « white hackers » plus précisément, n’est pas loin de ce type d’esprit, très sensible aux effets de fermeture que peuvent amener certains dispositifs techniques.
Même s’il peut y avoir des résonances, je ne suis pas sûr que ces tendances libertariennes aient eu besoin du cyberpunk pour se répandre. Ce genre de récupérations à contresens ou qui restent dans le fétichisme technologique a plutôt fait s’interroger des auteurs comme William Gibson et Walter Jon Williams qui se demandaient comment on pouvait effacer à ce point le contexte sociopolitique inscrit dans leurs récits.
Dans ce qu’on peut observer pour la période récente, des inclinations libertariennes sont effectivement présentes dans le secteur des hautes technologies tel qu’il s’est développé aux Etats-Unis, spécialement dans la Silicon Valley, et cela soulève des questions sur le bain d’idées dans lequel naissent et sont véhiculées certaines innovations technologiques. S’agissant des logiques de développement de l’intelligence artificielle et des utilisations potentielles, c’est un vrai sujet et, pour le coup, le cyberpunk est là un très bon catalyseur de réflexion.
Certaines activités liées au piratage informatique – le pirate étant une figure majeure du mythe cyberpunk – sont devenus monnaies courantes, ou presque banales aujourd’hui : je pense au téléchargement illégal, au piratage de compte Facebook, au détournement de fonds sur les comptes bancaires. Alors, sommes-nous tous cyberpunk ?
La majorité d’entre nous reste quand même placée dans une position de consommateurs ou consommatrices. Cette situation d’hétéronomie, pour le dire avec un vocabulaire plus raffiné, est plutôt éloignée de l’esprit du hacking où il s’agit de retrouver des prises sur les systèmes techniques. De fait, ce n’est qu’une petite partie de la population qui sait à quoi ressemble du code par exemple, voire qui se soucie de ce qui est fait de ses données personnelles récupérées à la moindre connexion. Ce qui est intéressant d’un point de vue culturel, c’est par contre comment l’imaginaire cyberpunk a pu servir de support aux craintes vis-à-vis des pratiques interlopes, voire carrément illégales, qui pouvaient se développer dans et autour d’Internet.
Pour reprendre néanmoins la formule, nous sommes tous cyberpunks dans le sens où nous sommes tous quasiment connectés presque en permanence à la matrice et au cyberespace. Le smartphone est devenu une espèce de prothèse présente dans quasiment toutes les mains et on peut faire le pari qu’une part croissante de l’attention va être absorbée dans les prochains équivalents des simstims (simulated stimulations). Ce qui ne veut pas dire que tout le monde a accès aux technologies de la même manière, et ce sont les effets de ces disparités qu’éclaire aussi de manière subtile le cyberpunk.
Paradoxalement ces actes qui redistribuent des ressources peuvent être envisagés comme égoïstes, ou une forme dévoyée de capitalisme pervers, mais finalement c’est ça aussi le cyberpunk, non ? Chacun pour sa gueule… Le mouvement a d’ailleurs influencé les transhumanistes libertariens de la première heure.
Il faut toutefois faire attention aux ambiguïtés, car il y a des travaux sociohistoriques qui montrent que les pratiques de piraterie interviennent souvent sur les fronts pionniers du capitalisme, comme si elles préparaient le terrain.
Peut-être que certains transhumanistes ont pu être séduits par l’apparente mise à distance ou débiologisation du corps présente dans le cyberpunk (la « viande » évoquée dans Neuromancien). Mais la technophilie transhumaniste contraste avec le désenchantement du cyberpunk, dont les auteurs et autrices ont au moins la subtilité de replacer les technologies dans des contextes sociaux et de remettre ainsi au jour les formes d’inégalités, de domination, d’aliénation, etc. que ces technologies sont susceptibles de produire ou de favoriser. Revu avec le recul et de manière ironique, le monde cyberpunk ressemble aussi à une tendance accélérationniste qui aurait mal tourné et qui aurait invalidé l’optimisme de ce courant d’idées. Les avancées sociales n’y ont pas suivi les avancées techniques. Au contraire…
La face sombre du cyberpunk serait-elle un monde privé d’idéologie ? Ou ne supportant qu’une seule idéologie, celle, solipsiste, du « moi » souverain ?
De fait, les idéologies semblent avoir formellement disparu dans les sociétés du cyberpunk, et la seule politique qui semble prévaloir est la loi du plus fort, du plus malin, du plus retors. Les solidarités collectives ont été dissoutes, mais ce qui les remplace n’est pas le moi de l’individualisme consumériste. Le type de subjectivité qui prévaut dans ce type de monde est davantage celui de la survie, de l’apprentissage d’une existence complètement incertaine, avec donc presque l’espèce d’obligation de ne pouvoir faire confiance à personne.
Pour appuyer et développer tes idées, tu cites évidemment de nombreuses œuvres et auteurs. Quels sont les plus importants pour toi d’un point de vue idéologique justement ? Ceux qui sont les plus riches en idées, en visions aussi ?
Le corpus du livre était un corpus essentiellement littéraire et c’est toujours frustrant de limiter un objet qui a eu une influence culturelle diffuse. Neuromancien est évidemment d’une grande richesse créative : il est bourré d’idées à presque toutes les pages. Le roman tend même à écraser tous les autres textes qui ont poursuivi dans cette veine. Certes, les écrits de William Gibson ont la réputation d’être difficiles et beaucoup de monde n’accroche pas. Il faut peut-être plusieurs lectures pour en percevoir la force. Outre quelques nouvelles de William Gibson adaptées au cinéma (« Johnny Mnemonic », « Hôtel New Rose »), on pourrait aussi conseiller une superbe nouvelle de Walter Jon Williams intitulée « Solip : système », qui extrapole sur la sécession orbitale des ultra-riches (spéciale dédicace à MM. Bezos, Musk, Branson et consorts), mais elle prend tout son sel en ayant lu auparavant Câblé¸ le roman qui s’inscrit dans le même univers.
D’une certaine manière, la récente et très intéressante série Mr Robot a retrouvé une part de l’esprit cyberpunk, à commencer par le trope presque originel du hacker génial face à l’ignominieuse multinationale. On peut aussi regarder la série comme une stimulante actualisation qui a su conserver, consciemment ou inconsciemment, certains questionnements originaux.

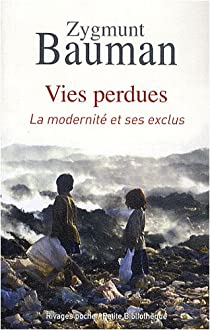

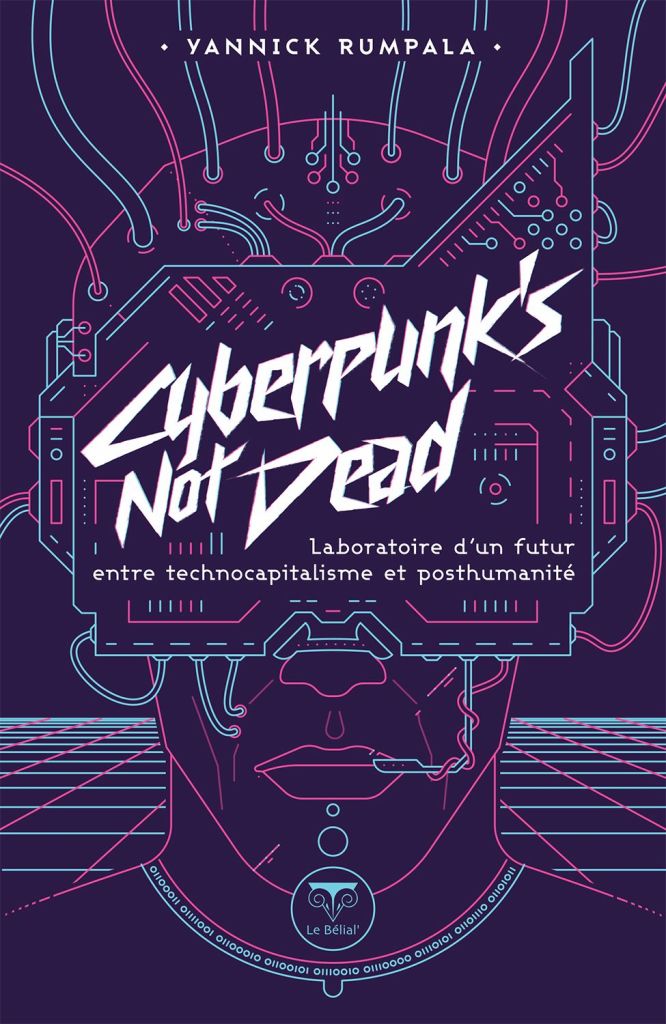

Laisser un commentaire