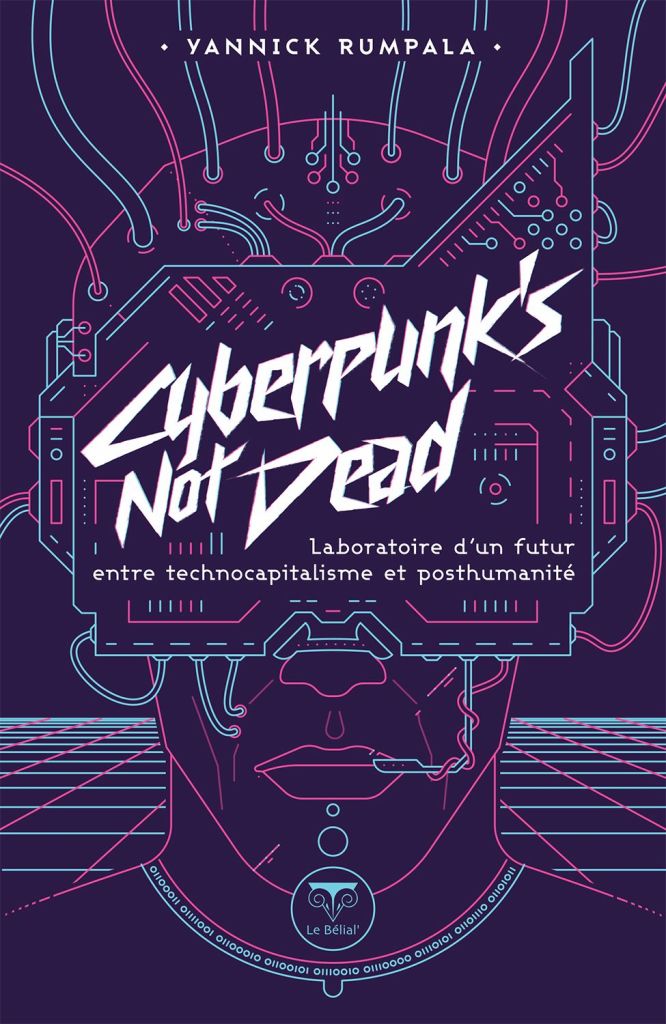Que faire face à l’apocalypse ? Début de réponse et première partie de la contribution qui sera présentée au colloque international « Formes d(e l)’Apocalypse » (15-17 mars 2016).
* * *
Les visions d’effondrement et d’apocalypse ne commencent évidemment pas avec la science-fiction[1]. Mais les productions du genre ont notablement contribué à les entretenir[2]. Ces représentations fictionnelles sont des manières particulières d’envisager des mondes possibles et de les explorer, sous les formes les plus funestes en l’occurrence. Parmi le vaste ensemble des productions culturelles, la science-fiction est un genre qui se distingue pour ce qu’il ajoute de radicalement original par rapport au monde connu[3]. La figure de l’apocalypse y a été digérée et traduite sous différentes formes, d’ailleurs évolutives et plus souvent détachées des connotations religieuses originelles.
Les visions du monde ainsi véhiculées peuvent avoir des particularités, et donc des résonances, qui justifient une considération plus attentive. Un des mérites de la réflexion de Fredric Jameson, même si on n’est pas obligé d’en partager tous les présupposés, a été de souligner que les récits véhiculés dans les productions littéraires (et culturelles plus généralement) ont une dimension politique qu’il s’agit de pouvoir interpréter, précisément comme des « actes socialement symboliques » à situer simultanément dans un fil historique[4].
Sur un plan diachronique, les représentations de la science-fiction sont intéressantes dans ce qu’elles donnent à voir des façons dont des collectifs perçoivent leurs vulnérabilités à différents moments de leur histoire. Dans ces visions, les risques qui pesaient sur l’existence de l’espèce humaine ou sur de vastes populations sont réalisés et ont des effets pleinement matériels. En l’occurrence, c’est la vieille thématique du destin des civilisations qui est ainsi reprise, en rappelant qu’aucune ne peut échapper à la menace de l’extinction.
Ces représentations sont aussi une manière de pointer et qualifier des tendances potentiellement problématiques. Elles donnent des aperçus plus ou moins larges sur le système qui génère ces tendances. Ce faisant, elles constituent aussi à la fois une interprétation et une prolongation d’enjeux déjà plus ou moins formalisés, ce qui peut effectivement leur donner un arrière-plan politique.
Il y a maintenant une gamme de travaux qui permet de disposer d’un panorama de ces apocalypses et de voir comment est entretenu cet imaginaire de la destruction. En essayant d’en faire un catalogue, Alain Musset montre la variété (croissante même) avec laquelle les productions de science-fiction ont imaginé « [c]omment détruire le monde », et notamment ces symboles civilisationnels que sont les villes[5]. Certaines figures sont même récurrentes, ce qui permet à Sébastien Jenvrin de distinguer quatre types de fin du monde : la fin du monde par intrusion, la fin du monde par stérilité, la fin du monde par autodestruction et la fin du monde en douceur[6].
En creux, dystopies et apocalypses signalent ce qui peut être perdu par rapport au monde connu. De ce monde, il ne resterait que des vestiges. Des traces encore (re)connaissables, mais marquant surtout ce qui serait effacé de la civilisation précédente.
Le contenu symbolique véhiculé absorbe les angoisses de chaque époque. Les changements technologiques, réalisés ou annoncés, et les craintes qui ont pu en résulter ont renouvelé les formes d’apocalypse possibles. Ils ont contribué à ancrer l’idée que si apocalypse il y a, elle pourrait être largement une production des hommes. Le Progrès et la Raison n’auraient pas réduit la possibilité d’une catastrophe généralisée. Au contraire, sous-entend la grande masse de ces récits.
 L’angoisse atomique a été emblématique de la période qui a suivi les premières démonstrations des usages militaires du nucléaire. La vie après une catastrophe nucléaire (guerre ou accident) est devenue un thème classique en science-fiction, avec le postulat fréquent que le fonctionnement des sociétés humaines serait évidemment bouleversé. Dans Un cantique pour Leibowitz de Walter M. Miller[7], c’est la question du rapport à la science et à ses utilisations potentiellement destructrices que la situation, après le « Grand Déluge de Flammes », permet de poser. La tonalité du récit est même plutôt pessimiste, puisque les humains n’apprendront pas de leurs erreurs et produiront à nouveau les conditions pour une autre guerre nucléaire.
L’angoisse atomique a été emblématique de la période qui a suivi les premières démonstrations des usages militaires du nucléaire. La vie après une catastrophe nucléaire (guerre ou accident) est devenue un thème classique en science-fiction, avec le postulat fréquent que le fonctionnement des sociétés humaines serait évidemment bouleversé. Dans Un cantique pour Leibowitz de Walter M. Miller[7], c’est la question du rapport à la science et à ses utilisations potentiellement destructrices que la situation, après le « Grand Déluge de Flammes », permet de poser. La tonalité du récit est même plutôt pessimiste, puisque les humains n’apprendront pas de leurs erreurs et produiront à nouveau les conditions pour une autre guerre nucléaire.
La peur de la pandémie capable de décimer l’humanité a aussi évolué. Ce n’est plus seulement une origine naturelle qui paraissait à craindre, mais aussi des recherches, expérimentations, ou utilisations qui pouvaient mal tourner. L’évolution du postulat narratif de départ de Je suis une légende, entre le roman de Richard Matheson (1954) et le film de Francis Lawrence (2007), est à cet égard symptomatique (dans le film, c’est plus explicitement la manipulation d’un virus destiné à lutter contre le cancer qui devient problématique et dérive en catastrophe).
Si les enjeux démographiques ont trouvé une résonance notable dans la littérature de science-fiction, c’est aussi pour une large part sous une forme dystopique et catastrophiste. Dans les années 1950 et 1960, les productions culturelles, et logiquement la littérature, ont servi de cadre à ce que Brian Stableford a qualifié de résurgence des « anxiétés malthusiennes »[8]. La fin des années 1960 et le début des années 1970 ont ainsi été marqués par le thème de la surpopulation, comme dans Tous à Zanzibar du britannique John Brunner[9]. Andreu Domingo a repéré d’autres thèmes formant selon lui un genre à part entière mobilisant les enjeux démographiques et qu’il a qualifié de « démodystopies »[10]. Il y englobe les fictions qui traitent de vieillissement généralisé, de dépopulation, de migrations internationales massives, de technologies reproductives et eugéniques.
L’angoisse écologique est logiquement venue s’ajouter concomitamment à la montée des préoccupations environnementales. Là aussi, des travaux ont permis de suivre comment la dévastation ou la disparition de la « nature » a pu venir se mêler aux récits apocalyptiques et dystopiques[11]. Ce qui est alors intéressant, ce sont les conséquences et effets que ce genre de situation permet de mettre en scène.
La science-fiction est un support imaginaire qui s’est avéré particulièrement attractif pour aller jusqu’aux aboutissements possibles des crises écologiques[12]. Cette anxiété accrue à l’égard de la possibilité d’un désastre écologique, Brian Stableford en repère la traduction littéraire dans l’entre-deux-guerres et la met en relation avec les phénomènes de « Dust Bowl », ces tempêtes de poussière qui ont marqué certains États américains du Middle West touchés par la sécheresse dans les années 1930[13]. Mais l’amplification s’est surtout produite avec le développement des mobilisations environnementales dans les années 1960. Dans ces visions, où le futur écologique s’annonce sinistre, se construisent des figures communes qui permettent à Frederick Buell de parler de « science-fiction écodystopique » pour cet ensemble. Dans son étude de ces productions littéraires et cinématographiques[14], il est même plus précis en repérant quatre phases dans l’histoire récente de ce qui est presque devenu un sous-genre. Les années 1970 correspondent à la montée et à la constitution d’une première vague intégrant les problèmes environnementaux dans le sillage du mouvement écologiste américain. Frederick Buell raccroche la deuxième phase à l’émergence du cyberpunk dans les années 1980. Dans ces visions sombres mêlant hautes technologies et désagrégation sociale, l’apocalypse environnementale n’est pas représentée comme la fin de tout : c’est le milieu dans lequel les populations doivent vivre dès lors que les limites de la nature ont été dépassées (le film Blade Runner [1982] traduisant visuellement ce type d’environnement). Cette situation peut même être à l’origine d’une forme d’excitation, par ce qu’elle stimule comme possibilités pour de nouveaux modes d’existence (comme dans les écrits de Bruce Sterling, notamment La schismatrice[15], où deux voies de transformation, génétiques et mécaniques, tendent à s’affronter). La troisième phase, celle du post-cyberpunk, est celle où les préoccupations environnementales deviennent un thème central des récits, au-delà donc de l’arrière-plan, perdant ainsi une partie de leur tonalité contre-culturelle pour devenir plus communes. Enfin, la quatrième phase est en fait celle d’un dépassement des frontières de la science-fiction, permettant de s’insérer dans des productions culturelles plus « mainstream » (ce qu’on verra plus récemment avec des films comme Wall-E [2008], etc.).
S’il est aisé de constater son développement, cette masse croissante de représentations est aussi à replacer par rapport à des évolutions culturelles plus larges. Si l’on suit Christian Chelebourg, ces représentations sont à ranger dans ce qu’il appelle des « écofictions », qui sont pour lui « les produits de ce nouveau régime de médiatisation des thèses environnementalistes ». Il précise d’ailleurs immédiatement que : « Leur champ ne se limite donc pas aux seules œuvres de fiction : il englobe l’ensemble des discours qui font appel à l’invention narrative pour diffuser le message écologique »[16]. Pour explorer ces représentations littéraires et cinématographiques de la fin du monde (en ne se limitant donc pas à la science-fiction), Christian Chelebourg distingue dans son livre cinq thèmes devenus récurrents et qui ont été investis fictionnellement : pollution, climat, catastrophe, épidémie, évolution.
L’apocalypse peut finir par arriver lorsque des pollutions dépassent des seuils qui rendent les environnements invivables. La « nature » est transformée à tel point qu’elle en devient méconnaissable avec des critères jusque-là communs. La solution désespérée, la seule qui resterait, peut être alors de laisser partir dans l’espace ce qui a pu subsister de végétation d’origine terrestre, dans une espèce d’arche interstellaire comme dans le film Silent Running (1972).
Dans la période la plus récente, les craintes associées aux signes d’évolutions du climat planétaire ont ajouté d’autres inquiétudes globales, qui ont aussi trouvé des résonances dans la fiction, ouvrant même la voie à un sous-genre à part entière (la « climate fiction », ou « cli-fi »[17]) et devenant également propice à des représentations de situations apocalyptiques. Dans les œuvres qui mettent en scène les conséquences d’un accroissement de l’effet de serre, Brian Stableford note d’ailleurs un évanouissement tendanciel de la confiance dans la possibilité de ralentir la catastrophe[18].
Si la nature encaisse, c’est toutefois jusqu’à un certain seuil. Et sa réaction, face aux mauvais traitements (longuement) subis, peut alors ressembler à de la vengeance, dont vont indistinctement pâtir les humains, même si tous n’ont pas la même responsabilité[19]. Au bout du compte, quand les dégradations se seront accumulées au point de devenir irréversibles, les machines remplaceront alors peut-être les humains sur ce qu’il restera d’écosystèmes. Elles apparaîtront peut-être finalement comme l’espèce la plus adaptée à ces nouveaux milieux, tel Wall-E, petit robot et nouveau Sisyphe assigné à l’interminable nettoiement des colossales quantités de déchets laissés sur la planète.
Dans les représentations perce aussi une méfiance à l’égard des tentations que peuvent représenter certaines options technologiques présentées comme solutions. Face à un risque collectif, la recherche d’un remède peut elle-même engendrer la catastrophe. Au vu des descriptions de leurs effets possibles dans la science-fiction, les promesses de la géo-ingénierie semblent encore largement peiner à convaincre. Le film Snowpiercer, le Transperceneige (2013) va plus loin que la BD dont il est inspiré, puisque, dans son postulat narratif, il suggère que l’hiver généralisé qui a envahi la planète, condamnant des survivants à un éternel déplacement en train, est le résultat d’une forme de géo-ingénierie climatique ayant mal tourné.
Une part de la littérature post-apocalyptique laisse du reste affleurer une angoisse de la régression technologique. Comme si revenir à une société de rareté ou de pénurie devait être symboliquement conçu comme l’inévitable châtiment collectif à subir par conséquence d’un effondrement généralisé. Autrement dit, comme si la « société de consommation » avait créé des habitudes tellement fortes que la perspective de sa disparition ne pouvait s’exprimer que sous une forme angoissante. Par contraste, la quête sans limite et sans fin de ressources (y compris hors de la Terre), pour nourrir la mégamachine économique, finit presque par paraître plus réaliste et continue, de fait, à nourrir un autre imaginaire, fait de récits d’expansion et de conquête spatiale.
La puissance croissante des machines a ajouté une variété supplémentaire de craintes, qui sont devenues autant de points de départ pour décrire d’autres aboutissements catastrophiques menaçant potentiellement l’humanité et/ou la planète. Avec les avancées conjointes de l’informatique et de l’automatisation se sont ainsi développées les visions dans lesquelles une ou des intelligences artificielles pourraient supprimer tout ou partie de l’humanité. Comme dans les films Terminator, Matrix et leurs dérivés, pour les exemples les plus marquants, les groupes d’humains rescapés en sont réduits à essayer de trouver des formes de résistance. Leur survie est d’autant plus difficile que leur environnement est ravagé (dans un court métrage de la série des Animatrix[20], situé dans le passé précédent Matrix, on apprend même que ce sont les humains eux-mêmes qui ont essayé de priver les machines d’énergie solaire en assombrissant volontairement le ciel).
 Certaines visions de mondes en ruine paraissent venir non pas simplement comme un reflet inquiet de tendances globales en cours, mais plutôt comme une tentative de réaction à celles-ci. Ainsi de Snowpiercer, le Transperceneige à nouveau, film interprétable, selon Gerry Canavan, précisément comme une réaction critique aux penchants qu’il qualifie de « nécrofuturistes » : ces penchants où le futur paraît enfermé dans des tendances mortifères du fait notamment des pratiques capitalistes, poursuivies même si elles sont non durables et immorales. Le film permettrait de suggérer que ce « nécrocapitalisme », loin d’être sans alternative, n’est pas nécessairement destiné à se perpétuer indéfiniment, qu’il est un agencement de choix pouvant être remplacés par d’autres choix, à partir desquels il devient alors possible de penser la construction d’autres mondes[21].. Jusqu’où la rationalité économique, dans sa version la plus prédatrice, peut-elle s’étendre ? À la limite, la Terre dans sa totalité n’a plus de valeur, comme dans la bande dessinée Universal War One (1998-2006)[22], où les Compagnies Industrielles de Colonisation, riche et puissant consortium parti chercher ailleurs les ressources minières, n’hésitent pas à détruire la planète pour assurer la poursuite de leurs intérêts. Dans ces apocalypses largement volontaires ou dérivées de choix conscients, le système capitaliste semble prêt à aller jusqu’à l’effondrement total plutôt que de se réformer.
Certaines visions de mondes en ruine paraissent venir non pas simplement comme un reflet inquiet de tendances globales en cours, mais plutôt comme une tentative de réaction à celles-ci. Ainsi de Snowpiercer, le Transperceneige à nouveau, film interprétable, selon Gerry Canavan, précisément comme une réaction critique aux penchants qu’il qualifie de « nécrofuturistes » : ces penchants où le futur paraît enfermé dans des tendances mortifères du fait notamment des pratiques capitalistes, poursuivies même si elles sont non durables et immorales. Le film permettrait de suggérer que ce « nécrocapitalisme », loin d’être sans alternative, n’est pas nécessairement destiné à se perpétuer indéfiniment, qu’il est un agencement de choix pouvant être remplacés par d’autres choix, à partir desquels il devient alors possible de penser la construction d’autres mondes[21].. Jusqu’où la rationalité économique, dans sa version la plus prédatrice, peut-elle s’étendre ? À la limite, la Terre dans sa totalité n’a plus de valeur, comme dans la bande dessinée Universal War One (1998-2006)[22], où les Compagnies Industrielles de Colonisation, riche et puissant consortium parti chercher ailleurs les ressources minières, n’hésitent pas à détruire la planète pour assurer la poursuite de leurs intérêts. Dans ces apocalypses largement volontaires ou dérivées de choix conscients, le système capitaliste semble prêt à aller jusqu’à l’effondrement total plutôt que de se réformer.
Au total, tout en détruisant les habitats, les apocalypses emportent avec eux l’ordre existant. Elles se caractérisent par leurs effets systémiques qui rendent difficiles les échappatoires. Les sociétés représentées y sont mises face à leur contingence historique et leur devenir incertain. Si promesses il y a, elles sont essentiellement négatives et guère désirables. Vivre est-il encore une chance dans un monde qui est devenu difficilement vivable ? Ces représentations se déploient et s’agencent comme s’il s’agissait de ramener les humains à la modestie. Ce qui apparaît au bout du compte mis en scène et par la même occasion problématisé, c’est la difficulté d’assurer une continuité positive au destin collectif, de maitriser le changement, autrement dit la fragilité des prises collectives sur celui-ci.
___________________________
[1] Sur cette longue histoire et les mythes qui l’ont abondamment nourri, voir par exemple Karolyn Kinane and Michael A. Ryan (eds), End of Days: Essays on the Apocalypse from Antiquity to Modernity, Jefferson, McFarland, 2009.
[2] Cf. Lorenzo DiTommaso, « At the Edge of Tomorrow: Apocalypticism and Science Fiction », in ibid. et Roslyn Weaver, « “The shadow of the end”: the appeal of apocalypse in literary science fiction », in John Walliss and Kenneth G. C. Newport (eds), The End All Around Us: Apocalyptic Texts and Popular Culture, Oxon, Routledge, 2014, pp. 173-197.
[3] Ce qu’on peut rapprocher de la notion de « novum » proposée par Darko Suvin pour marquer cette part de nouveauté ou de différence. Cf. Darko Suvin, Metamorphoses of Science Fiction. On the Poetics and History of a Literary Genre, New Haven, Yale University Press, 1979.
[4] Fredric Jameson, L’inconscient politique. Le récit comme acte socialement symbolique, Paris, Questions Théoriques, 2012.
[5] Alain Musset, Le syndrome de Babylone. Géofictions de l’apocalypse, Paris, Armand Colin, 2012.
[6] Sébastien Jenvrin, « Catastrophe, sacré et figures du mal dans la science-fiction : une fonction cathartique », Le Portique, n° 22, 2009. URL : http://leportique.revues.org/index2203.html
[7] Paris, Denoël, 1961 (A Canticle for Leibowitz, Philadelphia, Lippincott, 1960).
[8] Brian Stableford, « Ecology and Dystopia », in Gregory Claeys (ed.), The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, p. 270-273.
[9] Paris, LGF / Livre de Poche, 1995 (Stand on Zanzibar, Garden City, Doubleday, 1968).
[10] Andreu Domingo, « « Demodystopias »: Prospects of Demographic Hell », Population and Development Review, vol. 34, n° 4, December 2008, pp. 725-745.
[11] Sur la dimension écologique dans la science fiction à tendance apocalyptique, voir par exemple « Critical Political Theory and Apocalyptic Science Fiction », in Ernest J. Yanarella, The Cross, the Plow and the Skyline. Contemporary Science Fiction and the Ecological Imagination, Parkland, Brown Walker Press, 2001.
[12] Cf. Keira Hambrick, « Destroying Imagination to Save Reality: Environmental Apocalypse in Science Fiction », in Chris Baratta (ed.), Environmentalism in the Realm of Science Fiction and Fantasy Literature, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2012, pp. 129-142.
[13] Brian Stableford, « Ecology and Dystopia », in Gregory Claeys (ed.), The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 2010, notamment p. 270.
[14] Cf. « Representing Crisis: Environmental Crisis in Popular Fiction and Film », in Frederick Buell, From Apocalypse to Way of Life: Environmental Crisis in the American Century, London, Routledge, 2003.
[15] Paris, Denoël, 1986 (Schismatrix, New York, Arbor House, 1985).
[16] Christian Chelebourg, Les écofictions. Mythologies de la fin du monde, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 2012, p. 10-11.
[17] Voir par exemple Rodge Glass, « Global warning: the rise of ‘cli-fi’ », The Guardian, Friday 31 May 2013, http://www.theguardian.com/books/2013/may/31/global-warning-rise-cli-fi ; Rebecca Tuhus-Dubrow, « Cli-Fi: Birth of a Genre », Dissent, n° 60(3), Summer 2013, pp. 58-61, http://www.dissentmagazine.org/article/cli-fi-birth-of-a-genre
[18] Brian Stableford, « Ecology and Dystopia », in Gregory Claeys (ed.), The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
[19] Cf. « 4. Gaïa contre-attaque », in Alain Musset, Le syndrome de Babylone. Géofictions de l’apocalypse, Paris, Armand Colin, 2012.
[20] Animatrix, La Seconde Renaissance (partie II), 2003.
[21] Gerry Canavan, « “If the Engine Ever Stops, We’d All Die”: Snowpiercer and Necrofuturism », Paradoxa, n° 26, 2014, pp. 41-66.
[22] Denis Bajram, Universal War One, L’intégrale (Tome 1 à Tome 6), Toulon, Quadrants, 2014.
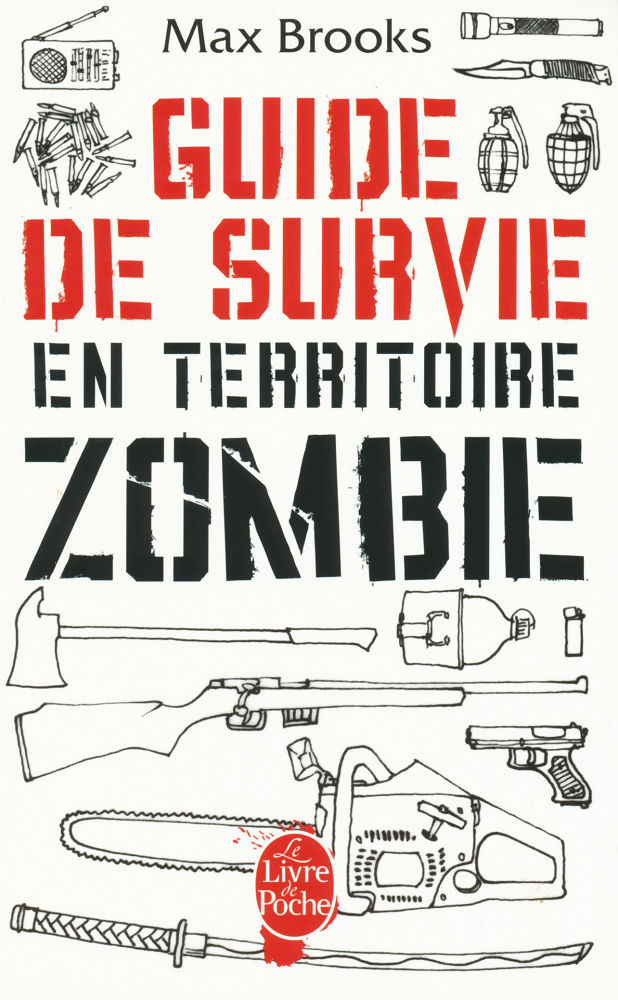
 L’angoisse atomique a été emblématique de la période qui a suivi les premières démonstrations des usages militaires du nucléaire. La vie après une catastrophe nucléaire (guerre ou accident) est devenue un thème classique en science-fiction, avec le postulat fréquent que le fonctionnement des sociétés humaines serait évidemment bouleversé. Dans
L’angoisse atomique a été emblématique de la période qui a suivi les premières démonstrations des usages militaires du nucléaire. La vie après une catastrophe nucléaire (guerre ou accident) est devenue un thème classique en science-fiction, avec le postulat fréquent que le fonctionnement des sociétés humaines serait évidemment bouleversé. Dans  Certaines visions de mondes en ruine paraissent venir non pas simplement comme un reflet inquiet de tendances globales en cours, mais plutôt comme une tentative de réaction à celles-ci. Ainsi de Snowpiercer, le Transperceneige à nouveau, film interprétable, selon Gerry Canavan, précisément comme une réaction critique aux penchants qu’il qualifie de « nécrofuturistes » : ces penchants où le futur paraît enfermé dans des tendances mortifères du fait notamment des pratiques capitalistes, poursuivies même si elles sont non durables et immorales. Le film permettrait de suggérer que ce « nécrocapitalisme », loin d’être sans alternative, n’est pas nécessairement destiné à se perpétuer indéfiniment, qu’il est un agencement de choix pouvant être remplacés par d’autres choix, à partir desquels il devient alors possible de penser la construction d’autres mondes
Certaines visions de mondes en ruine paraissent venir non pas simplement comme un reflet inquiet de tendances globales en cours, mais plutôt comme une tentative de réaction à celles-ci. Ainsi de Snowpiercer, le Transperceneige à nouveau, film interprétable, selon Gerry Canavan, précisément comme une réaction critique aux penchants qu’il qualifie de « nécrofuturistes » : ces penchants où le futur paraît enfermé dans des tendances mortifères du fait notamment des pratiques capitalistes, poursuivies même si elles sont non durables et immorales. Le film permettrait de suggérer que ce « nécrocapitalisme », loin d’être sans alternative, n’est pas nécessairement destiné à se perpétuer indéfiniment, qu’il est un agencement de choix pouvant être remplacés par d’autres choix, à partir desquels il devient alors possible de penser la construction d’autres mondes