À propos de :
Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence. Une anthropologie des Modernes, Paris, La Découverte, 2012.
Le compte rendu qui suit vient de paraître dans la Revue française de science politique (vol. 63, n° 3-4, Juin-Août 2013).
* * *
Le dernier livre de Bruno Latour peut passer pour un objet curieux, autant dans son positionnement que dans son contenu. Il a d’abord l’ambition d’être plus qu’un livre. Les lecteurs sont, en effet, invités à se reporter conjointement à un site Internet (http://www.modesofexistence.org/index.php/site/index), censé donner accès à un « livre augmenté » ainsi que les moyens de contribuer eux-mêmes à la réflexion proposée. L’époque étant aux démarches collaboratives et contributives, l’ambition affichée est ainsi de pouvoir associer les lecteurs à l’enquête (s’ils ne finissent pas noyés dans les circonvolutions de l’argumentation, comme on le verra). Pour partie, le livre est le prolongement d’un autre plus ancien qui, dans une forme de provocation, avait été intitulé Nous n’avons jamais été modernes. Essai d’anthropologie symétrique (Paris, La Découverte, 1991). Il est même censé en constituer la réponse, la version « positive », en présentant ce que « nous » avons alors été, à défaut d’avoir été modernes, en d’autres termes en repérant les valeurs qui sont désormais présumées constituer l’héritage collectif des derniers siècles. Le lecteur habitué aux écrits de Bruno Latour retrouvera la part maintenant récurrente de mise en scène personnelle, consistant notamment à expliquer, à lui lecteur naïf, que le monde entier a été jusque-là dans l’erreur et l’obscurité et qu’il se charge d’apporter la lumière nécessaire.
L’ouvrage a une ambition systématique, notamment par l’étendue qu’il prétend couvrir, et apparaît présenté comme un travail d’anthropologie philosophique. Comme l’indique le sous-titre, il s’agit en effet d’une « anthropologie des Modernes », plus précisément d’une étude de ce par quoi les « Modernes » auraient été obsédés. L’orientation ontologique de ce travail donne à l’argumentation des accents métaphysiques, qui ne sont pas sans rejoindre une espèce d’effet de mode diffus dans certaines communautés philosophiques qui peuvent maintenant, grâce à Internet, discuter de manière transnationale. Le lecteur est convié à accompagner l’enquête d’une anthropologue et à suivre ses perplexités et découvertes. Il devra s’accrocher au moins autant que cette enquêtrice fictive pour pénétrer une argumentation à la fois touffue et tortueuse. Le lecteur un peu déboussolé ne pourra d’ailleurs pas s’appuyer sur ce qui peut aider habituellement en science sociales, à savoir des notes de bas de page avec des références ou une bibliographie indiquant les points d’appui de l’auteur. Était-il censé faire des allers-retours constants entre le livre et le site ? Ce site compagnon l’aidera en fait peu puisqu’il ne semble guère avoir évolué depuis sa mise en ligne et qu’il en est resté, malgré les mois écoulés, à une présentation des grandes orientations de l’enquête.
Dommage, car la tendance de l’auteur à enrober ses positions fait qu’on finit souvent par ne plus savoir par quel bout les prendre. L’impression est en effet celle d’une espèce de long exercice intellectuel dans un univers à part. Nombreux sont ainsi les moments où l’on avance dans la lecture en se demandant où l’auteur veut en venir. D’autant qu’on ne peut pas dire qu’un gros effort soit fait pour définir ou expliciter les notions et termes utilisés. Certes, il s’agit d’une enquête sur des « modes d’existence », dont on peut à la limite convenir qu’elle soit sans a priori ontologique, mais est-ce pour autant qu’il ne faille rien définir ou situer dans un espace intellectuel (potentiellement controversé, comme l’auteur, promoteur de « cartographies des controverses », est bien placé pour le savoir) ? Quand Bruno Latour donne l’apparence de critiquer des positions, le lecteur est bien embêté pour savoir à qui ou à quoi il se réfère, ce qui est d’autant plus gênant lorsqu’on est amené à se demander si les supposés porteurs de ces positions existent vraiment. Avec le même aplomb, l’argumentation peut aussi prétendre parler des « Modernes » sans fournir aucun repère temporel. Pour apprendre ce que « nous » sommes ou ne sommes pas (« modernes » ou non), encore faut-il au moins des définitions, des points de référence (temporels, géographiques). Il ne faudra pas compter sur le texte (et guère plus sur le paratexte) pour les avoir. Cette absence de références peut paraître d’autant plus surprenante que la modernité comme sujet de réflexion a rempli des rayonnages entiers. L’auteur fait le choix d’ignorer d’autres types de réflexions plus ou moins récentes qui ont été influentes en la matière (celles d’Hannah Arendt, de Zygmunt Bauman, d’Anthony Giddens, de Jürgen Habermas, d’Alain Touraine pour n’en citer que quelques-unes). Comme s’il était seul à essayer d’aborder ce type de thématique. Bien sûr, il est facile de les écarter en prétendant qu’elles raisonnent à partir de catégories défectueuses. Et pourraient être aussi évoquées les « modernités multiples », pour reprendre un autre champ de recherches prétendant également à un décentrement par rapport à la trajectoire occidentale et à ses expressions culturelles. Les quelques rares appuis évoqués sont ceux relatifs à la notion de « mode d’existence », empruntée au philosophe de l’esthétique Étienne Souriau et au philosophe des techniques Gilbert Simondon. La notion permet à Bruno Latour de donner un cadre englobant à la lutte contre différents dualismes qu’il poursuit depuis quelques décennies : signe/chose, sujet/objet, nature/culture, matière/esprit, esprit/corps, etc. Là aussi, la notion de mode tend à être traitée comme si elle était évidente et homogène. Elle donne en tout cas à Bruno Latour les bases d’un métalangage qui va donc lui permettre de comparer des « modes d’existence » et de proposer une forme de pluralisme ontologique. L’intention est en effet d’accéder à des régimes de vérité tout en préservant leur pluralité. Chacun de ces « modes d’existence » impliquerait des formes de véridiction (contribuant à distinguer le vrai et le faux) et, à l’instar des actes de langage, des conditions de félicité spécifiques. Par rapport à ces formes et conditions, il serait ainsi possible d’apprécier les modalités de constitution et d’intervention de toute entité contribuant à composer notre monde. La perspective sous-jacente est aussi celle de la tradition pragmatique, spécialement celle du philosophe américain William James, qui fournit une part des inspirations et qui lui paraît être la théorie politique adéquate pour aborder ces questions.
Si le projet affiché par Bruno Latour est celui d’une « philosophie empirique », sa réalisation tend souvent ici à se détacher de l’empirie. De longs arguments sont déroulés sans ancrages empiriques. Retour donc à d’anciennes aspirations philosophiques, celles des débuts intellectuels de l’auteur, mais à un niveau d’analyse qui, au-delà de quelques exemples construits pour conforter l’argumentation, se situe loin du monde prétendument décrit. Beaucoup de lecteurs qui croiraient retrouver le Bruno Latour sociologue risquent donc d’être surpris, car l’exercice engagé amène et laisse le plus souvent dans le monde des abstractions, avec d’étonnants accents religieux en plus. Pour ceux qui l’ont suivi depuis quelques années, une large part des idées ne sera pas non plus nouvelle. Ce sont notamment celles qui incitent à réévaluer les distinctions (devenues familières et incapacitantes) entre faits et valeurs, entre science et politique, entre nature et culture, entre sujets et objets. L’ouvrage laisse toutefois l’impression bizarre que la pensée de Bruno Latour n’est pas allée dans le sens de la simplicité et de la clarté (bon courage pour comprendre le tableau des quinze « modes d’existence » repérés qui est censé synthétiser la réflexion à la fin de l’ouvrage). La lecture donne le sentiment fréquent que les arguments pourraient être formulés de manière bien plus simple, moins alambiquée, moins contournée (ou alors c’est l’orientation ontologique et métaphysique qui veut cela). Pour être sûr de bien comprendre l’auteur, il n’est souvent pas inutile de reprendre aussi ses articles récents, qui s’avèrent de fait généralement plus clairs.
L’entreprise générale est présentée comme un travail de reconstruction, celle du système des valeurs des « Modernes ». Ce dernier ne se réduirait pas à un avènement de la Raison, de surcroît dans sa version occidentale, et il faudrait donc en faire une présentation plus « réaliste ». De l’histoire qui nous aurait été racontée, il faudrait autrement dit d’abord se départir, car elle serait trop facilement ramenée à celle de la Raison et de ses différents prolongements (scientifiques, organisationnels, économiques, etc.) diffusés par les « Modernes » dans toutes les régions du monde qu’ils auraient explorées, découvertes et occupées. Dans ce mouvement, cette prétention rationalisante aurait surtout eu tendance à scinder le monde, au surplus sur de multiples plans, sur le modèle du sujet, avec son esprit propre, face à quelque chose d’autre, relevant du matériel, du naturel et tendanciellement traité en objet. Avec ce genre de conception, nous est-il expliqué, il deviendrait difficile d’articuler des éléments autant séparés, ce qui effectivement peut paraître problématique lorsqu’un simple regard autour de soi suffit à montrer un monde peuplé de manière croissante par des « hybrides » : « Le but était de s’extraire le plus complètement possible des notions de Nature, de Matière, d’Objet et de Sujet pour donner à l’expérience des différents modes le soin de nous guider » (p. 298).
D’autres « modes d’existence » sont donc à retrouver pour faire réapparaître la pluralité des régimes de vérité que les « Modernes » ont déployés au fur et à mesure. L’enquête doit alors passer par ces lieux centraux qui contribuent à produire les « vérités » orientant les collectivités et qui sont couramment désignés comme relevant de la science, de la technique, du droit, de la politique, etc. Incité à réajuster ses manières de voir le monde, le lecteur devra aussi essayer de se repérer dans des qualificatifs multiples entre lesquels les liens sont difficiles à établir : Bruno Latour parle non seulement de modes, mais aussi d’institutions, de domaines. Les réseaux mis en avant dans ses travaux antérieurs sont toujours présents (l’auteur précise ainsi d’une autre manière « l’objet de cette enquête : continuer de suivre la multiplicité indéfinie des réseaux mais en qualifiant les manières, chaque fois distinctes, qu’ils ont de s’étendre », p. 60), mais ces réseaux paraissent jouer un rôle réévalué. Ils sont maintenant considérés comme un « mode d’existence » parmi d’autres, celui marquant en l’occurrence la capacité de traverser les « domaines » et de connecter des éléments hétérogènes. Ce qu’il appelle les « domaines » semble être une manière de reprendre la technique, la politique, le droit, l’économie, la morale, vers lesquels Bruno Latour avait étendu ses réflexions. Si la conception de la science reste dans la perspective des réflexions antérieures, elle est toutefois davantage envisagée dans l’ouvrage à travers le terme de « référence », qui est censé souligner les multiples médiations et attachements contribuant pour les scientifiques à la solidité des liens avec ce qui les occupe et dont ils parlent dans leur travail.
L’auteur privilégie une ontologie qu’on pourrait qualifier de plate et de relationnelle. Plate parce que, dans sa perspective, le monde ne peut pas être conçu comme s’il s’ordonnait sur plusieurs niveaux (micro et macro) et que, dans les descriptions à faire, aucun être ou « actant » ne peut y avoir un quelconque privilège, une quelconque supériorité intrinsèque (d’où le fréquent recours dans ses écrits à un procédé rhétorique que certains auteurs anglophones comme Ian Bogost ont baptisé « Latour litanies », typiquement des petites listes qui permettent de faire suivre et de mettre sur le même plan des personnes, des objets techniques, des animaux, etc.). Relationnelle parce que ce qui est premier pour lui, ce sont les relations, et non des entités (dont il n’est plus possible alors de présupposer une substance ou une identité). Le monde est toujours en train de se faire à travers les agencements hétérogènes, hybrides, formés par des relations évolutives entre des êtres qui sont loin d’être seulement des humains. L’erreur serait de passer par un « méta-répartiteur », quel qu’il soit (Nature, Société, Marché, a fortiori avec des majuscules).
Ce vaste changement de perspective doit permettre de sortir des illusions que les « Modernes » ont eux-mêmes entretenues, dans une sorte de conduite paradoxale où ce qu’ils ont fait en pratique n’a pas correspondu à ce qu’ils prétendaient faire. Le « Moderne », c’est celui qui voit les autres comme ceux qui croient, mais sans voir qu’il a lui aussi ses propres croyances. Revenir sur la modernité, c’est donc revenir sur les catégories qui ont été installées avec elle pour ramener les « Modernes » à une position d’humains ordinaires, qui ne pourraient pas se targuer d’une supériorité de la Raison. Les « Modernes » en auraient trop abusé pour affirmer une séparation entre la « culture » et la « nature » ; ils auraient amalgamé la « Science » avec la Raison pour prétendre accéder à l’objectivité et se dégager d’une espèce d’emprise qui leur semblait extérieure. Et s’ils ont certes composé un monde, ce serait par une gigantesque exclusion, en se constituant une « société », mais en faisant comme si cette dernière pouvait s’élever et s’organiser politiquement à l’écart des « non-humains », pourtant en pratique toujours plus intimement associés. Le lecteur est donc invité à se détacher de « l’écrasante partition entre Objet et Sujet » (p. 188), mais il va lui falloir maintenant se débrouiller avec des « quasi-objets » et des « quasi-sujets ».
D’une manière qui peut paraître plaquée, l’enquête est aussi justifiée par une invocation à Gaïa. Que vient faire cette figure presque mythologique dans l’histoire ? Pour Bruno Latour, dans une forme de prolongement à peine explicité avec les travaux de James Lovelock sur les fonctionnements autorégulateurs de la biosphère (et probablement sous l’influence de discussion avec la philosophe Isabelle Stengers), « c’est désormais devant Gaïa que nous sommes appelés à comparaître » (p. 15). Gaïa n’est pas un concept facile à utiliser et Bruno Latour ne semble guère y accorder d’importance, pas plus qu’aux connotations spiritualistes et animistes qu’il tend par là à (ré)introduire dans la question écologique (il ne peut évidemment pas aller jusqu’à parler de notre « mère Nature »). Pour lui, les possibles manifestations vengeresses de Gaïa produisent une situation incontournable, et l’enquête qu’il propose est un travail à la fois anthropologique, philosophique et diplomatique présenté comme nécessaire pour affronter collectivement cette situation, en revenant sur ce qu’ont laissé ceux qui se sont prétendus « modernes » et en signalant une nouvelle tâche, à savoir « écologiser ». Ce serait la grande alternative face à la modernisation : « Entre moderniser ou écologiser, il faut choisir » (p. 19). Ou, comme Bruno Latour l’ajoute plus loin : « S’il s’agit d’écologiser et non plus de moderniser, il va peut-être devenir possible de faire cohabiter un plus grand nombre de valeurs dans un écosystème un peu plus riche » (p. 23). Reste à établir ce que signifie « écologiser », pour ne pas en rester à des généralités creuses. Malheureusement, ce n’est pas avec ce livre que le lecteur pourra le savoir clairement et il préférera peut-être plutôt se reporter à Politiques de la nature. Comment faire entrer les sciences en démocratie (Paris, La Découverte, 1999), où le thème avait aussi été abordé, mais à l’époque sans directement convoquer Gaïa. S’il s’agissait déjà d’oublier la « nature » comme catégorie conceptuelle et interprétative, la figure de Gaïa vient apparemment plus comme une espèce de présence tutélaire pour donner les directions dans lesquelles recomposer un monde commun. L’intention semble être d’amener à une nouvelle appréhension des relations des humains à leur planète. Des relations prises de fait dans des institutions qui peuvent aller de la science à la religion, de l’économie à la politique, de la morale au droit. Mais le lecteur appâté devra se référer à d’autres textes plus récents de Bruno Latour, notamment les Gifford Lectures à l’Université d’Édimbourg, pour trouver des clarifications (voir les vidéos ou la retranscription). Cette forme de reprise de l’hypothèse Gaïa peut du reste paraître curieuse de la part de quelqu’un s’évertuant à réfuter ceux qui considèrent trop facilement que le tout est plus que la somme des parties.
Difficile également de voir où il veut en venir quand il traite de politique. Sauf au moins sur un point : quand on s’appelle Bruno Latour, on doit avoir une position forcément différente et à l’écart de cette « bizarrerie : la science politique » (p. 335). En reprenant les pistes de textes précédents et en renvoyant de manière allusive et codée à l’américain Walter Lippman, un accent important est en fait mis sur la parole politique, dont une fonction essentielle serait d’articuler représentation (le passage de la multitude à l’unité) et obéissance (le retour de l’unité à la multitude) dans une boucle circulaire. Mais pas grand-chose auquel se raccrocher pour saisir les situations et les processus sur lesquels le philosophe anthropologue est censé discourir. La médiation de l’action est censée passer par des « scripts », mais sans que l’on sache bien quel est leur statut, puisqu’ils semblent pouvoir être portés autant par des formes de discours que par des artefacts. S’il cherche lui-même des exemples, le lecteur peut effectivement penser au travail des employés des centres d’appel, mais la perspective de Bruno Latour semble bien plus large (sans lien d’ailleurs avec la littérature sur les conventions et les procédures) et l’on est obligé là aussi de revenir à ses travaux antérieurs.
De même, au fur et à mesure qu’avance cette enquête sur les valeurs des « Modernes », l’absence de définition de la notion de valeur devient de plus en plus gênante, compte tenu là aussi de la vaste quantité de travaux sociologiques qui ont essayé de travailler cette notion. Ces valeurs s’avèrent ainsi traitées à un niveau qui les homogénéise fortement et qui n’aide pas à comprendre les conditions, pratiques notamment, pour vivre ensemble (comment faire communauté ?). Suivre la présentation des modes était difficile, comprendre leur croisement (puisqu’ils peuvent se croiser) le devient plus encore. D’autant qu’à nouveau, les exemples sont rares. Pas sûr d’ailleurs qu’on soit plus avancé, par exemple pour traiter des effets de la science sur la religion et réciproquement (qu’est-ce qu’un telle perspective apporterait de plus pour comprendre le développement du courant de l’« intelligent design » ?). Est-ce que cette construction ontologique aide à penser la fusion du vivant et du machinique ? Il est permis d’en douter.
Bruno Latour donne peu d’éclairages sur la formation, la reproduction ou l’évolution des « modes d’existence » qu’il prétend repérer. Ces « modes d’existence » ne semblent pas avoir d’historicité. Le flou n’est pas non plus dissipé sur les êtres, les actants, les forces (on ne sait plus comment les appeler) qui participent à la production de ces « modes d’existence ». Le monde présenté s’avère de surcroît tellement aplati qu’il devient difficile de penser les formes de domination (mot que l’auteur récusera probablement de toute manière) et les enjeux de justice (qui sont bel et bien des enjeux politiques et moraux). Bruno Latour, si l’on prolonge ses métaphores guerrières, ne se soucie guère de savoir pourquoi ce sont presque toujours les mêmes qui sont les vainqueurs. Que des intérêts finissent par l’emporter (par enrôlements et associations) et par imposer leurs visions du monde, il n’y a qu’à décrire et constater, mais pas à se poser de questions. De même, s’il s’agit de suivre le déploiement de réseaux, il n’y aurait pas lieu de se demander s’ils sont polarisés et pourquoi. Ni comment et pourquoi l’entretien d’interdépendances peut conforter des relations inégalitaires. Certes, on pourra toujours se borner à cartographier des activités de lobbying qui tendent à maintenir artificiellement des controverses en manipulant le doute (comme sur l’enjeu climatique, qui fournit une situation illustrative pour l’ouverture du livre). À ce compte-là, notre porte-parole de Gaïa aura beau réclamer une écologisation, il pourra encore attendre longtemps. Sauf à espérer que le renouvellement des catégories et le déplacement ontologique qu’il propose feront miraculeusement évoluer les esprits. D’autant que la modernisation semble continuer à avancer, comme si le processus était inexorable. Le substrat environnemental est transformé en « ressources », en « capital naturel », en « services écologiques », ce qui peut ouvrir la voie à des formes de marchandisation. Certains pourraient même reprocher à l’aplatissement ontologique de Bruno Latour de favoriser l’appropriation et l’artificialisation des processus vivants et de ce qui reste des écosystèmes. S’il n’y a plus ni intérieur, ni extérieur, il n’y aurait plus de limites. Les humains peuvent être traités comme des non-humains ; tout peut être manipulé sans distinction morale. C’est négliger aussi comment les considérations écologiques peuvent être absorbées par la modernisation. Face aux menaces de changement climatique, l’adoption des solutions de « géo-ingénierie » est aussi une trajectoire qui semble devenir plus probable. Exemple ultime de la prétention des « Modernes » à intervenir dans et sur la « Nature » ? En tout cas, signe de la perpétuation des schémas de pensée qui peuvent être considérés comme ayant une large part dans les phénomènes devenus problématiques. Bruno Latour, qui affiche son intérêt pour les « hybrides », trouverait d’ailleurs un bel exemple en sociologie avec la théorie de la « modernisation écologique », qui laisse entendre que les processus de développement industriel et de croissance économique commencent à intégrer des logiques de « durabilité » environnementale, voire pourraient y contribuer (notamment grâce à des adaptations technologiques et des politiques de soutien à l’innovation). Tant qu’à développer une réflexion ontologique, celle autour de la belle notion d’écoumène, subtilement retravaillée par le géographe Augustin Berque, serait peut-être plus productive, tout en permettant de conserver une ontologie relationnelle, celle d’une espèce humaine irrémédiablement reliée à quelque chose qui l’entoure et la dépasse.
Finalement, c’est l’auteur lui-même qui offre un moyen facile de conclure ce compte rendu. Difficile de ne pas saisir la perche lorsque, dans les dernières pages, il résume son enquête comme « [u]n pêlemêle de curiosités qui en dit long sur les goûts bizarres de l’autodidacte qui les a rassemblées, mais très peu sur le monde qu’il prétend décrire » (p. 474). Et quant à savoir quoi en faire, le sentiment de certains lecteurs pourra être résumé de la même manière (en retirant toutefois l’amusement) : « Ils n’auront fait que visiter, avec un mélange d’amusement et d’agacement, un modèle réduit du modernisme, sorte de Palais du facteur Cheval, certes plein de fantaisie, mais à peu près aussi utile pour eux que la reconstitution de Paris en allumettes ou de Pékin en bouchons de liège… » (p. 475). Sur ce point au moins, il ne pourra pas une fois de plus écarter ses critiques en disant qu’ils ne l’ont pas compris.



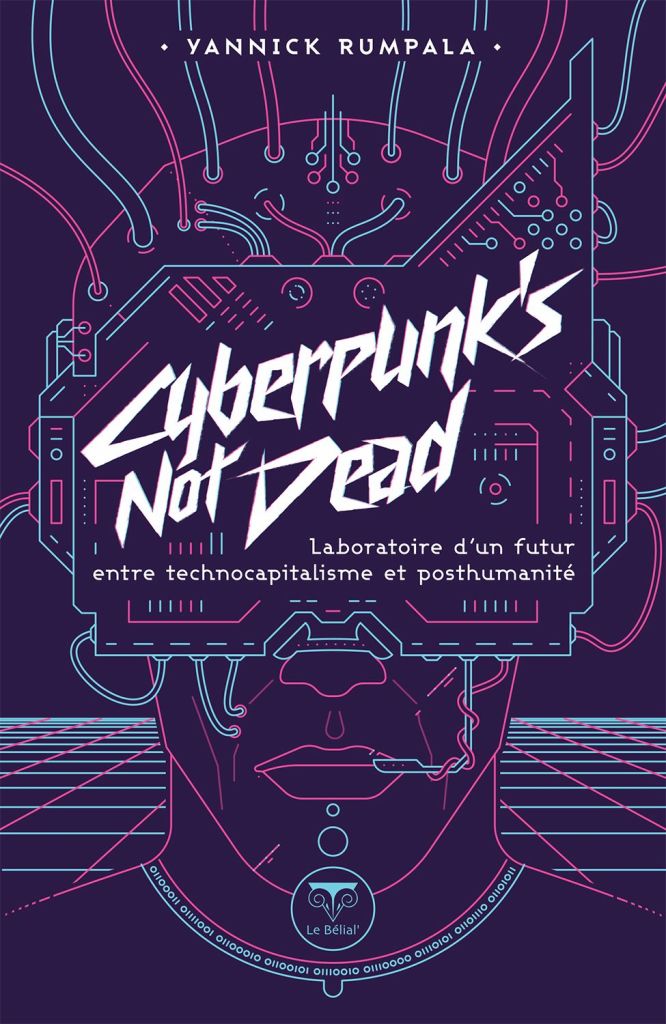

Excellent compte-rendu ; et puisque vous citez un géographe, moi je conseille d’en lire un autre, Claude Raffestin, dont l’œuvre reste encore dans l’ombre (probablement parce qu’il n’a pas publié en anglais). Ses écrits ont également traité des réseaux, de logique relationnelle (ou systémique), d’écologie humaine et de pouvoir.
Merci. Je connais moins les réflexions de Claude Raffestin. La dimension spatiale est de fait peu présente dans le livre de Bruno Latour, ce qui accentue l’impression de flottement lorsqu’il repositionne son analyse des réseaux comme celle d’un « mode d’existence ».
Excellente analyse critique de cet étrange ouvrage. J’avoue avoir été séduit par le titre, le projet et même ses « prolongements » pour intellectuel geek que j’ai été parfois. Par contre, j’ai déploré les discours de louange prononcés à sa parution par la presse pressée mais aussi par Boltanski. Tous s’extasiaient sur l’enjeu, la performance, l’exercice de style comme s’ils étaient impressionnés par la « montée en ontologie », qui sidérait et empêchait tout exercice critique (Bourdieu ou Castoriadis ne sont plus là…).
Heureusement votre article vient combler ce manque.
Je m’intéresse aux travaux de Bruno Latour depuis le milieu des années 1980. J’ai tout de suite été séduit par l’idée de transposer son modèle d’abord appliqué aux sciences et techniques, à d’autres domaines ou mondes sociaux. J’avoue par contre, que je suis beaucoup moins convaincu par son tournant philosophique, notamment celui qui se fait jour dans son Politiques de la nature (1999). Si l’auteur revendique une formation philosophique et des préoccupations de cet ordre depuis le début (dialogue avec M. Serres, Les Microbes + Irréductions dès 1984, etc.), que penser d’une enquête qui ne serait plus que platonique 😉 J’avoue que j’aimais mieux l’homme de terrain et d’archives…
J’appréciais aussi les premiers travaux de Bruno Latour, mais ce livre m’est littéralement tombé des mains. En le lisant, je n’ai pas non plus compris cette espèce d’excitation médiatique qui en faisait presque un nouveau gourou intellectuel. Je souscris donc à votre conclusion : s’intéresser plutôt au Latour sociologue et espérer qu’il ne sera pas encouragé à poursuivre dans cette veine qui se voudrait plus « philosophique ».